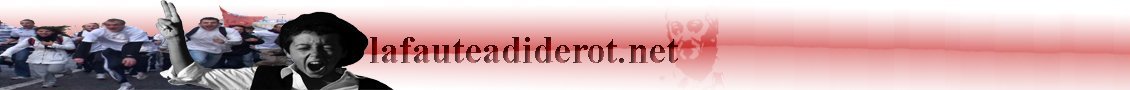
Aux origines du mythe cathare : Les « Bons Chrétiens » à travers l’histoire et la littérature européennes (Ve-XXIe siècles)
Alain Vuillemin, professeur émérite de littérature comparée de l’Université Paris-Est Créteil, historien, linguiste, a déjà produit plusieurs études remarquées sur les mouvements pauliciens, bogomiles, albigeois, cathares et autres, considérés comme hérétiques par les pouvoirs religieux et politiques.
Avec ce nouveau livre, une somme particulièrement érudite, il nous offre les fruits d’une recherche complexe et passionnante sur des pans méconnus, souvent fantasmés, de l’histoire des idées religieuses européennes.
En introduction, il présente les quatre regard posés sur les mouvements étudiés, leur histoire et leur influence, illustrant ainsi la démarche : « les dénominations attribuées – une mythologie complexe – un phénomène religieux – une littérature morcelée ».
Alain Vuillemin commence par une recherche minutieuse des dénominations et appellations que se donnèrent ces mouvements ou qui leurs furent attribuées, à travers le temps et l’espace, dénominations initiales ou dérivées, qui ne sont pas sans ambiguïtés. Exemple avec le mot « cathare » :
« Dans ces débats, le mot « cathare » occupe une place à part, il est apparu en Rhénanie au cours du XIIe siècle. Il ne peut être employé au sens propre qu’en Rhénanie, tout au long de la vallée du Rhin, uniquement pour cette région et pour cette période, au XIIe siècle. Il s’est répandu en Europe, dans l’historiographie, à partir du milieu du XIVe siècle. Il s’est substitué en Languedoc et en France au mot « albigeois ». Il ne correspond pourtant pas à ce qu’il prétend désigner. »
Si le berceau de ce courant protéiforme, fruit des conflits entre les religions de l’époque, fut iranien et son creuset arménien, ses implantations bulgares précèdent une expansion en Europe centrale et occidentale jusqu’à des infiltrations vers l’Extrême-Orient. Son rayonnement, généralement sous-estimé, est donc important.
Alain Vuillemin cherche à mieux cerner une mythologie complexe, devenue autonome et par conséquent assez insaisissable. Reconnaître les mythèmes et leurs déplacements dans le temps et la géographie mais aussi dans des récits de natures et constructions différentes (contes, légendes, fables, allégories, récits mythologiques…) est une tâche immense mais nécessaire. Pour cela, Alain Vuillemin part des récits fondateurs pour identifier un noyau initial arménien, paulicien, connu par un témoignage tardif, hostile, sans doute déformé, du IXe siècle. Il se fraye un chemin parmi les constructions polémiques, les mythes réinventés, pour dégager un certain nombre de certitudes, des hypothèses, et écarter des présupposés ou préjugés sans fondements.
Comme phénomène religieux, précise Alain Vuillemin, « le catharisme, le patarisme, le bogomilisme, le paulicianisme renvoient à des croyances qui sont difficiles à appréhender. Ces mouvements présentent des traits qui ont été empruntés à de nombreuses doctrines religieuses, les unes d’une origine chrétienne et d’autres d’une provenance perse, orientale, et centre asiatique, zoroastrienne et mazdéenne. Leur histoire s’étend aussi sur plus de dix siècles. »
Les écrits préservés, notamment le fameux « Livre secret », l’Interrogatio Iohannis, connu par une traduction latine datant du XIIe siècle, les écrits apocryphes, les chroniques historiques mais aussi les anathèmes, permettent d’approcher une doctrine originale. Alain Vuillemin distingue la doctrine initiale des doctrines dégradées de schisme en schisme et de déplacement en déplacement. Il interroge l’existence d’une doctrine dite « radicale » du bogomilisme, fondée sur un dualisme absolu. Cette doctrine, son économie et son écologie, était appuyée à un ensemble rituel connu lui par les écrits de ses adversaires.
Un chapitre est consacré aux persécutions exercées contre ces mouvements car cette histoire est celle d’une succession et d’une accumulation de drames rythmés par les procès, les synodes et conciles hostiles et les guerres, conduisant à l’éparpillement des diasporas et l’oubli des survivances.
La fin de l’ouvrage traite des résurgences littéraires et les recréations romanesques. « L’histoire de ces « bons hommes » et de ces « bons chrétiens », nous dit encore Alain Vuillemin, depuis la lointaine Arménie a donné naissance en Europe occidentale, au XXe siècle et au XXIe siècle, à un « mythe cathare » prolifique. »
Cette matière littéraire, devenue très internationale, véhicule à la fois des éléments de la doctrine unique née en Arménie, de ses adaptations et déformations au fil du temps, et une confusion favorisée par une histoire chaotique. Alain Vuillemin, par cette longue et passionnante enquête, si rigoureuse, ne lève pas complètement le mystère sur les origines, ne résout pas l’énigme même que constitue l’émergence de ce courant marginal mais influent mais, il nous donne un cadre magistral dans lequel le penser.
Elena-Brânduşa Steiciuc conclut sa préface au livre par ces mots :
« La lecture de cet ample ouvrage d’Alain Vuillemin constitue un parcours enrichissant à travers l’histoire et la littérature européenne (mais pas seulement) ayant comme guides la finesse herméneutique et le savoir d’un grand expert en histoire de la littérature et en littérature comparée. Le mythe cathare continuera de fasciner les générations de créateurs et de lecteurs, car l’homme aura toujours ce « droit de rêver » dont parlait Gaston Bachelard et qui est un des noyaux fondateurs de l’existence. »
Aux origines du mythe cathare : Les « Bons Chrétiens » à travers l’histoire et la littérature européennes (Ve-XXIe siècles)
Alain Vuillemin
Editions Rafael de Surtis - https://rafaeldesurtis.fr/
Sorcellerie : Objets pour guérir, Objets pour maudire
Ce superbe livre témoigne de la tradition et des savoirs des Anciens à travers plus de 500 objets répertoriés que Hugues Berton et Christelle Imbert ont recueillis, de 1984 à 2007, dans les campagnes, au fil des rencontres et des enquêtes de terrain. C’est le troisième ouvrage qu’ils consacrent au sujet après Médecine et sorcellerie en milieu rural, formes et structures des thérapeutiques traditionnelles, chez Dangles en 2008 et Sorcellerie en Auvergne, déjà aux Editions de Borée en 1995.
Hugues Berton et Christelle Imbert sont passionnés d’ethnologie. Hugues Berton, chercheur, a fondé la Société d’Etudes et de Recherches des Survivances Traditionnelles, le SEREST qui a pour vocation la sauvegarde des rites et croyances. http://www.serest.org/
Nous leur devons déjà un livre remarqué, consacré aux rituels du Compagnonnage et de la Franc-maçonnerie, Les Enfants de Salomon. Approches historiques et rituelles sur les Compagnonnages et la Franc-maçonnerie publié en 2015 aux Editions Dervy.
Avec beaucoup de respect et d’attention à l’autre, Christelle Imbert et Hugues Berton rendent compte de modèles du monde traditionnels, toujours actuels, dans une volonté de partage, de préservation et de transmission de savoirs et pratiques anciens. Ces pratiques et ces objets associés ne doivent pas être approchés comme des curiosités mais comme des témoignages d’une permanence de traditions remontant souvent à plusieurs siècles.
« L’apparente humilité des objets « paysans », dès lors qu’ils sont sculptés de décors symboliques, ne saurait évacuer leur fonction principale : donner un sens aux angoisses que connaissent les humains face aux questions essentielles telles la souffrance, la maladie, la mort, et permettre de survivre dans les meilleures conditions possibles tant sur le plan temporel que spirituel. »
« Objets pour guérir » et « objets pour maudire » : un nom et deux verbes qui pourraient induire une vision restreinte des sujets abordés. Mais, précise les auteurs, « le fait de guérir implique un retour à l’unité primordiale et par conséquent ne relève pas d’un système dualiste ». Et « Maudire, c’est prononcer une parole annonçant un châtiment en punition d’une faute. C’est appeler sur un être ou une chose la colère divine, par le biais de paroles, c’est invoquer sur un être ou un objet la descente d’une influence spirituelle afin que se manifeste le mal qui a été et qui sera. Il y a ici une certaine idée de l’expression d’une justice, ne pouvant s’exercer par voie ordinaire ».
Ce qui apparaît comme une simple superstition présente bien d’autres dimensions, sociétale, philosophique, linguistique, mythologique, métaphysique et autres. L’objet lui-même, quel qu’il soit, est bien davantage que ce qu’il présente : « Par la manipulation de l’objet, l’être en souffrance réintègre tout un monde, celui de ceux qui l’ont précédé de génération en génération. L’objet est un lien, il permet de retrouver le lien avec sa société, de se ré-associer avec le point d’origine mythique, le divin thérapeute ».
L’enracinement social de ces objets porteurs d’histoires et de croyances nous apparaît dès lors que nous parcourons l’ouvrage. Loin de nous êtres étrangers, beaucoup nous sont familiers. Nos deux auteurs cherchent à établir le processus qui conduit du mythe à l’objet de croyance. Ils prennent en compte la notion essentielle de contenant et contenu que nous retrouvons dans beaucoup de mythèmes traditionnels. Ils établissent le lien entre la manipulation, le détournement de l’objet et ses fonctions superposées : « Lorsqu’ils sont détournés de la fonctionnalité pour laquelle ils sont été initialement produits, ces objets ne sont finalement qu’un moyen pour leurs usagers de se les approprier, de trouver en eux les correspondances en adéquation avec leurs formes et ainsi de les doter d’une identité singulière. »
Amulettes, talismans, livres, objets de protections ou autres sont autant d’indicateurs de notre sentiment de vulnérabilité et de faiblesse. Si les religions, notamment le christianisme, ont cherché dans leurs élaborations théologiques sophistiquées à circonvenir les pratiques populaires, celles-ci, parce qu’elles sont issues du quotidien, se sont adaptées pour perdurer, maintenant une forme d’intégrité individuelle face à l’adversité et assurant également la cohésion de la communauté, sans parler de médecines traditionnelles toujours aussi vivantes malgré les condamnations académiques.
Il s’agit donc d’un patrimoine, principalement immatériel mais tangible, que nous aurions tort de négliger. Il fait partie de nos héritages, de nos cultures et contribue à une meilleure connaissance de nous-mêmes. En découvrant au fil des pages, à travers des objets plus ou moins communs mais aux fonctions peu communes, les croyances induites, les mythes qui les ont tissées, les mécanismes psychologiques à l’œuvre, les systèmes de valeurs, les modèles du temps et d’autres spécificités de la complexité humaine, c’est bien une quête de sens qui se dessine.
Sommaire
L’objet dans toutes ses magies : Introduction – La notion d’objets – La Tradition et le _ Mythe d’origine – Du mythe à l’objet de croyance – Contenants et contenus – Des objets chargés de sens… – Qui peut le bien peut le mal… – L’utilisation des objets de savoir et de pouvoir.
Savoir se protéger : Amulettes, talismans, porte-bonheur, monnaies de protection.
Christianisme : de la religion officielle à la religion populaire : De la Bible à la théologie officielle – De l’oral à l’écrit : bon et mauvais livres – Reliques –La thérapie par les saints – Le temple chrétien et la pierre d’autel – Cultes de saints guérisseurs.
Objets de protection dans la demeure paysanne : Objets détournés – Protections extérieures – Le Feu – Le Joug – Le Sel – Le Pain – Le Beurre – La Table- Protections diverses – Filage et Tissage – Dentelle – De l’Angoisse à la Mort.
De la Divination aux Maléfices :
Objets de divination : Les méthodes de divination de l’antiquité à nos jours – L’objet de divination en tant que support de perception – Le Miroir – Le Tamis et les Forces – La Baguette et le Pendule – La Tache d’encre – Cartes et Tarots.
Objets maléfiques : Acquérir le pouvoir – Grimoires – Leveur / jeteur de sort – Objets pour maudire et malfaire – Entre protection et intimidation : les Cannes.
De la protection vers la Guérison de l’Âme et du Corps :
Objets de protection, de guérison et de croyances : Cause des maladies dans la pensée traditionnelle – Théorie de la signature, analogies et transfert – Plantes – Animaux – Pierres magiques et guérisseuses – Un trésor méconnu : les pierres à venin en Velay / Vivarais – Conjurations.
Conclusion.
Bibliographie. Index. Notes.
Sorcellerie : Objets pour guérir, Objets pour maudire
Hugues Berton et Christelle Imbert
Collection Beaux Livres
Editions De Borée, 45 rue du Clos-Four, 63056 Clermont-Ferrand cedex 2 – www.deboree.com
Les mondes de Paul Delvaux
Tempora – https://tempora-expo.be/projects/les-mondes-de-paul-delvaux/
A l’occasion du 100ème anniversaire du surréalisme, une magnifique exposition consacrée au peintre Paul Delvaux (1897-1994) se tient au musée de la Boverie à Liège du 4 octobre 2024 au 16 mars 2025, en partenariat avec Tempora et la Fondation Paul Delvaux.
Paul Delvaux est l’un des grands peintres du siècle dernier. L’exposition, exceptionnelle, rassemble des chefs d’œuvre, certains rarement exposés, qui mettent en évidence les thèmes (les mondes) explorés par le peintre. Il s’agit d’une rétrospective complète, composée de plus de cent cinquante œuvres, qui permet de découvrir l’ensemble d’un parcours d’artiste et d’un chemin de vie. Outre les femmes et les gares, thèmes très prisés par le peintre, qu’il associe d’ailleurs en certaines œuvres, nous observons l’importance de la mort ou de l’antiquité dans son œuvre. Les thèmes mêmes donnent un écho initiatique à l’ensemble.
Nombre de ces tableaux invitent tant à la contemplation silencieuse, expérience unifiante, qu’à une pensée élaborée et complexe.
L’exposition met en regard de certaines des œuvres de Paul Delvaux des œuvres d’autres artistes, comme Magritte, Picasso, Chirico, Modigliani… ouvrant un dialogue qui met en évidence des influences, des intuitions communes, des fascinations partagées.
Les propositions multimédias du musée et la reconstitution de l’atelier du peintre, permettent d’entrer dans le processus de création de l’artiste. L’univers poétique de Paul Delvaux qui approche en certaines œuvre l’Imaginal ne se laisse jamais réduire. Il demande une forme de lâcher prise, de présence à l’instant même, porté par certains de ses personnages, les femmes principalement.
Le catalogue, réalisé par Tempora, tout comme l’exposition, est particulièrement réussi.
https://expo-pauldelvaux.com/
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil