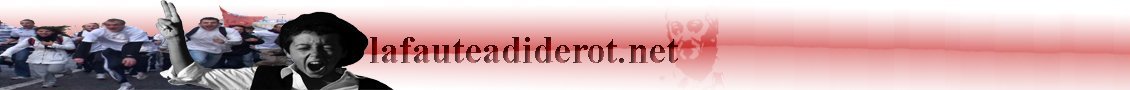
Présentation. Benoit Frachon dont on célèbre avec Jacques Duclos le cinquantenaire de la disparition est sans conteste un des grands dirigeants de la CGT, du PCF, mais aussi de la Résistance. Homme de masse, il est de tous les combats et a passé 5 années de sa vie dans la clandestinité dès la chasse aux communistes lancée par Daladier en août 1939. La Faute à Diderot a raison de vous présenter ce texte de novembre 1944 sur la nécessité de produire pour sortir victorieux de la guerre. La France est en partie occupée et les troupes anglo-américaines n’engagent pas le combat avec la même ardeur que les troupes soviétiques. La guerre est loin d’être terminée. Ce texte est d’autant plus important qu’il dénonce les revirements de dernières minutes des Vichystes, leur intégration dans les administrations, leur maintien dans les grandes entreprises. Il dénonce la parodie de l’épuration que ne touchera que quelques-uns, alors que les plus roués ne prendront même pas le temps de la fabrication d’une légende sur leur passé collaborationniste pour s’assurer du contrôle des destinées du pays. Il serait erroné de croire que ceux-ci pensaient que l’Allemagne nazie resterait un recours, non ils vont adopter les thèses américaines qui entendaient faire de la France un pays occupé, une base avancée de la domination mondiale des Etats-Unis. Les magnats US convoitaient les richesses du pays et voulant être l’usine du monde, ils faisaient tout pour que la relance de la production française échoue. Dès les dernières semaines avant le débarquement, de Gaulle doit s’opposer bec et ongles à la fameuse monnaie américaine destinée à supplanter les Francs, prête à inonder le territoire national. C’est dire si les menaces étaient sérieuses. D’ailleurs, les États-Unis renâcleront à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République et n’enverrons que fin septembre 1944 un sous-fifre, spécialiste de l’Amérique latine comme représentant. Il faut dire qu’il avait sans doute l’expérience de la remise au pas de ces pays, chasse gardée des États-Unis, par des coups d’état. Il faut d’ailleurs lire le livre de mémoires « Veni, Vidi, Vichy… et la suite » [1]de Raymond Brugère, ambassadeur de France, où il décrit les conditions de son limogeage du poste de secrétaire général du quai d’Orsay moins de 3 semaines après y avoir été nommé. Or, le discours de Frachon a lieu un mois après, c’est dire s’il collait à l’actualité. Alors ne laissez pas passer cette lecture si instructive et loin des fables véhiculées à ce sujet ! Philippe Pivion. 21 juillet 2025
Rapport de Benoit Frachon à la conférence pour la reprise économique organisée par l’Union des syndicats ouvriers de la région parisienne, le 12 novembre 1944
Il n’est pas un seul Français qui ne soit convaincu de la nécessité de remettre rapidement la France au travail, d’utiliser à plein tout ce qui nous reste de notre économie.
En effet, la guerre n’est pas finie, nous devons abattre l’hitlérisme dans son propre pays, et les Français patriotes qui ont tant fait pendant quatre années pour lutter à l’intérieur contre l’ennemi, considéreraient comme indigne d’eux que la tâche qui nous reste à accomplir soit laissée à nos seuls Alliés, et ils veulent y participer.
La participation de la France à la guerre nécessite l’armement de ses soldats et, là encore, les ouvriers français qui ont saboté, tant qu’ils ont pu, l’industrie de guerre pendant l’occupation, considèrent comme leur devoir le plus grand de développer cette production au moment où elle est affectée à leurs propres soldats.
Nous ne pensons pas qu’il soit très digne de compter sur la production anglaise et américaine pour armer des centaines de milliers des nôtres qui ne demandent qu’à se battre à nos frontières.
D’autre part, en plus de la production de guerre indispensable à nos soldats, il est nécessaire de ranimer notre vie économique et de fournir à notre population, qui a tant souffert matériellement, ce qui est indispensable à son existence. Nous savons bien que nous ne pouvons pas prétendre immédiatement à l’étalon de vie d’avant 1939, mais il y a actuellement en France le moyen de donner à nos populations des choses qu’elles n’ont pas encore. Il y a moyen d’améliorer le ravitaillement, et nous serions très criminels si nous ne faisions pas tout le nécessaire pour y contribuer.
Or, les rapports qui vous ont été présentés, et toutes les constatations que nous avons faites et que nous continuons à faire dans tous les départements, montrent qu’après deux mois et demi que la plus grande partie de la France a été libérée, les choses ne vont pas pour le mieux, tant s’en faut.
La reprise économique se fait avec une lenteur déconcertante, et quand il y a quelques améliorations – comme on commence à le constater – cela est dû à l’insistance avec laquelle nous avons exigé qu’on change les méthodes, qu’on bouscule les vieilles routines.
Il est regrettable de constater qu’à maintes reprises nous ayons du poser les problèmes publiquement et les poser parfois avec quelque brutalité.
Quelles sont les raisons qu’on donne pour expliquer la lenteur de cette reprise économique ? On nous les répète très souvent dans les discours officiels et officieux : c’est que les destructions dans notre pays sont considérables, et on ajoute parfois qu’il nous faudra des années et des années pour revenir à une situation normale.
Quelle est la vérité ?
De toute évidence, notre pays a subi, au cours des bombardements et des batailles qui se sont déroulées sur notre sol, des destructions sévères. En particulier, ses transports ont été mis à mal ainsi que son matériel ferroviaire, mais nous ne pensons pas qu’on doive dire que notre économie est à un tel point que nous ne puissions pas en utiliser une grande partie.
Nous avons conservé de nombreuses industries à peu près intactes dans la région parisienne, comme d’autres centres d’industries ; nos puits de mine ne nécessitent qu’un aménagement immédiat.
Sans doute, il y a des sabotages à réparer ; dans les mines, dans les usines, les patriotes ont, pendant l’occupation allemande, saboté des machines : c’était leur devoir ; on a fait sauter des transformateurs, on a empêché, autant que l’on a pu, la production de marcher normalement pendant la présence de l’ennemi, mais ces réparations peuvent être faites avec une assez grande rapidité et nous savons même que dans bien des cas, les ouvriers ont déjà pansé certaines blessures.
Nous avons donc en France un potentiel industriel qui n’est pas du tout négligeable. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce potentiel économique, industriel, n’est pas utilisé ?
C’est ce qu’il faut dire. Déjà nos camarades, dans leurs rapports, ont montré par des exemples précis, la façon dont on a empêché de marcher certaines entreprises. Nous allons essayer de condenser dans un aperçu général les observations relevées, et par nos camarades de la région parisienne, et par nos camarades des autres régions.
Absence totale d’un plan général d’utilisation de nos ressources
La première raison pour laquelle les choses ne vont pas en France c’est qu’il y a en haut lieu absence totale d’un plan général d’utilisation de nous ressources. Toutes les constatations que nous avons pu faire, c’est que l’on s’occupe parfois de faire réparer telle ou telle chose, mais quand on a réparé un pont, quand on a réparé une usine, cela ne va pas encore… Et quand on demande pourquoi, on s’aperçoit que le pont qu’on a réparé ne peut être utilisé parce qu’un peu plus loin la voie n’a pas été réparée, ou que la gare de triage est inutilisable. Quand on a remis en état une usine, alors on vous dit par la suite que cette usine ne peut fonctionner parce qu’en même temps qu’on la réparait, on a oublié de réparer la voie de chemin de fer qui lui aurait amené le combustible nécessaire, ou bien que les usines, les industries qui lui fournissent les matières premières ne sont pas encore en état de marche et que, par conséquent, on manque de matières premières.
Il n’y a donc pas, au sommet, un plan général de reconstruction de notre industrie et d’utilisation des ressources qui nous restent.
Ça c’est un point capital.
Absence de foi patriotique
La deuxième raison pour laquelle ça ne va pas et pour laquelle il n’y a pas de plan général de reconstruction de l’industrie, de l’économie de notre pays, c’est que dans certains milieux on manque de foi patriotique nécessaire à la réalisation de grandes choses. On va son petit train-train, comme on allait avant la guerre ; il y a des gens qui travaillent en 1944 comme ils travaillaient en 1939. La foi patriotique qui animait nos Francs-tireurs, nos Partisans, nos FFI, nous ne la trouvons pas dans l’administration qui a la charge de remettre en route l’économie nationale.
Les deux questions importantes sur lesquelles il faut se pencher pour remettre en route l’économie de notre pays sont : 1° la questions des transports ; 2° la question du charbon.
Depuis deux mois et demis on tente d’expliquer le retard dans la reprise économique par les grandes destructions qui existent dans nos voies de chemin de fer, on ne peut faire marcher les trains si on n’a pas de charbon parce que les transports ne marchent pas. Il est bien évident qu’on peut, pendant des années, expliquer ainsi la carence dont on fait preuve. Mais cela n’explique pas tout.
Je vais vous donner un exemple des raisons qui font qu’on explique la carence par le cercle vicieux : manque de charbon et manque de transports.
J’ai découvert dans un rapport officiel sur les nécessités d’importer en France un certain nombre de marchandises le passage suivant, qui éclaire bien des choses :
Si nous voulons que l’économie française reprenne au printemps 1945 ainsi que les importations devraient le lui permettre, il est indispensable que nous augmentions nos ressources en charbon. Pour cela, il faut augmenter notre production minière et des étais métalliques qui permettraient de doubler notre production au début de 1945. Les mesures nécessaires ont été demandées aux Alliés.
J’insiste sur le fait que ce passage est issu d’un rapport officiel.
Ainsi, dans ce rapport officiel, on envisage la reprise économique, non pas pour tout de suite, mais…pour le printemps de 1945. Quand on a une telle conception de la reprise économique, vous pensez bien qu’on ne se casse pas la tête pour trouver des solutions immédiates. Les solutions immédiates sont trop difficiles… On attend le printemps de 1945. Et pour cette reprise économique on ne compte pas sur l’effort français : on a demandé aux Alliés de bien vouloir s’en occuper et on leur a demandé de nous fournir le nécessaire.
Il y a là non seulement une carence totale, mais un manque de dignité nationale absolu. Voilà un pays qui sort de l’occupation, un pays qui a montré, au cours de la lutte contre l’ennemi, tant de qualités, dont les hommes et les femmes ont montré tant de valeur et tant de courage, et dans lequel les dirigeants font appel uniquement aux Alliés pour réparer les ruines que tous les Français sont prêts à réparer eux-mêmes.
Dans le rapport cité plus haut, on a demandé aux Alliés du bois de mine et des étais métalliques. On ne s’est pas soucié un seul instant du bois de mine qui existe en France, prêt à être utilisé.
Notre Fédération des mineurs, la CGT elle-même, ont signalé des endroits où existaient des quantités de bois de mine : 400.000 stères dans les Landes, des centaines de milliers de stères dans les Ardennes, en Champagne, dans l’Yonne, mais ces bois de mine n’arrivent pas… On attend que les Alliés nous en envoient.
On nous dit qu’il faut attendre que les voies soient remises en état pour amener du bois de mine. Vous croyez qu’une partie de ces 600.000 chômeurs de la région parisienne dont parlait tout à l’heure Hénaff, n’aurait pas pu être employée utilement à réparer ces voies et ces ponts ?
Il est vrai que lorsque vous demandez les raisons pour lesquelles les ponts n’ont pas été réparés, on n’ose pas vous dire qu’on manque d’ouvriers – alors qu’il y a 600.000 chômeurs – mais on trouve tout un tas de bonnes excuses. On n’a pas de matières premières, on n’a pas le fer nécessaire à l’établissement de ces ponts, mais comme par hasard, notre Fédération des métaux nous indique que dans telle usine, dans tel chantier, on peut trouver les ponts nécessaires. Elle nous indique encore, par la suite, que les entreprises qui ont été désignées pour réparer les ponts ont mis à l’étude, non pas la construction de ponts provisoires, qui peuvent être faits rapidement, mais la construction de ponts définitifs, de grands ponts qui seront classés comme ouvrages artistiques, mais qui demanderont deux années et demie pour être exécutés… De la même façon que chez Delahaye, les camarades nous signalent qu’on étudie une voiture de grand luxe, pour maintenir la renommée de l’industrie française, alors que nous manquons de camions, que nous manquons de camionnettes, que nous manquons de voitures utilitaires.
L’histoire de ces bois de mine est d’ailleurs curieuse.
Nos camarades mineurs du Nord et du Pas de Calais sont allés, en délégation, déjà plusieurs fois, dans les divers ministères intéressés et il y a de cela près de deux mois. Ils ont fait des propositions qui étaient les suivantes : il y a des mineurs qui chôment ; nous proposons de les envoyer dans les bois les plus proches des mines pour abattre le bois nécessaire au travail de la mine. Pour le transport ? Nous proposons de demander aux paysans des environs de mobiliser leurs véhicules et leurs chevaux pour amener le bois de mine et, en même temps, ils ramèneraient du charbon pour leurs localités. C’est tout juste si on n’a pas ri au nez de nos camarades en disant qu’ils faisaient des propositions enfantines.
Au scepticisme des dirigeants, nos camarades mineurs du Nord et du Pas de Calais ont pu faire la réponse suivante : c’est peut-être enfantin, ce que nous proposons, mais de 1914 à 1918, nous avons agi ainsi. Seulement, ont-ils ajouté, entre 1914 et 1918, il y a eu des directeurs de mines qui ont été emprisonnés par les Allemands, et de 1940 à 1944, il y eu des milliers de mineurs fusillés, il y en a eu des milliers de déportés, mais…pas un seul directeur de mine n’a été inquiété par les Allemands.
Nous nous sommes inquiétés de savoir si le bois de mine ne pouvait être transporté. J’ai reçu dans mon bureau un dirigeant de la SNCF. Il n’était évidemment pas très content parce que nous l’avions « asticoté » un peu et il m’a dit très franchement : « le bois de mine, nous pouvons le transporter des Landes dans le Nord et le Pas de Calais, nous mettons à ce service tous les wagons nécessaires, seulement, a-t-il ajouté, nous ne pouvons charger ces wagons parce que les marchands de bois et les propriétaires ne veulent pas vendre ; ils craignent une dévaluation des billets, ils craignent une crise financière.
N’importe lequel d’entre vous se fait la réflexion suivante : mais si c’est là le seul obstacle, qu’attend-on pour mettre la main au collet de ces saboteurs de l’économie française et pour leur confisquer leurs bois, purement et simplement.
C’est ce que vous pensez, c’est ce que pense tout bon Français, tout bon patriote, mais ce n’est pas encore ce qu’on pense dans les bureaux et dans les ministères.
Un autre exemple qui vous montrera comment on laisse aller les choses :
Ce bois de mine existe aussi dans l’Yonne. Il pouvait être amené par péniches, les mariniers ne demandaient pas mieux que de charger du bois et de travailler… Là l’obstacle ne vint pas des marchands de bois, il vint des organismes de répartition qui n’ont pas voulu donner les bons pour enlever les bois de mine vers les mines du Nord et du Pas-de-Calais.
Des exemples comme ceux-là, nous en avons des centaines et des milliers.
On nous sort aussi d’autres arguments pour expliquer la lenteur de la reprise : c’est que nous n’avons pas de grands moyens. Par exemple : s’il s’agit de lever des locomotives, de débarrasser des voies de garages, on vous déclare qu’on manque de moyens de levage perfectionnés. Mais quand on a une grue, comme à la gare de Longueau, on la fait travailler dix heures, alors que sous l’occupation boche, le même ingénieur la faisait travailler vingt-quatre heures par jour.
Cet argument : « manque de moyens », ne peut pas nous convaincre. Sans doute, l’absence de moyens perfectionnés, d’un outillage moderne dont on a l’habitude de se servir est gênante, mais ce n’est pas là un obstacle absolument infranchissable.
Nous connaissons d’ailleurs des cas en France où les ouvriers et les ingénieurs se sont passés de ces moyens modernes, même dans les chemins de fer.
A Saint-Pierre des Corps, par exemple, il n’y avait pas de grue pour lever les locomotives. Or, il y avait 27 locomotives dans des fossés et dans des trous, à la suite de bombardements. Eh bien, les techniciens, les ingénieurs et les ouvriers du dépôt de Saint Pierre des Corps, ont relevé les 27 locomotives avec des moyens élémentaires, avec des treuils, avec des vérins. Ils ont eu beaucoup plus de mal, beaucoup plus de peine à réaliser le travail, mais s’ils avaient attendu d’avoir une grue de 150 tonnes… ils attendraient encore la grue, et les 27 locomotives seraient dans les trous.
Nous pourrions donner d’autres exemples, qui montrent que, même avec des moyens rudimentaires, on peut faire beaucoup de choses.
Par exemple, quand nos amis de l’Union soviétique ont été contraints d’éloigner leurs industries de l’Ukraine et de les transporter dans l’Oural, ils ont aussi travaillé avec des moyens élémentaires. On construisait, en 1942, deux hauts fourneaux dans l’Oural. Pour la construction d’un de ces hauts fourneaux, il y avait des grues géantes, les grues les plus modernes, mais pour le deuxième qu’on construisait à côté, il n’y avait pas de grue, et pendant qu’on construisait le premier haut fourneau avec l’outillage technique le plus moderne, on construisait le deuxième en y mettant des milliers et des milliers d’hommes avec les plans inclinés que les Pharaons employaient pour construire les pyramides.
Est-ce que vous pensez qu’en Angleterre et aux États-Unis, pour arriver à la production industrielle, à la production de guerre actuelle, on a employé seulement des moyens de production ultra-modernes ? Sans doute, on les a employés, mais on a employé aussi les autres, on a mobilisé les hommes et les femmes. On pourra dire : en Angleterre et aux États-Unis, il y avait des possibilités que nous n’avons pas. C’est vrai, mais j’ai cité, tout à l’heure, l’Union soviétique qui a reconstruit son industrie dans l’Oural dans une période extrêmement difficile. Alors qu’elle avait, à elle seule, à supporter tout le poids de la machine de guerre allemande, alors qu’elle avait mobilisé des millions et des millions d’ouvriers qui étaient devenus des soldats, elle a mobilisé pour ses usines nouvelles, des millions de paysans et de femmes qui n’avaient jamais travaillé dans les usines et qui sont devenus rapidement d’excellents ouvriers et d’excellentes ouvrières.
En janvier 1942, alors qu’il y avait 40 et 50° au-dessous de zéro, on construisait dans l’Oural une usine d’automobiles. On montait des machines en plein vent, en même temps on construisait les murs, et cette usine d’automobiles, quatre mois après le début de sa construction, sortaient ses premières voitures. Elle a sorti aujourd’hui des milliers de camions et de voitures automobiles pour l’armée. Si, en Union soviétique, on s’était arrêté devant les difficultés que nous rencontrons nous-mêmes, qui sont moins grandes que celles qu’on trouvait en 1941 et en 1942 dans ce pays, eh bien, nous n’aurions pas le loisir de nos réunir aujourd’hui ici. Si on avait reculé devant les difficultés en Union soviétique, comme on recule dans certains milieux en France, nous serions encore, pour de longs mois et sans doute pour de longues années, sous la botte allemande et sous la dictature de Vichy.
Dans le bassin du Donetz, toutes les mines avaient été détruites, noyées – et ça n’est pas simple, ça n’est pas facile de remettre en état des mines qui ont été noyées – toute la grande industrie, la sidérurgie, avaient été sabotées, détruites, rasées. Moins d’une année après la libération du bassin du Donetz des centaines de puits de mines, 700 si mes souvenirs sont exacts, ont été remis en état. Les grandes usines métallurgiques et sidérurgiques de Vorochilovgrad, de Taganrog, de Staline commencent à produire en quantités importantes le matériel nécessaire à la conduite de la guerre.
Si nous avions nos mines noyées et notre industrie rasée comme elles l’étaient dans le bassin du Donetz, je me demande ce qui diraient ceux qui actuellement trouvent les difficultés insurmontables ? Sans doute, nous inviteraient-ils à nous coucher et à ne plus rien entreprendre.
L’épuration n’est pas faite
La deuxième raison pour laquelle ça ne va pas, c’est que l’épuration n’est pas faite.
La plupart, pour ne pas dire presque tous ceux qui ont collaboré avec l’ennemi, sont encore à la tête des usines et des grands services de l’État. Pendant quatre années ces hommes ont poussé à la production au service de l’envahisseur. Non pas comme ils le prétendent maintenant, parce qu’ils y étaient forcés – ce qui d’ailleurs serait un argument bien piètre et qui prouverait simplement qu’ils sont des lâches, car les ouvriers qui sabotaient avait été eux aussi mis en demeure de travailler pour l’ennemi – mais ils l’ont fait volontairement pour deux raisons :
La première, c’est que, pour eux, l’essentiel, c’est de réaliser du profit et ils en réalisaient avec les Allemands comme ils en réalisaient avant en travaillant pour la France.
La deuxième, c’est qu’un certain nombre de ces patrons n’ont jamais cessé de mettre leurs intérêts de classe au-dessus de l’intérêt de la nation et qu’ils voyaient dans la présence d’Hitler en France, et dans la dictature du gouvernement de Vichy, l’accomplissement de leurs vœux les plus chers. Ils avaient le régime de leur choix, ils avaient salué l’entrée de Hitler comme une délivrance, leur donnant la possibilité de mater les ouvriers, d’exercer cette revanche dont ils rêvaient depuis 1936.
Eh bien, ils sont encore dans les entreprises, et comment s’étonner, dans ce cas-là, qu’il n’y ait aucune initiative chez eux pour faire remarcher les entreprises ?
Ils ne souhaitent pas du tout que la vie économique reprenne chez nous. Il en est même qui disent ouvertement : « nous avions le régime de notre choix, nous ne sommes pas contents du tout de ce qui se passe en France et il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l’expérience actuelle échoue, et que nous revenions à la dictature, au Fascisme sans le nom ».
Dans les administrations, la plupart des éléments vichyssois sont restés en place. Et vous savez comment ont été formé les administrations sous Vichy. Sous Vichy…on faisait de l’ « épuration » ; il y avait des fameux comités d’organisation à la tête desquels se trouvaient la plupart des représentants des grands trusts et qui travaillaient sous la direction du trop fameux Bichelonne. Pendant les quelques années où ces hommes ont été en place, ils ont mis dans les grandes administrations de l’État tous leurs hommes, destinés à faire leur politique à eux, non seulement pour un mois ou pour un an, mais pour toujours, pour aussi longtemps qu’ils resteront dans cette administration.
Or, dans les administrations, on n’a fait à peu près aucun nettoyage. On retrouve ces hommes de Vichy dans les grands services et, en particulier, dans les services de la production industrielle, et un ami qui connait un peu la maison, me disait récemment qu’on parlait couramment, dans ces milieux, des « six cents ». Les « six cents » sont parait-il des ingénieurs et des techniciens que Bichelonne a placé là et qui ne sont pas au ministère pour développer la production de notre pays, mais pour freiner et pour saboter, alors qu’ils avaient pour mission de pousser à la production quand l’ennemi était présent.
Voici un autre cas tout à fait caractéristique : il y a à la direction des Établissements mécaniques de l’État, un certain monsieur qui s’appelle Brochard. Nous avons, sur ce monsieur Brochard – et les services ministériels les ont aussi – des rapports très complets concernant son activité pendant l’occupation. Il a durant ce temps, fait tout son possible pour que les arsenaux travaillent en faveur de l’ennemi ; il a, pendant l’occupation, donné en gage les arsenaux à certaines industries privées. Par exemple, à l’arsenal de Roanne, qui peut occuper 20.000 ouvriers, et dans lequel on fabriquait encore du matériel d’artillerie de 75, de 155 et une quantité très importante d’obus, toute une partie a été donnée en gérance à la SAGEM que vous connaissez bien. La SAGEM, a un contrat par lequel elle est payée suivant les dépenses qu’elle fait. Elle a été mise dans cet arsenal pour travailler pour le compte des Allemands, mais c’est l’État qui la payait. Elle était payée de la façon suivante : qu’elle travaille bien ou qu’elle travaille mal, cela n’avait pas d’importance, mais la SAGEM ne cherchait pas à travailler mal puisqu’elle travaillait pour les Allemands, la SAGEM touchait plus d’argent si elle dépensait plus. Le contrat est ainsi libellé que tous les frais, que toutes les dépenses faites par la SAGEM dans l’arsenal de Roanne, y compris les salaires, lui seront remboursées, et qu’elle touche comme bénéfice 6% sur les dépenses réalisées.
L’arsenal d’Irigny, à Lyon, possède l’usine la plus moderne pour le décolletage, les tours automatiques les plus modernes. En France, pas un seul atelier ne peut être comparé, et de loin, à l’arsenal d’Irigny pour le décolletage. On a passé le même contrat sous les Allemands, avec la firme Maturin, mais sans doute on avait des amis plus chers dans la firme Manurin, et le taux alloué sur les dépenses est passé de 6 à 8%.
Inutile de vous dire qu’aussi bien à l’arsenal de Roanne qu’à l’arsenal d’Irigny les dépenses sont allées leur train.
Les Allemands ont fait produire, ont fait travailler…ils n’ont pas toujours payé, mais Manurin et la SAGEM ont été payés… c’est l’État français qui payait.
Vous allez me dire : « Peut-être les choses ont changé depuis que les Allemands ne sont plus là ». Pas du tout, la SAGEM continue à Roanne et Manurin à Irigny.
Et savez-vous ce que la SAGEM fait à Roanne ? Elle avait une commande d’obus de 155 pour les Allemands. Eh bien, elle continue sa commande de 155 pour les Allemands.
Pour sa décharge, les gens de la SAGEM disent que ces obus peuvent être utilisés pour les 155 français avec une petite modification, mais, d’après le directeur de l’arsenal, il est bien problématique que l’on puisse utiliser ces obus, et quand nous demandons du matériel de guerre pour nos soldats à la manufacture de Roanne, on nous répond qu’on a du travail… puisqu’on fait des obus de 155 qui ne pourront pas servir.
A la manufacture nationale d’armes de Saint Etienne, les mêmes services de ce monsieur Brochard envoyaient le 5 octobre une lettre signée d’un certain M. Raffet, dans laquelle la direction est invitée à ne pas pousser la fabrication du fusil modèle 1936. Le fusil modèle 1936 est cependant le meilleur fusil de guerre. Mais on va à la place passer une commande de machines-outils.
Au même moment, en octobre, le général Billotte, qui met à l’entraînement une division de FFI de la région parisienne, se plaignait de ne pas avoir d’armes… Ces armes, c’est la manufacture nationale d’armes de Saint-Étienne qui devait précisément les lui fournir.
Il a fallu que ce soit nous-mêmes qui allions sur place, qui examinions avec la direction de cette manufacture – qui n’avait pas de mauvaise volonté d’ailleurs- la fabrication de fusils et qui prenions avec le directeur, en dehors de tous les ministères et contre M. Brochard, les mesures nécessaires pour développer la production des fusils dont les FFI avaient besoin.
Ce M. Brochard – les rapports l’indiquent avec des précisions – s’est signalé aussi pendant l’occupation par la façon dont il a poussé au départ des ouvriers en Allemagne. Il avait constitué, pour ce faire, un service spécial qu’on appelait le « service social » et qui s’en allait organiser des conférences dans les arsenaux pour démontrer aux ouvriers que leur intérêt était de partir en Allemagne, que c’était leur intérêt particulier et aussi… leur intérêt patriotique.
A la tête de ce service se trouvait un ingénieur qui s’appelle M. Carrougeau. C’est cet ingénieur qui a organisé ce service et qui a sur sa conscience la déportation d’un certain nombre d’ouvriers des arsenaux.
Savez-vous ce qu’il est devenu, Carrougeau ? Il est monté en grade : vous le trouvez maintenant directeur de l’arsenal de Levallois.
Ces quelques exemples que je vous donne n’épuisent pas le débat. Nous ne vous les donnons que pour vous montrer que les hommes de Vichy, que les « collaborateurs » sont encore en place, pas seulement dans les endroits que nous vous citons, mais un peu partout.
Eh bien, quand on donne des directions d’arsenaux à des hommes qui ont agi ainsi, qui ont trahi la nation, nomment peut-on penser qu’ils vont faire preuve d’initiatives pour fabriquer des armes qu’il s’agit de tourner contre ceux qu’ils ont servi pendant quatre années ? Comment peut-on penser que les arsenaux peuvent travailler à plein rendement, peuvent produire les armes nécessaires à nos FFI, quand, à leur tête, on laisse un M. Brochard qui a été mis là par un Bichelonne et qui s’est signalé pendant le temps qu’il a passé à la direction des Établissements mécaniques de l’état par une tournure d’esprit qui n’a rien de nationale, qui n’a rien de patriotique ?
L’épuration ? Son absence ne produit pas seulement des effets catastrophiques dans les arsenaux mais aussi dans les industries privées.
Par exemple, dans les mines. Si cela ne va pas dans les mines, s’il n’y a aucune initiative de la part de la direction minière pour trouver le bois de mine nécessaire, et qu’on pourrait trouver, c’est parce qu’il y a à la direction de ces mines les mêmes hommes qui, pendant quatre ans, ont forcé la production pour l’ennemi. Tous les mineurs sont unanimes à déclarer que pendant qu’ils travaillaient, eux, à réduire la production, ils étaient harcelés par la maîtrise. Jamais, comme pendant l’occupation la maîtrise des mines n’a été aussi insolente et brutale à l’égard des mineurs. Tous les moyens qu’on n’avait pas osé employer avant l’occupation pour pousser la production ont été utilisés. On a infligé des amendes comme jamais auparavant. Des mineurs étaient condamnés à des mises à pied de deux et trois jours et quelquefois plus, mais pendant la mise à pied, s’ils ne touchaient pas leur salaire, ils devaient continuer à travailler pour l’ennemi. Ils étaient injuriés et même parfois frappés par les porions ou par les ingénieurs.
Quand les ouvriers mineurs se mettaient en grève et que la Gestapo et l’armée allemande les pourchassaient, il y avait dans les directions des mines des directeurs qui donnaient les listes de noms de militants qu’ils avaient notés pendant la période de paix. Ils désignaient aux Allemands ceux qu’ils considéraient comme des meneurs. Il y a des dizaines, des centaines, pour ne pas dire des milliers de mineurs qui ont été dénoncés ainsi à la Gestapo et qui ont payé de leur vie leur lutte patriotique.
Les directions des mines collaboraient avec l’ennemi, les directions des mines ont, pendant quatre années, aidé l’ennemi à poursuivre l’exploitation des veines les plus riches, à plus grand rendement, dont on avait arrêté l’exploitation en 1936 pour pouvoir démontrer qu’avec la semaine de 40 heures la production minière baissait. On a mis, au profit des Allemands, nos exploitations minières dans un état lamentable, sans réparations ; on a négligé les travaux d’avancements, de sorte que, lorsque nous nous trouvons libérés, la production du charbon devient plus difficile. Même quand nous aurons épuré – j’espère bien que nous y arriverons – même quand nous aurons vaincu toutes les résistances, toutes les routines, nous nous trouverons, pour la production du charbon, en présence d’une situation qui sera bien plus difficile qu’elle ne l’était en 1939, parce qu’on a épuisé les veines les plus riches, qu’on a négligé les travaux courants et de réparation.
Ce sont ces dirigeants qui ont mené ce travail, tout en sachant très bien qu’ils allaient mettre la France dans une situation difficile après la Libération, qui sont encore à la tête des mines.
Il y a mieux que cela, il y a des interventions dont la répétition et l’insistance vont jusqu’à l’impudence, pour faire libérer certains malfaiteurs.
C’est ainsi que dans la Loire, les hommes de la Résistance qui ont eu la chance, comme dans beaucoup de provinces françaises, de rester pendant quelques semaines sans liaison avec le gouvernement… ont pu agir avec un peu plus de rigueur. Ils ont mis là-bas en prison un certain M. Perrin-Berthier, directeur des compagnies houillères.
Ce Perrin-Berthier a poursuivi l’exploitation des mines comme on l’a poursuivi partout ailleurs, aussi des quartiers entiers de certaines localités sont en danger : des maisons s’écroulent, d’autres s’affaissent, etc. Pour faire libérer M. Perrin-Berhier on a envoyé plusieurs délégations gouvernementales auprès du préfet de la Loire, notre ami Monjauvis. La première fois, Monjauvis a répondu : « Je ne libérerai pas Perrin-Berthier, il est en prison, il y restera. » La deuxième fois, les envoyés du gouvernement ont dit : « C’est une question gouvernementale ». – « Eh bien c’est entendu, a répondu notre ami, c’est une question gouvernementale. J’estime que Perrin-Berthier a mérité la prison. Si le gouvernement veut le sortir, il le sortira, mais moi je quitterai la préfecture. »
Et Perrin-Berthier est encore en prison. Heureusement, il n’est pas à Paris.
Quelles sont les conséquences de l’absence d’épuration dans les mines ? C’est que les mineurs qui ont lutté pendant quatre années avec le courage que chacun connaît, qui ont vu les traitres agir comme ils l’ont fait – et qui les voient encore autour d’eux – refusent de travailler avec de tels hommes. Qui le leur reprocherait ?
Quand un ingénieur qui s’est signalé par sa férocité à l’égard des mineurs pour les pousser au travail en faveur des Allemands est encore présent, quel courage peuvent avoir ces mineurs pour accroître la production ?
Mais dans certains cas, les mineurs ont fait eux-mêmes l’épuration. Dans les mines du Pas-de Calais, par exemple, un jour, les mineurs refusent de laisser descendre certains porions qui s’étaient particulièrement signalés pendant la répression. Toute la maîtrise s’est solidarisée avec ces porions. Les mineurs ont alors dit : « Vous ne voulez pas descendre ? C’est bien, nous descendrons et sans vous nous allons travailler. » Ils n’avaient pas de maitrise dans la mine, mais ils n’avaient aussi pas de traitres à côté d’eux, et la production a augmenté de 10,15 à 20%.
Partout où les mineurs ont pu réaliser l’opération, dans les puits – c’est un fait constaté par nos camarades – le rendement, la production, ont augmenté en moyenne de 25%.
Par conséquent, ne pas réaliser l’épuration, c’est empêcher le redressement économique, c’est créer du désordre dans le pays ; pour sauver des fripons, on conduit la France à la ruine, on conduit la France à la faillite.
Est-il admissible qu’il ait fallu à nos camarades de l’usine Carbone-Lorraine un mois et demi pour obtenir l’arrestation d’un homme qui avait donné une liste de 20 otages aux Allemands ? Ils ont multiplié des démarches auprès de tous les ministères intéressés : la Production et le Travail. Sur nos conseils, ils ont envoyé au gouvernement un acte d’accusation avec tous les faits reprochés à ce directeur, et malgré les preuves apportées de l’indignité et de la culpabilité de cet homme, il a fallu un mois et demi pour obtenir son arrestation.
Quand on constate des faits de ce genre, on peut penser qu’on ne crée pas l’enthousiasme nécessaire pour développer la production de notre pays. Ceux qui ne veulent pas faire l’épuration n’ignorent pas que l’absence d’épuration, au lieu de créer l’enthousiasme, crée le découragement.
D’autres choses se passent aussi, qui montrent avec quel état d’esprit on travaille dans certains milieux.
Nous avons eu l’occasion de parler de cette affaire de l’usine Denzel. Denzel, c’est une usine allemande où l’on répare des moteurs d’automobiles. Les camarades de cette usine sont venus me trouver et m‘ont dit : « C’est la meilleure usine en France, la mieux outillée pour la réparation des moteurs. Nous avons 800 moteurs Renault à réparer qui pourraient équiper les camions dont nous avons besoin pour le ravitaillement, les bois de mines et le charbon. »
Ces ouvriers s’étaient mis à réparer l’usine, dès le lendemain de la Libération. Il manquait quelques machines : ils en avaient trouvé d’autres pour les remplacer. Ils ont avancé 30.000 francs de leur caisse de solidarité pour acheter les courroies et, tout heureux, ils se disaient : « Dès que nous allons avoir le courant, l’usine pourra marcher ». Ils avaient désigné un administrateur et, pour une fois, le ministère de la Production avait fait son travail : il avait confirmé l’administrateur désigné… et puis, comme il faut tout de même un peu d’argent pour marcher, ils se rendirent à l’administration des Domaines pour demander les trois millions nécessaires à la mise en route de l’usine.
Aux Domaines, on a commencé par leur dire : « Mais de quel droit avez-vous désigné un administrateur ? Le ministère de la Production n’a rien à voir dans la chose, c’est l’affaire des Domaines, et c’est nous qui devons désigner un administrateur. » En même temps on leur promet les trois millions demandés.
Et…l’administrateur vient, mais…les trois millions ne viennent pas.
L’électricité arrive…l’administrateur ne peut faire brancher le courant parce que la compagnie lui demande 8000 francs qu’il n’a pas. Il ne peut faire mettre le gaz parce que la Compagnie du gaz lui demandait aussi un dépôt, et la même chose pour le téléphone et l’eau.
Comme cet administrateur avait décidé avec ses camarades d’embaucher un certain nombre d’ouvriers, une centaine, pour la reprise, ces ouvriers ne sont pas payés. Il a quelques économies, et il dépense ces économies pour permettre à ces ouvriers de vivre. Et c’est après des semaines de cette situation que le Directeur, l’administrateur et le contremaître de cette usine Denzel sont venus me trouver et m’ont expliqué cette histoire.
Il a fallu pour que ces ouvriers aient l’argent nécessaire pour réparer les 800 moteurs en souffrance, que nous posions publiquement la question.
Mais nous ne pouvons pas poser publiquement la question pour des milliers de cas semblables. Il nous faudrait des journaux immenses, les gens n’auraient plus le temps de lire tous les rapports que nous donnerions dans ces journaux.
SI l’on attend, si l’on ne réagit que chaque fois qu’une question est posée publiquement, et si le fait qu’on a posé une question publiquement n’entraîne pas les principaux responsables des administrations qui doivent s’occuper de ces choses, à examiner le problème dans son ensemble, c’est qu’il y a quelque chose de pourri dans la maison, et il faut opérer le nettoyage nécessaire.
La peur et le mépris des masses
La troisième raison pour laquelle ça ne va pas, c’est que dans ces milieux dont nous venons de parler, il y a la peur et le mépris des masses.
On ne fait pas appel à l’initiative populaire. Mais au contraire, chaque fois que les masses populaires, que les ouvriers d’une usine ou d’une localité ont pris des initiatives, on s’efforce de briser leur élan, de détruire leur enthousiasme.
Je veux rappeler ici les campagnes immondes qui ont été menées à propos des réalisations accomplies par les ouvriers et les techniciens de Montluçon et de Toulouse.
A Montluçon, au lendemain de la Libération, on n’avait pas de liaison avec le gouvernement… ça allait mieux. Les ouvriers, les techniciens, avec l’appui des comités de Libération et de l’ensemble de la population, ont mis à l’abri et à l’ombre neuf directeurs d’entreprises qui avaient collaboré avec l’ennemi. Ils les ont envoyés scier du bois pour l’hiver.
J’entendais tout à l’heure notre ami Hénaff dire qu’il faudrait mettre des pelles et des pioches entre les mains des 6000 détenus de Drancy. Eh bien ! voyez l’initiative populaire, elle n’attend pas longtemps pour trouver des solutions heureuses.
Les ouvriers de Montluçon, quand ils ont arrêté les neuf directeurs, ont pensé à leur faire faire un travail utile et ils les ont emmenés en forêt et leur ont fait débiter du bois.
Techniciens et ouvriers, avec l’appui du comité de Libération, ont nommé des directions dans les usines, et ces directions n’étaient pas composées de n’importe qui. J’ai eu l’occasion d’en voir certaines : dans l’une d’elles le directeur est l’ancien sous-directeur de l’entreprise, qui a été un résistant, et s’est déclaré absolument d’accord avec les ouvriers de l’usine et le comité de Libération pour mettre en prison le directeur qui avait trahi.
Ce nouveau directeur n’avait rien du « bolchevik ». C’est un ingénieur de talent, c’est un catholique fervent et pratiquant, mais c’est un patriote.
A la SAGEM, autre usine de Montluçon, on nomme aussi une nouvelle direction, choisie parmi les ingénieurs résistants. Et ainsi dans la plupart des usines de la ville.
Le résultat de cette entreprise ? C’est que deux ou trois jours après la Libération, les usines fonctionnaient en grande partie. Il restait encore quelques usines qui ne fonctionnaient pas. C’était parce qu’il y avait insuffisance de courant électrique, car des pylônes avaient été démolis par des patriotes pendant l’occupation et il fallait rebâtir. Pour la réparation de ces pylônes, la direction de la Compagnie d’électricité demandait trois semaines.
Le comté de Libération, avec l’appui de tous les ouvriers, décide de réparer les pylônes lui-même. Avec des gens qui n’étaient ni des techniciens, ni des professionnels et qui avaient des faibles moyens, en six jours les pylônes étaient remis en état.
Mais savez-vous pourquoi le directeur de la Compagnie d’électricité avait demandé trois semaines pour réparer ces pylônes ? Il se présentait alors comme un résistant. Il disait et essayait de prouver qu’il avait fait partie de la Résistance, mais quand nos camarades ont fouillé dans les archives de la société d’électricité, ils ont eu la preuve irréfutable que cet individu avait été un des meilleurs collaborateurs des Allemands…, et il continuait son travail en demandant trois semaines pour réparer des pylônes qu’on pouvait réparer en six jours.
Comment a-t-on jugé, en haut lieu, cette expérience de Montluçon ?
Quand nos amis sont venus pour essayer de régulariser leur situation dans les ministères, on a commencé par les accueillir de la façon suivante :
- Ah ! vous avez fait du beau travail. Vous avez « soviétisé » Montluçon.
Et au lieu d’examiner par quels moyens, par quelles méthodes, des ouvriers et des techniciens d’une ville industrielle comme Montluçon avaient pu remettre en route au bout de deux ou trois jours l’industrie de leur localité, au lieu de profiter de cette expérience, pour la région parisienne en particulier, on déchaîna contre eux la campagne la plus acharnée pour démontrer que ce n’était pas du patriotisme, mais du « soviétisme ». Et pendant des semaines, on a essayé de gêner leur expérience et de les empêcher de la mener à bien. On leur refusait des commandes, on leur refusait l’argent. Il a fallu de la part de ces camarades une ténacité et un patriotisme à toute épreuve pour se maintenir malgré tout à la direction des usines et pour les faire fonctionner.
Et, quand je suis allé à Montluçon, il y a quelque temps, c’est ce directeur de la grande usine Chatillon-Commentry, dont je vous entretenais tout à l’heure, qui est venu me trouver et qui m’a dit : « Je sais bien tout ce que l’on raconte sur notre expérience. Soviétisme ou pas soviétisme, moi je veux faire marcher mon usine et je vous demande de nous défendre ». Et comme je lui posais la question de savoir si on ne le gênerait pas par des difficultés financières, ce brave homme qui, il y a quelques mois, aurait considéré que prendre de l’argent dans une banque était un acte illégal, immoral, me dit la chose suivante et sans énervement, le plus tranquillement du monde, parce qu’il considérait que c’était un devoir d’agir ainsi : « Le directeur de la banque a voulu nous refuser de l’argent pour faire la paye de nos ouvriers, il a dû nous en donner parce que nous avions décidé de l’arrêter. »
On a fait la même campagne à propos de Toulouse, à propos de Berlier, c’est-à-dire partout où les ouvriers et les techniciens se sont mis d’accord pour réaliser la reprise économique.
Au lieu de faire appel à l’initiative des masses, à l’enthousiasme et au génie populaire, on s’est efforcé de les briser partout où ils se manifestaient. On a essayé de mettre à la « cadence » de la direction les ouvriers qui voulaient produire à la « cadence » de guerre.
Comment changer cela ? Parce qu’il faut changer cela.
Ce n’est pas parce que nous avons une administration routinière et qui manque de fois patriotique que nous devons nous contenter de faire ces constatations. Nous ne sommes pas des critiqueurs pour la critique, nous faisons la critique pour changer quelque chose, et quand nous avons fait la critique de quelque chose nous examinons les moyens de changer ce qui ne va pas.
Bousculer la routine
Faire pénétrer le souffle patriotique dans les plus hautes administrations
Première condition pour que cela change : bousculer la routine, faire pénétrer le souffle patriotique dans les plus hautes administrations. Il faut chasser des administrations tous les vestiges de Vichy parce que ce sont les hommes qui ont servi Vichy qui sont les principaux obstacles à la reprise économique. Ils créent des obstacles par tous les moyens et ils s’emploient à empêcher, à freiner l’initiative des masses. Et si on ne change pas ces hommes, si on ne fait pas place nette, si on n’épure pas, il sera très difficile d’établir les responsabilités.
Quand vous signalez un fait de sabotage ou d’incurie, je vous assure qu’il est très difficile de découvrir le véritable responsable. Vous pouvez remonter la filière de toutes les administrations, chacun de ceux à qui vous vous adresserez vous donnera de bonnes raisons et vous ne trouverez pas le responsable.
Quand on arrive à un tel état de choses, c’est que la machine a besoins d’être huilée un peu. Quand cela marche d’une telle façon, c’est qu’il faut bousculer tout. Si on n’est pas capable de trouver un responsable dans une administration, c’est que l’administration est pourrie, et nous ne pouvons pas, dans une période comme la nôtre, faire du bon travail avec de mauvaises administrations.
Il faut donner la responsabilité de la marche de notre économie à des hommes qui aient la foi patriotique. Il faut que les responsables de notre administration et des industries principales aient la même foi patriotique qu’avaient les Francs-Tireurs Partisans, les Forces Françaises de l’Intérieur lorsque ces hommes se battaient presque sans armes contre les Allemands et les miliciens de Darnand, armés jusqu’aux dents.
Il faut épurer avec rapidité et de fond en comble. Je ne parle pas ici de la chose sur laquelle nous avons tant à dire et dont Hénaff vous a entretenus tout à l’heure ; je veux parler de la répression des crimes contre la patrie : c’est tellement triste d’en parler quand on est à Paris ! On a, l’autre jour, exécuté un homme Suarez. C’est le premier à Paris… Mais on doit être effrayé de tant d’audace. Avoir exécuté un traitre ? … Je ne sais pas si on est près d’y revenir !
Je traite en ce moment de l’épuration nécessaire dans les entreprises et les administrations, ce qui évidemment, n’empêche pas que nous devons demander l’autre, la punition des traitres.
Ce qu’il faut aussi c’est réaliser les mesures dont vous a parlé tout à l’heure Hénaff.
De véritables nationalisations
C’est vrai qu’on nous a présenté des projets de nationalisation. Nous les avons examinés. Je dois vous dire que dans ces projets, je n’ai pas trouvé non plus le souffle patriotique qui doit susciter le grand élan vers la production industrielle chez nous : ils sont faits avec trop de timidité pour créer l’élan patriotique dans les masses.
Nous aurons l’occasion d’en parler, d’en montrer les quelques bons côtés et les nombreux mauvais côtés, mais une chose qu’on peut faire, tout de suite, c’est de confisquer les biens des traitres.
Je ne conçois pas, pour ma part, et je ne crois pas qu’il soit concevable pour un français patriote qu’on puisse hésiter à s’emparer des biens d’un traitre.
On a fait un projet de nationalisation pour l’usine Renault. Ce n’est pas la mort de Renault qui peut empêcher de poursuivre la réalisation des buts qu’on s’est assignés.
Pour Renault, il n’est pas nécessaire de faire des projets de nationalisation en prévoyant des indemnités. Le cas se pose de la façon suivante : Renault était-il, oui ou non, un traitre qui a servi l’ennemi ? Si Renault était un traitre, eh bien ! qu’on confisque l’usine et qu’on la mette au service de l’État et qu’elle devienne propriété de la nation tout entière.
Et le cas Renault peut s’appliquer à d’autres ; il peut s’appliquer aux compagnies minières. Je sais bien qu’on nous dira : « Mais dans les compagnies, en particulier – chez Renault aussi peut-être – il y a de petites gens qui ont des actions. »
Jamais personne d’entre nous ne s’est refusé à examiner le cas particulier des petits et moyens actionnaires, ni des gens qui n’ont pas trahi.
Pour le moment, nous demandons la confiscation des biens des traitres. Opérer cette confiscation, faire de ces biens la propriété collective de la nation, mettre à la direction de ces entreprises des hommes qui n’auraient pas la pensée de faire retourner ces biens, dans un laps de temps plus ou moins long, à leurs anciens propriétaires, mais qui soient animés plutôt d’une véritable foi patriotique, c’est assurer la production rapide de tout ce dont on a besoin.
S’appuyer sur le peuple
Il faut aussi, si nous voulons résoudre de très graves problèmes qui se posent devant nous, nous appuyer sur le peuple. Même s’il y avait à la direction de l’État des hommes pleins de bonne volonté, décidés à tout ce qu’il faut réaliser pour développer la production, le mépris de l’avis et de l’appui des masses populaires les empêcherait de surmonter les difficultés qu’ils rencontreraient.
Les hommes responsables de la direction de l’État ne peuvent pas voir tout ce qui se passe dans le pays : ils ne peuvent connaître tous les actes de sabotage ou toutes les routines qui s’opposent à la remise en marche de la machine. Seules, l’attention, la vigilance de millions d’hommes peuvent parvenir à déceler toutes les trahisons et toutes les routines. Seul, l’enthousiasme populaire peut permettre de surmonter les difficultés qui apparaissent, d’un bureau, insurmontables, et on ne fera rien de grand, rien de bon dans notre pays si on ne s’appuie pas sur le peuple.
Vous avez aujourd’hui entendu les rapports de camarades représentant les principales industries de la région parisienne ; hier, ces camarades se sont réunis et il y avait là, dans les assemblées, les secrétaires de bien des sections syndicales qui sont en contact avec les réalités, à la base.
Si nous voulons surmonter les difficultés, il faut que ces conférences ne soient pas sans lendemain. Les secrétaires de sections syndicales, les militants des entreprises ont un rôle capital à jouer pour surmonter les obstacles que nous rencontrons.
Ça ne va pas dans une entreprise ? Il ne faut pas se contenter de venir se plaindre à son syndicat. Il faut prendre soi-même l’initiative de rassembler les masses populaires pour exiger que cela change. Ça ne va pas dans l’usine de telle localité ? On freine le travail ? On enlève des machines – comme on l’a signalé dans certains rapports – pour les transporter en province ? On crée ainsi l’impossibilité de travailler dans cette usine ? Que les secrétaires de la section syndicale de cette usine ne se contentent pas de venir à la direction de leur propre syndicat. C’est eux-mêmes qui doivent aller trouver le comité de Libération de la localité, expliquer le cas de cette entreprise, aller trouver la municipalité et, avec le comité départemental de Libération, avec la municipalité, avec les Gardes civiques et républicaines, organiser une assemblée populaires où l’on dénoncera le sabotage qui se fait dans telle entreprise ; et l’on enverra ainsi des délégations de dizaines et de centaines d’hommes s’il le faut pour faire entendre la voix du peuple qui travaille.
Que chacun, dans sa propre sphère, dans sa propre usine, dans sa propre localité, soit un animateur et un dirigeant. SI nous voulons triompher des routines et changer quelque chose, ce sont des milliers, des centaines de milliers et des millions d’hommes qui doivent prendre les initiatives nécessaires pour bousculer tout cela.
Nous avons gagné la bataille de la Libération, mais chacun de vous sait très bien que cette lutte a été longue, douloureuse, qu’elle a demandé de l’énergie et du courage. Quand les premiers groupes de Francs-tireurs ont commencé à attaquer les Allemands, ils n’étaient pas nombreux, et il a fallu bousculer les vieilles idéologies et les vieilles traditions de ceux qui pensaient qu’il fallait attendre que les Alliés viennent nous délivrer.
Nous avons dû lutter aussi conter l’ « attentisme » pour arriver jusqu’à la grande insurrection parisienne. Cette bataille, nous l’avons gagnée, par un combat quotidien, difficile, douloureux. Nous avons laissé des centaines, des milliers des meilleurs des nôtres sur la route qui nous a menés de la première action, des premières actions de ces groupes de Francs-tireurs à l’insurrection nationale, mais nous ne nous sommes jamais découragés. Nous savions que nous allions à la victoire, que nous saperions l’« attentisme » et nous créerions dans notre peuple l’enthousiasme qui mène aux combats victorieux.
Aujourd’hui, le combat que nous avons à mener prend des formes différentes ; il est peut-être moins rude, moins douloureux que l’autre, il est aussi important. Gagner la bataille de la production est aussi important que gagner la bataille de la Libération. SI nous perdions la bataille de la production, nous perdrions le bénéfice de notre victoire et de la Libération. Nous laisserions les forces mauvaises, les forces de collaboration qui sont là, qui nous guettent, reprendre l’initiative, reprendre du « poil de la bête » dans notre pays. Cette bataille, nous devons la gagner en la menant avec toute l’énergie et toute la foi nécessaires aux grandes victoires. Que chacun d’entre vous se mobilise, que chacun d’entre vous pense qu’il a sa part à prendre dans ce combat, et si chacun d’entre vous a conscience de l’importance du rôle qu’il doit jouer, nous réussirons ce que nous avons réussi dans la bataille de la Libération, et c’est indispensable pour notre pays.
Cette intervention a été publiée dans le livre "La bataille de la production", recueil de textes de Benoit Frachon, publié par les Editions sociales sous le patronage de la Vie ouvrière en 1946
Elle est en partie reprise dans le livre "Au rythme des jours", disponible sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k34066348/f1.item
[1] Veni, Vidi, Vichy… et la suite de Raymond Brugère, complété d’une postface inédite d’Annie Lacroix-Riz, aux éditions de la Librairie Tropiques, 16 euros
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil