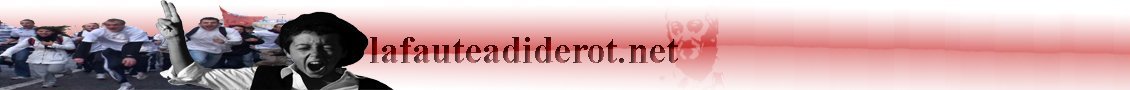
Intervention d’Henri Krasucki à la cloture de l’hommage à Benoît Frachon lors du 100e anniversaire de sa naissance. Conseil Fédéral de la fédération de la Métallurgie 9 et 10 décembre 1993.
Il y aurait des études, des livres à faire - certains existent déjà - mais il y a beaucoup plus à faire pour bien maîtriser, approfondir, l’apport de Benoît Frachon, personnellement et en le prenant dans son contexte, notamment son contexte collectif, parce qu’en réalité c’est toute une phalange de militants syndicalistes qui ont fait tout cela, y ont contribué.
Ce serait une erreur d’imaginer Benoît tout seul, un peu comme Jupiter avec des gens qui ne savent rien, mais non, il y avait des hommes et des femmes remarquables, des dirigeants de tout premier plan. On oublie trop leur existence et jusqu’à leurs noms malheureusement.
Roger (Linet) à l’instant, évoquait Racamon. Julien Racamon on ne sait pas qu’il a existé, il était avec Benoît Frachon, ils étaient deux membres, issus de la CGTU, dans le bureau confédéral de la CGT réunifiée en 1936. Ils avaient accepté d’être minoritaires, 2 sur 8.
Julien Racamon a été, avec Benoît Frachon, celui qui a joué le rôle le plus important dans la bataille pour l’unité. Je parle de Julien Racamon parce que peu de camarades se souviennent de lui.
Il y en a eu bien d’autres, heureusement.
Cela étant, Benoît était non seulement le plus représentatif, il a été le chef de file, celui qui était reconnu par tous, prenons-le au sens simple, fraternel, amical, comme "maître à penser", mais cela, dans toute une génération de militants remarquables, à différents niveaux de responsabilité. C’est tout cela qui mérite d’être étudié.
Je vais essayer de vous dire à la fois ce que j’ai préparé et de répondre aux questions, dans le temps qui nous reste.
Tout d’abord, ça va peut-être de soi, mais je pense que la fédération a été bien inspirée de consacrer une séance de son conseil fédéral à Benoît Frachon.
Rendre hommage à un militant, une si grande figure de la CGT, c’est autre chose qu’une cérémonie, encore qu’il faille savoir saluer des moments et des militants. Le meilleur hommage qu’on puisse rendre à Benoît pour le 100ème anniversaire de sa naissance, c’est de prendre le temps de cultiver la mémoire, de transmettre des connaissances qui sont nécessaires aujourd’hui et demain.
Par les temps tumultueux que nous vivons, les tentatives ne manquent pas pour brouiller l’image, les traces, défigurer notre itinéraire et, chez nous, le temps passant, on a besoin d’avoir la connaissance exacte de nos racines, de l’héritage exceptionnel qui est le nôtre.
Naturellement, rien ne peut dispenser chaque génération, de réfléchir, de chercher des solutions aux problèmes du temps présent et de savoir innover. Tout le monde, en son temps, a dû le faire et ça continue et ça continuera, mais on ne le fait pas de la même façon, avec la même sûreté et la même efficacité si l’on part de zéro, ou si l’on dispose d’un bon bagage d’expériences faites et de connaissances acquises.
Nous avons suffisamment à analyser et à trouver les bonnes réponses pour ne pas, en plus, nous croire obligés de redécouvrir le principe d’Archimède, ou que la terre tourne bien autour du soleil sans refaire le procès de Galilée, c’est fait ça, c’est connu et ça doit se transmettre. C’est valable, toute proportion gardée dans un domaine qui n’est quand même pas aussi strictement scientifique : l’activité sociale, la lutte syndicale. La connaissance, l’expérience, les choses déjà faites doivent servir à ça.
C’est impossible de ne jamais commettre d’erreurs. Essayons d’éviter de recommettre les mêmes, trouvons en d’originales, connaissant, sachant, ce qui a déjà été fait et aussi comment ça a été corrigé, ce qui a été déjà élaboré et prouvé, ne réinventons pas la poudre et ne recommençons pas des erreurs dont on a déjà tiré les conclusions.
Eh bien, il se trouve que Benoît Frachon est le dirigeant le plus marquant de l’histoire du syndicalisme français jusqu’à nos jours et l’une des plus grandes personnalités du mouvement syndical international. C’est sans doute dû à la conjonction de l’époque qu’il a traversée, de l’état et des besoins du mouvement, puis de ses qualités.
Cet homme n’est donc pas seul, mais le produit des batailles de toute nature qui agitaient le mouvement ouvrier tel qu’il était, dans une période de mûrissement, et ajoutons sans vanité ni mesquinerie : ce n’est pas défendu d’avoir une petite fierté qu’il ait été un métallo de profession - tourneur - mais aussi par son activité syndicale dans la fédération, et durablement tout au long de son existence. Mais cela dit, il appartient à l’ensemble de la CGT évidemment, et à l’ensemble des travailleurs de ce pays quelle que soit leur profession, mais enfin c’est un métallo quand même.
La période au cours de laquelle s’est déroulée l’activité de Benoît Frachon comme dirigeant national, est celle au cours de laquelle les travailleurs ont porté la part essentielle des conquêtes sociales qui ont constitué le niveau de vie, les garanties collectives, les droits sociaux, au degré le plus avancé qui ait été atteint par le monde du travail de notre pays. Je dis bien la part essentielle, parce que les luttes difficiles d’autrefois, du 19ème siècle et surtout de la fin du 19ème siècle et du début de ce siècle, n’ont pas été sans fruits, ne serait-ce que le droit de grève, le droit de faire les syndicats, et aussi parce que depuis, certaines conquêtes ont été acquises, il reste quand même, la retraite à 60 ans bien qu’elle soit menacée et la 5ème semaine, le reste a été fortement remis en question on le sait. Cela étant, c’est bien dans la période dont je parle que la part centrale, constituant et étoffant l’essentiel des droits sociaux s’est constituée, et cela s’est fait principalement à la faveur de puissants mouvements sociaux,
1936 les grèves et le Front Populaire, la Libération de la France grâce au rôle de la classe ouvrière et de la CGT, puis dans une mesure appréciable, 1968.
Entre temps, des acquis ont été également obtenus, mais c’est quand même sur ces 40 années que se concentre ce qu’on a fait de mieux, l’essentiel du code du Travail est là, et c’est précisément ça que le capitalisme en France et au plan international essaie de détruire pour nous ramener en arrière......
Donc je le signale, parce qu’on ne se rend pas toujours compte du coup d’œil d’ensemble. Je suis pour les anecdotes parce que ça rend plus vivant et plus direct, mais ayons la vue d’ensemble.
La vue d’ensemble, ça suppose d’avoir à l’esprit que c’est une période particulièrement féconde en élaboration des revendications, en conduite de luttes constantes et en utilisation des droits conquis : c’était une époque extraordinaire.
Ces luttes et ces conquêtes sociales se sont déroulées dans un contexte dont on ne peut les abstraire.
Cette même période, c’est mon deuxième point, a été fertile en événements de grande portée nationale et internationale, je ne fais que les énoncer : les suites de la première guerre mondiale, l’impact fantastique de la révolution d’octobre 1917 en Russie, la montée du fascisme et les luttes anti- fascistes, le Front Populaire, face à la guerre d’Espagne, face à Munich, la 2ème guerre mondiale, la Résistance et la victoire contre l’hitlérisme, la reconstruction du pays, la guerre froide, les guerres coloniales successives, le pouvoir présidentiel, et c’est dans le feu de ces événements qu’il a fallu trouver la voie pour l’action syndicale qui ne pouvait être indifférente à ces événements mais devait avoir son caractère spécifique de syndicat.
C’est donc dans cet ensemble de circonstances qu’ont été élaborées, affinées, mises en œuvre une conception, une pratique du syndicalisme CGT capable de répondre aux besoins de la lutte, aux besoins du monde du travail.
Cette phrase que je viens de prononcer se dit simplement, mais la chose apparaît autrement vaste et complexe si l’on a à l’esprit le seul énoncé des problèmes sociaux et des problèmes politiques que je viens de mentionner, et si l’on y ajoute le problème de l’état de la pensée et de la pratique du syndicalisme telle qu’elle était en quelque sorte au départ, et telle qu’elle a évolué, d’autant que tout cela s’est produit à travers des luttes d’idées internes, des conceptions opposées, des pesanteurs, trois scissions, deux réunifications et des débats au sein même des différents courants de pensée avec une constante : le besoin de l’unité.
On mesure mieux ainsi cette vaste œuvre collective qui a entraîné heureusement tant de participants et la portée de l’apport de Benoît qui a été le principal animateur, tant comme homme de pensée que comme homme d’action, ce qu’il fut indissociablement.
Analyser pleinement cet apport suscite un travail qui dépasse les limites de cette fin d’après-midi. Je veux simplement signaler, avant de répondre un peu à certaines des questions qui ont été posées, ce qui me parait décisif et le plus durable : l’apport de Benoît à l’évolution de la conception et de la pratique du syndicalisme en général et donc de la CGT.
On peut affirmer que Benoît, avec ses compagnons, mais lui principalement, élaborait les bases de la CGT et du syndicalisme moderne dont nous sommes les héritiers et les porteurs, et qui permet avec assurance toutes les adaptations et les transformations que la vie exige parce qu’elle ne reste jamais immobile.
Lui-même et ses générations ont su le faire, comme le disait Roger Silvain tout à l’heure, tout le monde à tout moment est amené à faire face aux réalités. Mais nous pouvons faire face à ces réalités nouvelles en nous appuyant sur un acquis de conception réel, élaboré, de ce qu’est le mouvement syndical, qui nous facilite drôlement les choses à condition de le maîtriser et de le comprendre profondément.
Je voudrais tout simplement essayer d’enchaîner en répondant à des questions, qui ont été posées par des camarades.
Par exemple, un camarade a demandé comment était perçue la division entre CGT et CGTU à l’époque.
C’est l’époque de mon enfance, mais d’une enfance dans un milieu de militants CGTU, alors donc dans le coup quand même...... Elle était perçue je dirais, avec l’état d’esprit, les mentalités, la façon de s’exprimer de ce temps-là, comme la division est toujours perçue par les travailleurs, comme elle l’est aussi aujourd’hui.
Les travailleurs n’aimaient pas à l’époque et ils n’aiment toujours pas que les syndicats soient divisés et ils aiment encore moins qu’ils se disputent. Pourtant il faut bien qu’on trouve le moyen de faire la clarté, c’est un des éléments, une des conditions de l’unité, il faut savoir ça.
Si la question posée est : comment les travailleurs percevaient : la division ? La réponse est : ils n’aimaient pas ça. Ils avaient leur choix pour une partie d’entre eux au moins, les uns étaient pour l’une des centrales, les autres étaient pour l’autre, dans des proportions variables selon les professions, au total ça ne faisait pas beaucoup d’adhérents tout compris, et pourtant des luttes.
En fait, comment a été menée la lutte pour l’unité ?
J’enchaîne avec cette question, parce qu’un camarade a dit, posant à la fois une question et émettant une opinion sur l’unité et sur la nécessité de faire la clarté, « est-ce qu’on peut la faire aujourd’hui comme en d’autres temps, est-ce qu’on s’y prend de la même façon, avec la même argumentation ? ».
En fait, il y avait une grande aspiration à l’unité parmi les travailleurs. Elle n’a pas toujours existé, en tout cas elle était latente, mais est arrivé un moment où les attaques anti-sociales, la crise, la menace fasciste grandissaient. Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, en France les forces fascistes prenaient le haut du pavé ou prétendaient le prendre. D’où la volonté chez les travailleurs de réagir et du coup le besoin d’unité.
C’est ce qu’ont su comprendre Benoît et ses compagnons en prenant la tête du mouvement pour l’unité, en répondant positivement et sans hésitation à l’aspiration des travailleurs : Oui, il faut l’unité, c’est vous qui avez raison, et avec toute l’argumentation....
Ils ont animé la poussée unitaire des travailleurs eux-mêmes dans les entreprises avant tout, et à travers le pays, partout où ils se trouvaient, tout en s’efforçant d’avoir les dialogues, difficiles avec les représentants de l’autre centrale syndicale et avec leurs dirigeants.
S’agissant de la manière d’argumenter, on ne peut jamais reproduire à l’identique ce qui s’est fait il y a 10,20 ou 50 ans. Le langage change, la façon de s’exprimer, tout change, là n’est pas le problème.
Mais s’agissant de Benoît Frachon particulièrement, je connais peu de dirigeants dont on puisse reproduire les textes tels quels si longtemps après sans qu’ils soient difficile à lire, parce qu’il avait le sens de la mesure et il pensait à la portée de ce qu’il disait et aussi au ton qu’il employait quand il s’adressait aux autres ou quand il argumentait pour faire la clarté.
Benoît Frachon était un homme de caractère, un homme ferme, énergique et qui savait s’exprimer avec vigueur, brillant polémiste, mais il s’efforçait de ne pas heurter ceux à qui il s’adressait, il ne parlait pas que pour les convaincus, il parlait pour ceux qu’il fallait essayer de convaincre et il le faisait à l’intention des membres de sa propre organisation et à l’intention des travailleurs qui faisaient confiance à une autre organisation.
C’est pourquoi, tout en rejoignant l’observation du camarade sur le fait qu’il faut employer le style de son époque, on peut retenir de l’expérience de Benoît Frachon ce souci de se faire comprendre sans fadeur, ce n’était pas le genre, mais avec politesse sans outrance, avec des arguments, ce qui me paraît très important dans l’expérience d’un dirigeant de ce niveau-là.
Pourtant, il savait évidemment à qui il avait affaire, encore qu’il ne mettait pas facilement tout le monde dans le même sac, y compris parmi ceux qui avaient des responsabilités dans d’autres organisations. Il s’efforçait d’avoir une opinion sur les hommes, ceux qu’il dénonçait avec une très grande vigueur et avec des raisons et des arguments, et puis ceux qu’il admettait comme différents, mais avec qui il fallait s’entendre et travailler.
J’ai ici le compte rendu intégral des deux congrès de la fédération de la métallurgie, celui de l’unité en 1936 et celui qui a suivi en 1938. Je les ai lus avec beaucoup d’intérêt. Benoît Frachon y participait, c’était sa Fédération, il était même membre élu des instances dirigeantes dans la fédération CGTU puis dans la Fédération réunifiée. Il faut voir la finesse et le sens de l’opportunité, le sens du geste à faire aussi pour favoriser l’unité, pour favoriser le vivre ensemble, il en était de même au niveau confédéral à cette époque.
Je peux dire, avec Livio Mascarello au moins, nous étions ensemble au bureau confédéral avec Benoît, que j’ai toujours connu Benoît comme ça, respectueux de ceux qui étaient autres.
Juste une petite anecdote au passage, en même temps ça contribue à situer l’homme. Après la Libération, donc pour l’unité refaite sur des bases un peu différentes qu’en 1936, Benoît Frachon a été le secrétaire général de la CGT. C’est sur sa proposition qu’il y a eu deux secrétaires généraux : Jouhaux avait été si longtemps secrétaire général de la CGT Benoît a dit : il faut qu’il reste secrétaire général de la CGT. Mais le secrétaire général c’était Benoît, c’était convenu comme ça.
A l’époque, l’accord qui avait fait la réunification stipulait une sorte de répartition moitié moitié dans le bureau confédéral, c’était déjà différent de 1936 où ils étaient 2 sur 8.
Benoît va faire une réunion à Marseille, il rencontre un militant, cheminot je crois, mais ça aurait pu être d’une autre profession, qui lui dit : alors, vous n’avez rien compris encore, je vous l’avais bien dit qu’ils vous trahiraient : en 1936 ils l’ont fait, et ça ne t’a pas suffi, tu remets ça, tu refais l’unité avec ces gens-là, ce Jouhaux etc... (C’était hors réunion). Et Benoît tranquillement -il avait beaucoup de maîtrise, il ne se fâchait pas facilement - lui répond : « Dis-moi, tu vis à combien de kilomètres de Paris toi ? Tu le vois souvent Jouhaux ? Tu ne l’as jamais vu, et tu te plains, moi je le vois tous les jours et je ne me plains pas ! »
Il avait une certaine idée de Jouhaux, il n’était pas naïf, mais il était unitaire et dirigeant. Il faut voir comment il se comportait pour que ça puisse se faire ensemble, loyalement et comment il s’exprimait dans ces conditions-là.
Un mot encore, juste à l’appui sur ce que Roger Linet a relaté de ses souvenirs à lui.
La lutte pour l’unité - je prends la lutte au sens débat, discussion, faire progresser les idées - a été un travail énorme de conviction.
Ceux qui s’imaginent que c’était tout bien d’un côté, tout mal de l’autre, n’ont pas raison non plus : ça a été compliqué partout, parce qu’il y avait du sectarisme partout, de l’étroitesse partout, de l’élitisme partout. Ce n’était pas le même, il y avait des comportements différents, une volonté délibérée de refuser l’unité du côté de l’organisation réformiste et donc une grande agressivité, puis des orientations qui correspondent à ce qu’était cette organisation.
Mais ce grand tournant a été possible parce que, s’appuyant sur la volonté unitaire des travailleurs et lui donnant un élan qui est devenu irrésistible, simultanément, Benoît et ses amis ont travaillé à faire dans leur propre organisation, dans la CGTU, l’effort de remise en question pour une vie syndicale qui corresponde à la nature d’un syndicat.
C’est à ce moment-là que le travail a commencé, au tout début des années 1930, ça a débouché en 1936, et les débats dont parlait Roger Linet se sont déroulées dans la CGTU elle-même. En quoi serait-ce anormal ? D’abord c’est vrai, ça s’est passé comme ça, et puis ça n’allait pas de soi, mais ça ne nous est pas indifférents à nous de le savoir, ça fait partie de la connaissance, de l’expérience.
Benoît a su, avec ses compagnons, poser les problèmes et débattre. Roger raconte sous forme d’une expérience vécue comment ça s’est passé avec Paris où il y avait certains dirigeants qui ne voulaient pas entendre parler de cette évolution-là, et comment ils se comportaient à l’égard de Benoît, ce que Benoît pouvait dire, comment il a réagi : il ne s’est pas fâché mais il a continué à argumenter et pris des mesures pour que le débat puisse avoir lieu.
Si j’insiste un peu sur cet aspect des choses, c’est simplement pour contribuer à cette intégration par nous tous, même ceux qui l’ont vécu ou qui le connaissent bien ont besoin de se le remémorer, à plus forte raison ceux pour qui c’est quand même assez ancien pour qu’ils ne l’aient pas connu.
Cela fait partie de notre héritage, avoir une vision correcte de ce que doit être la CGT, savoir en débattre et défendre ce point de vue dans la CGT elle-même et parmi les travailleurs et à l’égard des autres organisations, des militants des autres organisations.
Une bonne connaissance de cette expérience devrait nous faciliter les choses, donc faisons-la connaître ! Ça simplifierait bien des discussions parfois ou des hésitations, mais en même temps, comprenons que la vie est ainsi faite, même en connaissant très bien et d’une manière assez largement répandue son histoire, il y a des choses qui se renouvellent et auxquelles il faut constamment faire face de bonne manière, d’une façon efficace, sans renoncer à faire ce qu’on estime juste, mais en discutant pour convaincre et en s’appuyant sur les travailleurs.
Un camarade a posé une question sur la comparaison entre la crise 1936 et celle d’aujourd’hui. Naturellement c’est sans comparaison. La crise était grave, mais ce n’était pas la crise de toute la société, ce n’était pas la crise avec les dimensions internationales que nous connaissons aujourd’hui, c’était suffisamment difficile et dangereux mais il n’y a aucune comparaison. C’est une toute autre crise, les problèmes que nous avons à affronter aujourd’hui sont d’une autre nature, d’une autre dimension qui rend les choses plus difficiles ou qui impose un effort de réflexion et d’innovation naturellement dans les réponses, dans la façon de faire. Le salariat n’est pas non plus celui de cette époque-là, même les ouvriers de 1936 et les ouvriers d’aujourd’hui ce n’est pas la même chose.
On ne peut comparer que les phénomènes de fond, et là ça vaut la peine Il faut retenir les choses qui ont une utilité sur comment s’y prendre, dans quel sens travailler, avec quel style, quelle méthode, mais le reste il faut l’imaginer obligatoirement, il faut trouver les mots .... les solutions, les réponses.
Personne n’a écrit un livre de recettes, Benoît sourirait doucement s’il nous entendait. Imaginez qu’on puisse considérer qu’il a fabrique des recettes de cuisine !
Ensuite, quelqu’un a demandé ce qu’était l’argumentation de Benoît contre l’Union sacrée.
C’est après coup qu’il en a parlé. Au moment où ça s’est produit il était très jeune, il n’était pas encore le militant qu’il est devenu et il l’explique lui-même. Mais cela dit, il a argumenté, après coup, c’est- à-dire une fois la guerre terminée et avec une masse considérable de travailleurs qui a été déroutée par le comportement de la CGT, de ses dirigeants pendant la guerre et qui aspirait à un syndicalisme autrement combatif, et là il a contribué à la transformation du mouvement syndical et de ce qui était un courant combatif dans la CGT, qui avait un caractère de classe, et même un certain sens révolutionnaire mais quand même avec des mérites et des limites. L’anarcho syndicalisme est un courant qui a existé, qui continue, les grands courants de pensée à un degré ou à un autre ne disparaissent pas comme ça.
Benoît a contribué à transformer cela en une conception plus conséquente des réalités de la lutte de classes et à construire un syndicalisme correspondant à cette lutte de classe, non seulement se donnant pour but, mais cherchant des moyens mieux appropriés pour parvenir à ces objectifs de transformation sociale.
Une autre question porte sur la façon dont Benoît concevait, pratiquait ses responsabilités, d’une part politique de dirigeant communiste, et d’autre part de dirigeant de la CGT.
La réponse est assez simple, parce que le problème en fait n’est pas si compliqué que cela à condition qu’on ait des idées claires, de bon sens.
Le syndicat est une organisation qui se fixe pour tâche et comme nature de rassembler les travailleurs, non pas sur une base idéologique ou politique, mais sur la base de leurs intérêts en tant que salariés, sinon il faudrait faire un syndicat par parti, par religion, par école philosophique.
Le syndicat doit pouvoir les rassembler tous sur la base de leurs intérêts de salariés, ce qui ne le rend pas indifférent aux autres réalités de la vie d’une société mais avec une démarche qui correspond à sa nature d’organisation syndicale.
Benoît maîtrisait totalement la conception du syndicat et de sa nature, il en était profondément convaincu. En quelque sorte, il le vivait de l’intérieur, c’était une chose qui faisait partie de sa personnalité. Ce n’était pas une conviction comme ça, c’est beaucoup plus intime, pour lui le syndicat ça ne pouvait pas être autre chose que ce que je viens de dire. D’où les objectifs propres du syndicat, son indépendance indispensable, son mode de vie, la façon de vivre en commun, la tolérance mais aussi le souci de faire en sorte qu’il y ait dans la CGT non seulement un accueil à ceux qui ont, par ailleurs, ou en quoi que ce soit des opinions différentes et des choix différents, y compris avec le souci de l’expression de ces diversités à tous les niveaux des organismes dirigeants de la CGT, de l’entreprise jusqu’à la confédération et aux autres échelons du mouvement syndical. Il a pratiqué cela, même dans les moments les plus compliqués et les plus difficiles.
Cette conception du syndicat inclue la reconnaissance du droit de citoyen à chacun en dehors du syndicat, comme il est dit dans le préambule de nos statuts, de professer des opinions politiques et autres de son choix, sans être inquiété dans la CGT pour les idées qu’il peut avoir par ailleurs, il est libre.
Il était contre toute hypocrisie, lui-même il était, on le sait, un dirigeant de tout premier plan du parti communiste français. Mais il distinguait des organisations, il savait à quoi correspond un parti et à quoi correspond un syndicat. Il savait comment il fallait se comporter pour pouvoir être la CGT qu’il faut être, et dans son activité d’homme politique, il se comportait comme un homme politique.
Il respectait scrupuleusement et il distinguait les deux organisations qui sont de nature différente et qui doivent être indépendantes l’une de l’autre.
Dans son activité de dirigeant de la CGT, il raisonnait tout simplement en syndicaliste, avec sa façon de voir, ses idées de syndicaliste authentiquement révolutionnaire, mais comme on peut l’être dans un syndicat tel que la C.G.T., et ne cherchait pas à utiliser la CGT. Il proposait ce qui correspondait, son avis, à ce que la CGT devait faire, et il en débattait avec ceux qui avaient été élus avec lui pour la diriger. Il tenait soigneusement compte des opinions différentes de la sienne, il était très attentif à ce que pouvait penser, à propos de l’action de la CGT et des choses qui s’y discutaient, des militantes et des militants qui avaient d’autres idées et d’autres engagements politiques que les siens.
D’ailleurs, le plus fort, c’est ce qui s’est produit dans la Résistance. Les circonstances ont voulu que Benoît Frachon ait été l’un des deux dirigeants sur le sol national du Parti communiste français avec Jacques Duclos et simultanément il était celui qui a fait en sorte que la CGT vive, se développe et se réunifie dans la Résistance. Pas commode les deux, il l’a fait et il l’a fait en respectant et l’une et l’autre de ces organisations.
Il suffit de lire les V.O. clandestines dont il a été l’un des principaux rédacteurs, il y parlait CGT, et les initiatives pour l’activité de la CGT, il les prenait. C’est en pleine clandestinité qu’il a pris l’initiative de rechercher les contacts avec Jouhaux et avec les autres, les amis de Jouhaux, pour la réunification qui s’est faite en 1943, et elle s’est faite avec des hommes qui savaient que Benoît Frachon était simultanément le dirigeant du parti communiste dans la résistance. Personne n’a trouvé ça scandaleux, personne n’a eu l’idée de lui en faire grief, tout simplement parce que, même dans ces circonstances là il respectait le caractère spécifique de la CGT.
Il s’est trouvé en 1936 qu’une des conditions de la réunification était de renoncer au mandat politique, pour les membres de la direction confédérale seulement.
Benoît Frachon et ses amis n’ont pas été d’accord et ont argumenté jusqu’au bout avec cette idée-là, et à la différence des autres questions qui ont été négociées avant, sur lesquelles des solutions ont été trouvées - des concessions mutuelles sans quoi il n’y aurait pas eu d’unité-sur cette question Benoît, Racamon et les autres ont dit : on est des démocrates, on s’inclinera devant ce que décidera le congrès, mais on n’est pas d’accord et on défendra notre idée au congrès, parce que même si le congrès décide nous pensons que c’est une erreur.
Benoît a argumenté en expliquant pourquoi c’était légitime pour tout le monde, et que ce serait plutôt de l’hypocrisie, et priver les gens d’un droit de citoyen. Le congrès a tranché, il y a eu une majorité contre - vous vous rappelez au Bureau confédéral de la CGT réunifiée, j’ai dit 8 et 2. Le congrès a voté et démocratiquement Benoît Frachon et Julien Racamon se sont inclinés devant la décision du congrès mais en exprimant leur désaccord. Dans la pratique qu’est-ce qui se passait, eh bien la veille des réunions des instances du parti communiste Benoît Frachon allait trouver Léon Jouhaux, lui serrait la main, lui disait au revoir, il disait : demain tu sais où je suis. C’était purement formel. Cette disposition a été retirée de nos statuts au début des années 50.
C’est une précision qui peut être intéressante parce qu’il y a des camarades qui se posent cette question, mais effectivement s’il n’y a plus que ça pour faire l’unité ! Ce n’est pas ça la marque de l’indépendance d’une organisation. La marque de l’indépendance et du respect de l’indépendance, c’est la connaissance profonde de ce qu’est la CGT, le sens de la responsabilité envers la CGT et envers l’ensemble des travailleurs et se comporter d’une manière parfaitement loyale. A partir de là, la CGT, faisant ce qui est de son domaine, chacun est libre de s’exprimer en disant : ce n’est pas la CGT c’est autre chose, j’ai le droit.
Quelques mots, puisqu’on nous demandait de parler de l’homme.
Ce sont des petites anecdotes rapides et en vrac.
Je me souviens d’une réunion de la commission qui s’appelait encore "administrative" à l’époque et pas "exécutive" de la CGT, où Benoît qui s’emportait rarement s’est un peu emballé. Il avait eu des paroles désobligeantes à l’égard d’un camarade, ça ressemblait à une étiquette, injustifiée d’ailleurs, il ne s’en était pas rendu compte.
Quand il s’est rendu compte de ce qu’il avait dit, on était 30 ou 40 à l’époque, c’était une petite salle, il s’est levé et ostensiblement il est allé trouver le camarade pour lui présenter ses excuses.
Il y a eu des grands débats au comité confédéral national et dans des congrès confédéraux sur des grandes questions, des débats à la loyale, des débats où chacun disait carte sur table : « voilà je pense ça, » et ça discutait.
C’était des questions d’orientation qui séparaient des militants, parfois des organisations, attachées tous à la CGT, dont personne ne mettait en doute l’attachement à la CGT. Eh bien, comment ça se passait, la discussion était vive, parfois il y a des camarades qui ont un tempérament qui les porte à s’emballer, de la part de Benoît, toujours mesuré. Et puis à la pause avec les mêmes camarades qui s’opposaient dans la réflexion, on va boire un coup et on discute en bon militant de la CGT, attaché à la CGT, dont on ne doute pas de l’attachement à la CGT, mais ils ne sont pas d’accord, c’est autre chose et c’est tout.
J’ai connu Benoît moi-même très jeune, je peux témoigner de la façon dont il se comportait avec d’autres en général :
- simplement, pas de flatterie et pas de piédestal, d’égal à égal, de plain-pied, faisant en sorte de mettre le mieux possible les gens à l’aise. Il était impressionnant à cause de sa personnalité, mais il ne faisait rien pour impressionner et le maximum pour mettre à l’aise. C’était valable pour tous ses interlocuteurs, c’était un homme simple, très simple, grand lecteur, vaste culture, il aimait la pêche et puis il ne se prenait pas trop au sérieux, il savait blaguer et s’amuser, il n’aimait jouer aux cartes que si on pouvait tricher sinon il disait « ce n’est pas la peine, ce n’est pas intéressant ».
Chers camarades, je crois qu’il y a matière à lire, à interroger aussi, à réfléchir, à méditer, pas pour reproduire purement et simplement mais pour savoir utiliser tout ce qui est bon, tout ce qui est acquis pour faire face comme on a pu le faire dans le passé, aux problèmes d’aujourd’hui. C’est ça le message de Benoît à mon sens.
Ce document nous a été transmis par Christian Langeois pour : il s’agit d’une transcription de l’intervention qui en conserve le caractère oral. Elle a dû être relue par Henri puisqu’elle figure dans ses archives.
Archives de l’IHS CGT 7CFD 256
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil