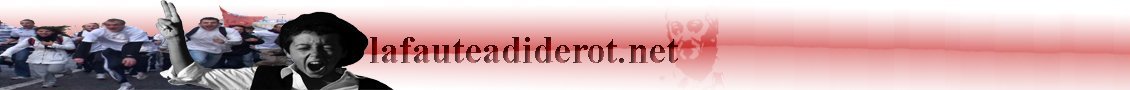
J’ai intitulé mon dernier essai Le Jardin public, pour une morale de la vie commune. C’est évidemment une allusion à Epicure dont le groupe de philosophes était appelé l’Ecole du Jardin. Il y a de mon point de vue beaucoup à prendre dans la philosophie de ces penseurs antiques.
Cette forme de sagesse sui était la leur n’a pas perdu toute actualité, mais les épicuriens, à la différence d’ailleurs des stoïciens, refusaient la politique, s’en méfiaient, s’en écartaient. Je pense qu’aujourd’hui, on ne peut pas aborder cette question du bonheur individuel, du bonheur collectif a fortiori, sans se mêler de la chose publique. Donc je parle d’un jardin public. Ce n’est pas vraiment une conférence que je vais faire... ce sera plutôt une « circonférence », car je vais faire un petit tour d’horizon dont j’essaierai qu’il soit rapide, en abordant les questions annoncées sous l’angle de deux expériences : d’abord, les expériences faites au nom du socialisme au cours du vingtième siècle et puis l’expérience que nous vivons aujourd’hui dans notre société.
Pour aller droit au but, je dirais que, finalement, nous avons connu, (vous m’excuserez de la simplification sans doute outrancière à laquelle je vais me livrer), sous cette forme de socialisme au collectif contre l’individu, et aujourd’hui, dans les sociétés capitalistes à l’individu contre le collectif. On pourrait imaginer que l’humanité, à un stade supérieur de son développement, réussisse à concilier de manière heureuse individu et collectivité. Nous n’en sommes pas encore là, visiblement, et ça pose des questions, des questions philosophiques, des questions pratiques, des questions politiques, des questions aussi pour moi poétiques, j’en dirai un mot à la fin de mon petit propos et vous m’autoriserez peut-être, avant que nous nous séparions, à vous lire quelques poèmes.
Ce livre que j’ai publié chez Delga, éditeur d’ouvrages théoriques, politiques, historiques, philosophiques, est un livre que j’ai écrit pendant la période du confinement, qui nous avait donné la grande liberté, en nous emprisonnant, de lire, d’écrire, de penser. Les éditeurs ont d’ailleurs été submergés de manuscrits à l’issue du confinement. Je n’ai pas échappé à la règle…. J’en ai profité pour écrire un livre un peu singulier qui s’organise de la manière suivante : sur les pages de gauche il y a des textes de caractère disons un peu théorique, de réflexion, et sur les pages de droite, des poèmes qui tournent autour de cette question que je viens d’énoncer.
Alors, d’abord, un mot sur cette expérience socialiste et révolutionnaire du vingtième siècle, expérience à la fois formidable qui a suscité d’énormes enthousiasmes, de grandes espérances et expérience dont on doit dire qu’elle a été traumatique du point de vue du collectif, à la fois parce qu’elle s’est faite dans des conditions terribles, avec souvent un coût humain énorme, mais aussi parce que elle a abouti, en tout cas pour partie, à un échec, même si cet échec, comme me le faisait remarquer Henri Lefebvre [1] est un échec relatif.
Avec le sens de la dialectique qui le caractérisait, en 1990, c’est-à-dire juste après la chute du mur et alors que tout le monde considérait que cette histoire était terminée, qu’il fallait tourner la page, il me disait : « c’est un échec et ce n’est pas un échec ». C’est plus qu’une affirmation ; une vision dialectique, disons nuancée, qui a le sens des contradictions et de l’évolution des choses.
Pour ce qui concerne l’Union Soviétique, le pays qui a joué le rôle phare dans cette aventure, puisque c’est celui qui a le premier tenté d’ouvrir la voie d’une société non capitaliste avec la révolution d’octobre, de 1917, la façon dont ça s’est terminé a remis en cause beaucoup de certitudes partout, dans les rangs de la gauche notamment, et pas seulement chez les communistes. Effets dont nous continuons à vivre les conséquences et le ressac, y compris quand on voit la résurgence, partout de l’extrême droite et des idées fascistes et racistes.
C’est un contrecoup de la fin de l’Union soviétique. Cet échec final de l’histoire soviétique, en tout cas l’abandon du projet socialiste par les Russes eux-mêmes, a nourri l’idée que, finalement, tout cela relevait de la plus parfaite utopie. Beaucoup de gens, je crois que c’est même sans doute le sentiment du commun des mortels, considèrent que, finalement, tout cela montre que la nature humaine n’est pas prête pour une société égalitaire, puisque l’objectif était de fonder une société égalitaire procédant de l’appropriation collective et sociale des moyens de production et dans laquelle hommes et femmes auraient non seulement des droits égaux, mais même des conditions matérielles, sociales, professionnelles, culturelles, comparables et égales.
D’une certaine façon, à posteriori, ça semble donner raison aux réserves qu’exprimait un certain Sigmund Freud. Parce que Freud, je parle ici dans un lieu où évidemment le nom de Freud doit résonner, a suivi avec intérêt la Révolution d’Octobre et les premiers temps du socialisme, mais il exprimait un certain scepticisme. Je vais vous lire juste un passage, extrait de son livre « Malaise dans la civilisation » ; deux petites phrases de Freud :
« L’homme n’est pas cet être débonnaire au cœur assoiffé d’amour dont on dit qu’il se défend quand on l’attaque, mais un être qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne dose d’agressivité.
Ça, c’est une assertion à laquelle on peut aisément souscrire.
Et il ajoute : « Les bolchéviks, eux aussi, espèrent qu’ils sauront faire disparaître l’agressivité humaine, en garantissant la satisfaction des besoins matériels et, par ailleurs, en instaurant l’égalité parmi les membres de la société. Je tiens cela pour une illusion. »
C’est donc une sorte de critique historique ante rem produite par Freud.
Je veux vous dire d’emblée que je ne souscris pas à cette idée que je viens de d’énoncer là avec Freud. Non pas que je conteste le fond de son affirmation sur la nature humaine. Ala question que pose Diderot dans sa fameuse pièce : « Est-il bon, est-il méchant ? », vous savez, Marx lui-même se garde bien de répondre. Il n’est pas rousseauiste, il ne dit pas : « l’homme est bon naturellement et c’est la société qui le pervertit ». Il ne dit pas non plus que l’homme est méchant fondamentalement, et qu’il faut lui serrer la vis pour qu’il marche droit. Pour Marx, l’homme n’est ni bon ni méchant, il est ce qu’il fait et ce qu’il se fait. Pour reprendre une formule qui est celle d’un grand marxiste, le philosophe italien Antonio Gramsci [2]
Ça définit de manière très précise le fondement même de ce qu’on pourra appeler « l’humanisme marxiste ». Le fond de la pensée de Marx, c’est que l’homme, en produisant ses conditions d’existence se produit. Je vois pour ma part dans cette idée le fondement du fait que, contrairement à ce que l’on croit souvent, le marxisme est fondamentalement une pensée non pas de la liberté, mais de la libération, puisque l’homme se produit lui-même.
Si vous m’autorisez à utiliser un vocabulaire qui n’est pas vraiment un vocabulaire marxiste, avec le marxisme la « créature » se fait créatrice de sa propre existence. Plus besoin d’un père éternel pour expliquer votre présence sur terre.
L’homme se produit, l’homme au sens de l’humanité, l’homme au sens générique ; il se produit au cours de ce processus qui produit ses conditions d’existence par le travail, par la société, etc.
Et c’est donc le fondement de sa possibilité d’évolution et de libération, d’auto-libération. Il y a là comme une sorte d’auto-transcendance dans le marxisme : l’humanité elle-même est potentiellement maîtresse de son destin.
Mais l’idée que Marx se faisait de l’histoire passait par des médiations. Après avoir commencé par produire une critique de la philosophie de son temps, critique de la Philosophie du droit de Hegel notamment, vous savez qu’il s’est assez vite plongé dans l’action politique avec son camarade Engels puisqu’ils ont rallié la Ligue des Justes qui était un groupe de gens très à gauche, des communistes utopiques allemands en exil pour beaucoup d’entre eux. Ils se sont impliqués dans ce petit mouvement, et ils leur auront fait changer leur devise. Leur devise était : « Tous les hommes sont frères » et ils leur ont fait adopter lors d’un congrès une autre devise : « Prolétaires de tous les pays unissez-vous ».
Non pas que Marx et Engels fussent contre la fraternité humaine, mais pour eux, dans la société capitaliste ce n’est pas vrai, tous les hommes ne sont pas frères. Entre exploiteur et exploité, oppresseur et opprimé il y a des rapports qui ne sont pas de simples rapports de fraternité. Et pour que les hommes soient vraiment frères il faut transformer les rapports sociaux, les rapports économiques, les rapports de propriété, les rapports politiques et procéder à la révolution. Ce qui fait que Marx s’est très vite appliqué à l’étude des questions économiques pour comprendre les mécanismes du capitalisme. Ça ne l’a pas amené du coup à abandonner ses convictions philosophiques du départ, notamment le début de réflexion philosophique qu’il avait engagé sur les questions de l’aliénation et donc de la liberté, puisque le philosophe qui pense les problèmes de l’aliénation pense les conditions de la liberté. Mais il a voulu ensuite passer en quelque sorte aux travaux pratiques pour produire, non pas un manuel d’économie politique, (le Capital n’est pas du tout un manuel d’économie politique, c’est une critique de l’économie politique), et donner ainsi des instruments qu’il espérait utiles pour les ouvriers de son de l’époque et du temps qui suivrait.
Et je dois dire d’ailleurs que, pour l’essentiel, y compris pour des gens qui sont très très loin d’avoir des idées marxistes, la critique, l’analyse du capitalisme par Marx reste scientifiquement tout à fait solide et pas du tout infirmée par l’évolution la plus moderne du capitalisme.Dans le développement de cette analyse, il a développé une conception qui est celle qu’on a appelée « matérialisme historique », d’après laquelle, pour comprendre ce qui se passe dans une société, il faut s’intéresser à l’arrière-cuisine en quelque sorte, pas simplement au devant de la scène, mais aussi à ce qui se passe au fond des cales, du côté de la production, l’inconscient de la société qu’est l’économie, la production justement matérielle.
Tout ça pour dire que je ne souscris pas à l’idée que ce serait la nature humaine, les faiblesses de la nature humaine qui expliqueraient l’échec final du socialisme. Il y a en fait, des causes, des causes que dans un vieux vocabulaire marxiste on appellerait objectives, historiques, politiques, économiques, par exemple.
L’arriération initiale des pays qui se sont tous engagés dans la voie du socialisme explique beaucoup de choses, elle explique notamment que cette histoire s’est faite au forceps. Marx avait imaginé que c’est dans les pays capitalistes les plus développés, comme l’Angleterre par exemple, que le capitalisme développant ses contradictions, à un moment s’imposerait l’idée de la nécessité d’aller plus loin vers une société plus civilisée qui serait le socialisme. Mais l’histoire est toujours capricieuse, elle ne se passe jamais exactement comme on le prévoit et, en fait ça ne s’est pas passé comme ça… Au contraire, la question du socialisme s’est posée comme une question urgente dans les pays qui étaient non pas les pays les plus retardataires, mais des pays où le développement du capitalisme était très récent et qui étaient, pour reprendre la formule de Lénine des « maillons faibles », là où il était possible de faire la révolution, comme en Russie, puis ça s’est généralisé dans les pays d’orient, la Chine puis après jusqu’à Cuba. Des pays qui n’étaient pas mûrs théoriquement, d’ailleurs des savants marxistes de l’époque comme Plekhanov disaient : « c’est pas mûr pour faire la révolution ». D’une certaine façon, il avait raison, il avait raison mais Lénine pensait qu’il ne fallait pas s’arrêter à l’orthodoxie des professeurs de marxisme et qu’il fallait répondre aux questions urgentes de l’heure et y répondre avec les moyens de la révolution : la terre aux paysans, la paix etc. En fait cette arriération, ce retard, explique beaucoup de choses, parce que ça veut dire que, dans tous ces pays, le socialisme a dû s’atteler à des tâches historiques qui, normalement, sont celles du capitalisme. Par exemple l’accumulation primitive pour fonder une économie, une industrie lourde, pour industrialiser le pays, avec tout ce que ça a représenté dans des pays comme la France, l’Angleterre… L’accumulation primitive, c’était le travail des enfants dans des mines, par exemple, les enclosures en Angleterre, c’était une exploitation féroce au dix-neuvième siècle, mais sur quoi s’est bâtie la richesse du capitalisme moderne, sans oublier la traite négrière, l’esclavage, l’exploitation des colonies, qui sont quand même à la source et qui restent au fondement de la richesse de nos sociétés, puisqu’on continue à exploiter l’essentiel du reste du monde. Mais ce retard a expliqué quand même que le socialisme n’ait pas les traits souriants qu’espérait Marx. Ajoutez à cela le contexte historique : la guerre civile, l’hostilité permanente des pays capitalistes, les interventions étrangères et la course aux armements qui s’est poursuivie, qui a fini par mettre à genoux un pays comme l’Union Soviétique qui consacrait une partie très importante de son budget à l’armement, pour rivaliser avec les Américains et au détriment du bien-être, du progrès social du pays.
Donc il y a des causes objectives qui sont majeures, je dis ça parce que je crois que ce serait faire preuve de beaucoup d’idéalisme de penser que c’est, par exemple, la paranoïa de Staline, ses défauts personnels, l’insuffisance des hommes qui expliquent cette histoire. Non, il y a des causes qui dépassent les défauts individuels de tel ou tel.
Ça ne veut pas dire pour autant que la remarque de Freud soit à jeter aux orties parce qu’en même temps on peut considérer, c’est en tous cas ce que je crois, que l’ignorance et le mépris, pour ne pas dire l’hostilité franche et déclarée dont ont fait preuve la plupart des marxistes, notamment soviétiques, à l’égard de la psychanalyse leur a coûté cher. Ils auraient gagné à plus de réalisme et une meilleure connaissance de l’âme humaine, pour utiliser un terme qui peut paraître pas très marxiste, mais auquel je tiens.
Il y a eu un certain nombre de penseurs quand même qui ont travaillé ces questions depuis longtemps. Politzer [3], par exemple, qui avait suivi le séminaire de Freud à Vienne est un philosophe marxiste qui n’a pas pu produire l’œuvre aurait peut-être pu produire parce qu’il a été tué par les nazis pendant la guerre. Il avait commencé à y réfléchir. Il a été l’un des introducteurs, d’une certaine façon, de la psychanalyse en France, et aussi un de ses premiers critiques en vérité puisqu’il essayait de fonder, lui, une psychologie concrète. Il était passionné par le travail de Freud quand Freud s’occupait de cas particuliers, en tant que praticien en quelque sorte. Mais il était très réservé sur les concepts philosophiques développés par Freud, notamment sur l’application de ces concepts au-delà des cas analytiques, individuel, à l’explication de la société.
Mais il y a d’autres penseurs qui y ont travaillé , comme Wilhelm Reich qui a fini d’une manière un peu délirante, mais qui avait suivi de très près les débuts de la révolution d’octobre et qui a écrit un livre passionnant qui s’appelle « Révolution sexuelle », Marcuse qui a pensé avec les outils du marxisme mais aussi de la psychanalyse la condition de l’homme moderne dans la société capitaliste développée, dans la société dite de consommation notamment dans son livre « L’homme unidimensionnel » [4].
Un autre penseur auquel, j’accorde beaucoup d’intérêt et d’importance Erich Fromm [5], je pense que c’est celui qui a le mieux opéré la synthèse entre marxisme et psychanalyse. Mais bon, malgré tous les travaux qu’ont produit ces penseurs, pour l’essentiel cette question de la prise en compte de la psyché individuelle n’a pas été au centre des préoccupations, parce que le train des préoccupations, c’était de bâtir des économies, atteindre une certaine prospérité,de construire des Etats forts, etc.
Disons simplement que la question de la singularité des individus, de la liberté individuelle, du développement individuel, a souvent été plus que laissée de côté. Elle a été souvent sacrifiée purement et simplement. On peut en comprendre les raisons. Je travaille actuellement sur les textes de Ho Chi Minh le révolutionnaire vietnamien, et bien dans ses textes il ne cesse de mettre en garde contre l’individualisme. Pourquoi ? parce qu’il faut battre les colonialistes français, il faut mener la guerre, il faut battre les Américains, il faut construire une économie, et donc il n’y a pas beaucoup de place laissée pour l’épanouissement disons de la singularité des individus. Dans ce cadre-là très contraint on peut comprendre comment cette histoire s’est faite au forceps pour reprendre mon image initiale.
On a même vu d’ailleurs, dans ce contexte apparaître des idées singulières, par exemple l’idée qui s’est affirmée qu’il fallait un « homme nouveau ». C’était une idée singulière parce que les marxistes voulaient changer la société pour que l’homme puisse changer, mais pour changer la société ils se sont mis en tête de changer l’homme et de créer un homme nouveau, ce qui n’est pas chez Marx. Pas du tout. Alors cet homme nouveau devait être une sorte de super-héros du travail socialiste, le prototype c’était le mineur du Donbass qui s’appelait Andrei Stakhanov, d’où vient le mot « stakhanoviste ». En Chine ils en ont eu un autre qui s’appelait Lei Feng, un jeune soldat qui remplissait un carnet dans lequel il notait toutes les bonnes actions qu’il faisait pour servir le peuple selon les principes du président Mao. Gagarine à sa façon, le premier homme dans l’espace, était aussi une incarnation de cet homme nouveau : fils d’une laitière et d’un charpentier, premier homme envoyé dans l’espace, il a été d’ailleurs un peu pendant des années « l’ambassadeur » du monde soviétique.
C’est une histoire que l’on peut comprendre, qu’il faut essayer de comprendre et qui, à mon avis, ne mérite pas du tout d’être traitée avec dédain et désinvolture parce que c’est une histoire humaine tragique, à la fois grandiose et tragique.
En même temps, comme disait Brecht, qui est un grand penseur moraliste au sein du marxisme, « malheureux les pays qui ont besoin de héros » parce que Brecht avait cette sagesse, ce réalisme, de considérer qu’il ne fallait pas fonder la société nouvelle sur l’homme parfait. Il fallait accepter l’homme tel qu’il est, avec ses contradictions, ses pulsions contraires, comme diraient les amis de l’APPS, et oui, les pulsions contraires, on y est tous sujets. Pour ma part, j’utilise une image qui dit : « l’homme est une contradiction en marche ». « En marche » parce qu’on ne reste pas sur place, mais on est tous pétris de contradictions, on est à la fois gai et triste, on est courageux et lâche, on est travailleur et fainéant, on a besoin du jour et de la nuit.
Notre vie est une vie de contradictions, nous passons sans cesse d’une contradiction à l’autre, dans la vie pratique nous vivons alternativement ces phases en général. Et nous les surmontons, ça nous aide à avancer, à marcher, à mettre un pied devant l’autre.Dans la pensée on essaye de les conceptualiser. Dans la poésie on essaye de les exprimer ensemble, ces contradictions. Quand on ne réussit pas à les surmonter ça peut provoquer sans doute des souffrances dans le mental, c’est évident. Donc la prise en compte de ces contradictions et non pas leur négation comme la tentation en a existé est évidemment essentielle, on peut dire, en effet, que cette figure de l’homme nouveau était une manifestation d’idéalisme de la part de gens qui se voulaient matérialistes en philosophie.
Et très curieusement pour des communistes qui se voulaient dialecticiens, c’est-à-dire partisans d’une philosophie de la contradiction prenant en compte la contradiction du réel, cette histoire réelle des révolutions a produit des dialecticiens qui refusaient la contradiction. D’ailleurs qui refusaient des oppositions souvent, ce qui est une raison de fond, à mon avis, même peut-être la raison politique essentielle de la chute des pays socialistes. Rosa Luxembourg pensait qu’il fallait une complète liberté d’expression et s’il n’y avait pas cette liberté d’expression, la vie politique dépérirait et on se retrouverait dans une situation ou quelques dirigeants, du haut des tribunes, exhorteraient le peuple à accomplir des exploits et la masse des gens resterait passive : C’est ce qui s’est passé en réalité : la dépolitisation des gens, du fait de la mort de la liberté de la discussion, de liberté de la critique
Quand y a pas de contradiction ça meurt, tout simplement.
Je voudrais juste dire que de ce point de vue, pour revenir à Marx, je disais tout à l’heure que pour Marx l’homme n’était ni bon ni méchant, qu’il était ce qu’il se faisait, ce qu’il se produisait.On a beaucoup glosé sur une thèse de Marx dont je parlais avec Dominique tout à l’heure en venant, la sixième thèse sur Feuerbach, puisque Feuerbach est un grand philosophe matérialiste allemand qui avait notamment critiqué la religion. Marx doit beaucoup à Feuerbach, en même temps il trouvait qu’il avait une vision de l’homme trop générale, l’homme générique, en quelque sorte, l’homme abstrait avec un grand H. L’homme abstrait avec un grand H ça incluait les femmes, mais ça exclut quand même la réalité des femmes et des hommes aussi, c’est une vision que Marx avait raison de critiquer. Pour répondre à Feuerbach, il disait : « l’essence de l’homme, c’est l’ensemble de ses rapports sociaux. » C’est ce que dit cette fameuse sixième thèse sur Feuerbach.
Mais il y a des savants marxistes avec une forte tendance à la glose, à l’exégèse, qui n’ont cessé de répéter pendant des années que l’essence de l’homme c’est l’ensemble de ses rapports sociaux jusqu’à en faire une abstraction dénuée de réalité.C’est une déviation de caractère philosophique disons, or l’homme ce n’est pas simplement un « zoon politikon », un être social comme disait Aristote, ce n’est pas simplement l’ensemble de ses rapports sociaux, c’est aussi un être de chair et de sang, un être qui n’a pas complètement rompu avec le règne animal, qui par certains côtés se rattache au règne animal.
Bien sûr, l’humanité est en rupture avec l’animalité, mais nous devons beaucoup de choses au monde animal. Quand on lit, par exemple, certains textes d’éthologie qui étudient le comportement des animaux, on voit tout ce que nous devons. Il suffit d’avoir un chien chez soi ou un chat (ou un âne ?) pour voir ce qui nous rapproche du monde animal, non seulement l’agressivité, mais aussi le contraire, la tendresse, le besoin de câlins, d’affection, le sens du territoire aussi, malheureusement, aussi... Le sens de la propriété est déjà en germe dans le règne animal.
Et donc toutes ces dimensions-là, disons corporelles, physiques, naturelles, sont évidemment complètement revisitées par l’histoire, parce que les besoins les plus naturels de l’homme, de la femme, se nourrir par exemple, faire l’amour, prennent des formes historiques sans cesse changeantes et sont entourés de tout un « corps astral » d’idées et d’idéologies, de représentations.
Ces besoins naturels ne sont jamais à l’état naturel dans la société mais nous ne pouvons pas faire l’impasse de leur prise en considération.
Sans doute que les marxistes ont souvent péché par défaut de matérialisme, en quelque sorte, ce qui est un comble.
Mais j’ajouterai un dernier paradoxe pour passer au capitalisme, (c’est quand même ça qui nous intéresse ce soir...), c’est qu’il s’est passé une chose pour rester sur les raisons de l’échec du socialisme. Il y en a une que je n’ai pas dite, je pense pour ma part que le socialisme est mort autant de ses succès que de ses échecs. Je veux dire par là que, bien sûr, il y a des choses qui ne marchaient pas mais beaucoup de choses marchaient. D’abord, la sécurité matérielle était assurée à la population, les gens n’avaient pas d’inquiétude pour le lendemain, pas d’inquiétude pour le boulot, ils savaient qu’ils faisaient des études pour un emploi, ils avaient un logement, ils avaient la santé gratuite, etc. Par rapport aux temps précédents, même par rapport à la société capitaliste dans laquelle nous vivons c’était « l’honnête médiocrité » dont parle Henri Lefebvre, les gens ne vivaient pas dans le luxe pour la plupart d’entre eux, pour la grande majorité, mais ils avaient une vie tranquille dans des sociétés ordonnées.
Et on a vu dans cette honnête médiocrité se développer naturellement des aspirations nouvelles au sein des jeunes générations. Celles qui ont fait la révolution bien sûr, se sont sacrifiées et vivaient dans l’élan, (mais ils ne l’ont pas retrouvé !). Il fallu conserver la révolution pour leurs enfants, pour aspirer à vivre mieux, avoir un confort individuel plus grand, des possibilités de voyager, des possibilités d’épanouissement personnel.
L’individualisation, le processus de l’individuation est un processus, lui aussi, qui commence dans la vie animale, mais qui se développe beaucoup dans la vie humaine. Et nous avons assisté à ce phénomène sociologique que les pays socialistes ayant jeté les bases matérielles du développement de leur société pour les arracher au féodalisme, en tout cas au sous-développement, ont fait naître des aspirations, des exigences qui ont condamné le socialisme, qui ont fait que les gens aspiraient à vivre comme à l’ouest, parce que pour eux c’était des sociétés ouvertes où on pouvait faire ce qu’on voulait. Ce qui n’est pas vrai, mais c’est comme ça que c’était perçu par des millions et des millions de gens. Vous vous rappelez des files de voitures quittant l’Allemagne de l’est dans leur petite Trabant pour découvrir... le chômage mais plus tard ?
Alors je dis ça parce que l’un des phénomènes marquants c’était ça, c’est le développement des aspirations individuelles qui ont été mal prises en compte et ils étaient mal préparés pour les prendre en compte par le défaut de liberté, le défaut aussi de réflexion sur ces questions, même s’il y a des penseurs comme Vyssotsky qui ont beaucoup pensé à ces questions avant.
Dans les pays capitalistes notamment, dans les sociétés capitalistes développées comme celle dans laquelle nous vivons, nous vivons plutôt les apories de l’individualisme, c’est-à-dire les impasses de l’individualisme et un développement de cet individualisme avec aussi une émergence d’aspirations individuelles toujours très fortes.
Depuis quelques années celles-ci ont souvent pris la forme de revendications identitaires. Elles sont pour moi ambivalentes, elles ont un aspect positif et un aspect moins positif, l’aspect positif c’est que ça me paraît être inscrit dans le développement de l’humanité, la diversification. Plus la société progresse, pour utiliser le vocabulaire marxiste, plus les « forces productives » se développent, plus la richesse de la société se développe, plus son niveau culturel se développe, plus la société se diversifie, plus elle se complexifie. Nous n’allons pas vers des sociétés plus simples, nous avons vers des sociétés plus complexes. Nous vivons ça tous les jours, au point même qu’on a souvent du mal à s’y retrouver… Regardez les efforts qu’il nous a fallu faire ce soir pour allumer un Zoom !
Nous sommes entrés dans un monde qui est déjà un monde futur, en tout cas pour moi qui suis un poète du 20ème siècle un peu attardé dans le 21ème. Et donc, pour une part, c’est tout à fait normal et naturel qu’avec l’apparition de cette diversification de l’espèce humaine et des individus, chacun voulant être lui-même, et pour être lui-même tende à affirmer sa différence par rapport aux autres, dans un premier mouvement.
Là où ça me paraît plus compliqué, c’est que d’abord, ne nous faisons aucune illusion, le capitalisme est un énorme ventre, il a une capacité énorme à tout rattraper, a tout phagocyter, à tout récupérer et à tout transformer en parts de marché. La revendication de liberté individuelle c’est toujours un secteur, un segment du marché. Qu’on soit homosexuel, qu’on soit trans, qu’on soit poète, qu’on soit Antillais, qu’on soit n’importe quoi, vous correspondez toujours à un segment du marché possible avec des gens qui vont essayer de faire de l’argent sur votre dos.
C’est pas nouveau, mais le capitalisme ne fait que croître et embellir, et dans ce contexte-là il intègre aussi ça comme il a su récupérer, par exemple, une grande partie des aspirations libertaires de mai 68 pour développer ce que j’appelle le néo-capitalisme, je ne suis pas le seul à dire ça... Autant les valeurs capitalistes traditionnelles du 19ème siècle étaient fondées sur le travail, l’économie, l’épargne, autant depuis les années soixante et la société de consommation, en particulier depuis la révolte de 68, on a vu apparaître ce qu’on peut appeler un néo-capitalisme apparemment hédoniste, dont les valeurs sont la consommation, la jouissance sans entrave, le plaisir, la liberté, etc qui étaient des revendications de mai 68 et qui ont été intégrées. Alors vous avez tout à fait raison, ça n’est pas nouveau.
Ce qui est plus nouveau et ce qui pose plus question c’est quon est dans cette phase, l’affirmation, la multiplication des revendications identitaires, qui est sans doute un passage obligé, j’insiste là-dessus, mais qui peut conduire à une fragmentation du mouvement populaire à l’image de ce qui s’est passé aux États-Unis où de nombreux secteurs combattent « l’american way of life » dans la société américaine elle-même, mais il n’y a pas de conjonction qui se fasse, sauf très provisoirement au moment de la campagne de Bernie Sanders par exemple. Là, on avait vu un moment de convergence d’un certain nombre des différentes tendances qui combattent le modèle américain capitaliste, mais en règle générale, chacun agit en ordre dispersé. C’est l’histoire des Horaces et des Curiaces, le frère Horace a réussi à battre a les Curiace, car il les a entraînés dans la course, et il les a tués un par un. Et il a remporté la compétition.
Le capitalisme se comporte un peu comme ça, il divise pour régner et le risque serait que des revendications qui au départ sont libératrices, en tout cas d’émancipation, deviennent de nouveaux enfermements. Je veux pas être trop polémique, mais par exemple moi je reste rêveur quand je vois la multiplication des étiquettes : Il y a eu le mouvement d’affirmation des homosexuels en 68 avec les FHAR, le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire, puis après l’homosexualité est devenue une chose reconnue dans la société, de plus en plus admise aujourd’hui, pas encore complètement, mais de plus en plus, et on voit la multiplication des étiquettes indiquant les diverses options sexuelles possibles, je ne peux pas dire la liste complète puisque je suis pas sûr de la connaître complètement, et je comprends que chacun de ceux qui à telle ou telle option disons veuille qu’elle soit reconnue.
On est dans cette phase où les luttes pour la reconnaissance ont pris le pas sur la lutte pour l’égalité. On veut être reconnu, pour sa différence. Mais vous pouvez être reconnu et que ça ne change pas grand-chose… Peut-être un peu plus de considération, on peut parler de vous, mais ça ne change pas fondamentalement votre condition. Et je pense que le vrai problème qui est posé aux forces progressistes en général c’est de passer des luttes pour la reconnaissance aux luttes pour l’égalité. Non pas dans un « remake », pour parler comme les Américains, une réédition des anciennes luttes pour l’égalité qui étaient parfois trop égalitaristes d’une certaine façon, qui mettaient tout le monde dans le même sac, mais dans des luttes pour l’égalité qui prennent en compte la diversité, des luttes pour l’égalité qui soient en quelque sorte arc-en-ciel. C’est-à-dire qu’il faudrait réussir à aborder l’étape de l’unité dans la diversité. Ça peut paraître une idée abstraite et très générale… On peut penser qu’elle est généreuse aussi, mais ça n’est pas une idée si générale que ça.
Par exemple, je voudrais pointer une question centrale pour moi qui est la question de la conscience de classe. Dans la tradition révolutionnaire, le prolétariat, ceux qui ne possèdent que leur force de travail et sont obligés de la vendre aux capitalistes pour vivre, cette classe qui n’a rien pouvait devenir la classe exerçant le pouvoir, devenir « tout » à condition qu’elle prenne conscience d’elle-même, que la classe « en soi » devienne une classe « pour soi » pour utiliser un terme philosophique. Et ça, ça passait par la conscience de classe supposée formée par des organisations syndicales, politiques, etc.
D’où l’organisation de la première Internationale à l’époque de Marx et Engels.
L’organisation, ensuite de la deuxième Internationale avec Engels et qui a donné naissance à tous les partis socialistes, puis la troisième Internationale, lancée par Lénine après que la deuxième, socialiste, ait lamentablement fait faillite au moment du déclenchement de la première guerre mondiale où on a vu la plupart des partis socialistes rallier leur bourgeoisie nationale pour partir la fleur au fusil faire la guerre contre les prolétaires du pays voisin, à l’exception de quelques figures, comme Jean Jaurès, quand même, mais qui a été tué tout de suite et pour cette raison là, ou Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et un certain Lénine qui se sont opposés à la folie guerrière. Je dis ça parce que nous sommes dans une période qui, par bien des aspects, me fait penser à ces années-là. On est peut-être dans les prolégomènes [6]d’une troisième... j’espère que non, j’espère me tromper, mais enfin il y a quand même beaucoup de choses qui montrent qu’un nouveau partage du monde est en train de se dessiner entre les grandes puissances impériales, les anciennes puissances qui perdent leur pouvoir et les nouvelles qui émergent. C’est gros de guerres possibles.
Elles sont déjà là d’ailleurs pour certaines d’entre elles. Depuis plus de 20 ans nous assistons à une guerre permanente, on est rentrés dans une période de chaos mondial. La vieille idée de coexistence pacifique, qui est une idée héritée de la révolution d’octobre, suite au décret sur la paix de Lénine, a été complètement jeté aux oubliettes, à commencer par Poutine. Mais il n’est pas le seul.
De Washington à Moscou l’idée de la coexistence pacifique est vraiment une idée remisée dans les poubelles de l’histoire. Je parlais de la conscience de classe, parce que je pense que la vraie question aujourd’hui, c’est ça : Comment recréer une conscience de classe ? À la fois qui prenne en compte la nécessaire unité des exploités, parce que ce que Marx appelait les prolétaires, c’est aujourd’hui 90 % de la population active. Il y a maintenant des prolétaires des ordinateurs, qui se vivent peut-être pas comme des prolétaires mais qui le sont au sens scientifique du terme, au sens marxiste, c’est des prolétaires, ils ne possèdent pas leur travail, que leur force de travail.
Ce prolétariat est diversifié et même atomisé, parce que c’est vrai qu’entre le manœuvre qui travaille dans un chantier, l’ouvrier immigré qui ramasse les poubelles et celui qui travaille dans un bureau d’études y a un monde, mais en même temps c’est le même monde, c’est le monde des salariés, c’est le monde des exploités, même s’ils ne se vivent pas comme faisant partie du même monde.
Donc la question c’est : comment pourrait renaître une conscience de classe qui fasse du commun, de cette extraordinaire diversification, de ce morcellement du peuple actuel ? D’où une idée personnelle que je vous soumets : je pense qu’il faut redonner un sens progressiste à la notion de peuple et que ça ne peut se faire qu’en donnant du peuple une nouvelle définition, c’est ce que j’appelle le « peuple monde » [7].
Le peuple réel d’aujourd’hui, ça n’est plus Jean Gabin en bleu de chauffeur de locomotive avec une casquette. Cette représentation a longtemps existé dans notre imaginaire collectif : le prolétaire en bleu de travail avec une casquette, pas la casquette de velours (comme avec certains poètes un peu bobo… je parle de ma propre casquette !). Cette image classique était en gros celle de l’ouvrier de la métallurgie des années cinquante, ça existe encore un peu mais c’est marginal.
Le peuple tel qu’il est aujourd’hui est beaucoup plus diversifié, il est souvent aussi beaucoup plus coloré, il vient de partout, des quatre coins du monde. Oui, il y avait beaucoup de Polonais parmi les mineurs, l’immigration n’est pas un phénomène récent en France, mais maintenant, un tiers de la classe ouvrière est constitué d’immigrés. Au plan mondial, la classe ouvrière, ça représente soixante-dix pour cent du salariat, virutellement de ce que j’appelle « le peuple-monde » ? Je tente de saisir par là une double réalité.
D’abord, je pense que c’est un peuple-monde par ses origines. Avant, les gens vivaient dans leur vallée et ne sortaient pas de leur vallée, sauf pour participer à la guerre. Maintenant ils sont Français et Maliens, par exemple... Dans les grandes cités de la banlieue parisienne, par exemple, ils viennent des quatre coins du monde, c’est-à-dire que déjà par leurs origines, c’est un peuple-monde, un peuple qui fait que le monde a rendez-vous au bas de votre cité, obligatoirement.
Mais ce peuple pourrait aussi devenir un peuple-monde, non pas seulement par ses origines, mais aussi par son devenir possible, par son projet, par un projet commun. Ce sera le cas le jour où ce peuple, pratiquement, aura le sentiment que c’est lui qui a entre les mains les destinées de ce monde, de cette planète. C’est ça la grande idée à mon avis révolutionnaire, c’est-à-dire que la conscience de classe moderne doit être internationaliste. La nation il faut la vivre de manière internationaliste.
Et c’est nouveau, c’est nouveau sans être complètement nouveau, parce que, pour les révolutionnaires de 89, par exemple, étaient patriotes tous ceux qui participaient à la révolution quelle que soit leur nationalité, pareil pour les communards, même étrangers ils participaient de plein droit à la révolution, on n’en est pas là quand on voit aujourd’hui la situation. Alors je dis ça parce que, à mon avis, il y a une mise à jour, il y a de nouvelles synthèses théoriques et politiques à opérer.
Je voudrais, avant de terminer, dire un mot sur un autre aspect, c’est que c’est pas simplement une question politique qui est posée, c’est une question qui est posée aussi pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des pratiques psychiatrique, psychologique, etc, mais dans ce domaine je suis totalement incompétent, je n’ai rien à dire.
Je peux dire un petit mot sur l’aspect politique mais je pense qu’il y a un troisième domaine, c’est la dimension poétique. Je pense que nous avons besoin d’un sentiment poétique, pas simplement d’une utopie. Roger Vailland dposait la question après qu’il avait quitté le PC « quand est-ce que nous retrouverons une belle et grande utopie ? », au sens d’une utopie concrète, c’est-à-dire d’un rêve peut-être en partie réalisable mais qui nous fait avancer comme l’horizon qui est toujours là, qui recule même pour un idéal. Je pense que c’est une bonne formule.
Qu’est-ce que j’entends par un sentiment poétique ? c’est un peu autre chose, même si ça inclut ça. Je pense que la poésie nous apprend quelque chose. Depuis l’origine, de tous temps et dans tous les pays, dans toutes les langues,
finalement, les poètes ne disent à peu près qu’une seule chose : La vie est brève, elle est précieuse, il faut la goûter, il faut l’apprécier, il faut la chérir, il faut l’aimer. Quand vous lisez Li Po ou Tu Fu les poètes de la dynastie Tang donc au 8ème siècle en Chine, quand vous lisez Omar Khayyam en Perse, quand vous lisez Anacréon, Horace, en Grèce, ou à Rome, jusqu’aux poètes de la beat generation américaine des années cinquante, soixante, finalement les poètes ne disent à peu près qu’une seule chose.
De la poésie, on peut donner des définitions bien différentes de la mienne, et je les accepte, elles ont toute leur part de vérité. Personne ne peut enclore cette réalité mouvante qu’est la poésie entre quatre planches d’un cercueil de définitions, mais pour moi la poésie c’est un rapport amoureux au monde au sens où c’est un rapport désirant et de tendresse au monde. Dans la vie quotidienne nous finissons par avoir les yeux gris, à faire que le monde nous devienne indifférent, c’est la prose des jours, c’est la répétition contre laquelle se révoltait Rimbaud ou les romantiques.
Tout le monde ressent ça, l’ennui à un moment de la vie quotidienne. Les poètes sont des gens qui ne supportent pas ça, peut-être par un excès de sensibilité. Pour une part ils ont tort parce que cette quotidienneté a de grands mérites, il faut déjà l’assurer, mais le rêve d’autre chose ne nous quitte jamais, le rêve d’un ailleurs, une sorte de nostalgie… ça peut être la nostalgie du passé chez beaucoup de gens, donc une nostalgie réactionnaire dans ce cas là. Ça peut être aussi la nostalgie du futur, ça peut être progressiste, ça peut être inventif d’un autre monde. Aujourd’hui la question la plus grave, à mon avis, qui est posée à l’humanité c’est que nous sommes amputés du futur, nous vivons « no future », et donc je pense que nous aurions besoin de renouer avec le sens poétique pour renouer avec ce rapport affectueux envers le monde, envers la nature, envers nos semblables, rapport amical, qui n’est pas d’indifférence, qui est un rapport sensible.
Pour moi la poésie est une forme de la conscience sensible, ça ne remplace pas la philosophie, la pensée théorique qui, elle, découpe, avec l’aide des concepts de la dialectique le monde pour en cerner les contradictions.
La poésie, elle, a plutôt tendance à réunir des contradictions pour les faire tenir dans une image, dans une formule, pour essayer de faire vivre ensemble, les détenir ensemble et donc essayer de saisir l’unité du monde comme les anciennes sagesses qui mettaient l’accent sur l’unité de l’homme et du cosmos. Pour moi un poème, c’est un objet qui contient le monde et qui l’ouvre si je peux donner cette définition, à la fois une fenêtre ouverte sur le monde, et une fenêtre qui ouvre le monde en quelque sorte. Et je pense que tout le monde a besoin de cette dimension poétique.
L’action politique, sans cette dimension poétique meurt et se transforme en ce qu’elle est, la gestion de l’économie, la gestion des municipalités, la gestion de l’existant en quelque sorte, et puis les petits calculs de rivalités, etc. Mais elle perd son élan, elle perd son souffle, elle perd sa capacité à susciter l’enthousiasme du rêve. Je pense que l’émancipation individuelle comme l’émancipation collective passe par notre aptitude à renouer avec ça.
Je vais vous lire, pour commencer un tout petit poème, parce que j’ai cité Brecht tout à l’heure plusieurs fois, j’ai traduit les poèmes de Brecht en français, j’espère bien, l’an prochain, pouvoir faire paraître un gros volume de poèmes de Brecht en français. Brecht disait : « On reproche aux marxistes d’avoir réponse à tout ».
C’est vrai, c’était un sacré défaut des marxistes, à l’époque stalinienne, les communistes, en tout cas, avaient toujours réponse à tout, alors j’ai écrit un poème qui s’appelle :
« Une question sans réponse. »
« Il nous est souvent reproché,
à nous autres, les marxistes, remarquait Brecht,
d’avoir réponse à tout.
Il faudrait donc, proposait-il,
établir une liste des questions
pour lesquelles nous n’avons pas de réponse.
En voici donc une : Jusqu’à quand
ce qui ne peut plus durer
peut-il encore durer ?
La réponse, bien évidemment,
appartient à tous. »
Un deuxième un peu plus long : « Au camarade Horace », ça renvoie un peu plus loin dans l’histoire. Horace reste un grand poète, l aimait à se retirer dans sa villa avec ses amis pour boire du vin, parler , composer des poèmes et c’est de lui que nous vient l’expression « carpe diem », c’est à dire « saisis le jour ». C’est un extrait d’une de ses œuvres et ça définit une certaine idée du bonheur qui continue à former, enfin, en tout cas à influencer notre perception. La conception française du bonheur lui doit beaucoup.
Pour répondre à Horace
Tu as raison, la cause est entendue,
la vie est brève, il faut en profiter.
Et si le temps nous manque, prenons le temps de vivre.
Que Jupiter t’accorde ou non encore quelques saisons,
bois ton vin en bonne compagnie
et cueille dès aujourd’hui les roses de la vie.
Mais tu es dans l’erreur quand tu dis d’éviter
dans ce monde éphémère les trop grands projets.
Si notre vie est courte, si elle est fragile,
tâchons qu’elle soit si possible utile.
Agissons comme l’arbre qui dans son printemps,
dépense souvent ses fleurs et
fait mûrir ses fruits pour la saison d’automne.
Cueillons la rose
mais plantons des rosiers
que d’autres après nous
puissent en profiter. »
Cette conférence a eu lieu le 4 février 2025
Le jardin public, pour une morale de la vie commune. Francis Combes. Editions Delga
https://editionsdelga.fr/produit/le-jardin-public/
[1] Henri Lefebvre, né le 16 juin 1901 à Hagetmau et mort le 29 juin 1991 à Pau, était un philosophe et sociologue français. Il a contribué à la sociologie, à la géographie et au matérialisme historique en général. Influencé par la pensée de Karl Marx, il est l’un des premiers intellectuels à diffuser le marxisme en France.
[2] Antonio Gramsci fut dirigeant du Parti communiste italien avant d’être emprisonné par le régime mussolinien de 1926 à sa mort.
[3] Georges Politzer, philosophe et théoricien marxiste français d’origine hongroise, est connu pour sa critique de la psychologie et sa promotion de la "psychologie concrète". Dans son ouvrage "Critique des fondements de la psychologie" il propose une nouvelle approche de la psychologie qui se démarque des méthodes traditionnelles comme la psychologie introspective et le behaviorisme. Dans son approche, Politzer rejette l’idée de l’âme et des concepts abstraits de la psychologie classique, affirmant que ces concepts ne sont que des abstractions sans fondement réel. Il prône une psychologie qui se concentre sur l’observation concrète des phénomènes psychologiques, en s’inspirant de la psychanalyse tout en critiquant certains de ses aspects théoriques.
La "psychologie concrète" de Politzer vise à établir une science de la psychologie qui soit à la fois scientifique et adéquate à son objet, c’est-à-dire l’étude des faits psychologiques concrets.
[4] L’homme unidimensionnel est un essai de Herbert Marcuse publié en 1964 aux États-Unis et traduit en français en 1968. L’ouvrage critique le monde moderne, à la fois le capitalisme et le communisme soviétique, en soulignant l’augmentation des formes de répression sociale dans ces deux systèmes.
Dans cet essai, Marcuse soutient que la société industrielle avancée crée des besoins illusoires qui permettent d’intégrer les individus au système de production et de consommation par le biais des médias de masse, de la publicité et de la morale.
[5] Erich Fromm est un sociologue et psychanalyste américain d’origine allemande connu pour avoir greffé de façon critique et originale la théorie freudienne sur la réalité sociale, et pour être un des premiers penseurs du XXe siècle à parler d’un revenu de base inconditionnel. Fromm est également reconnu pour son œuvre "La Peur de la Liberté", qui explique le terreau psycho-sociologique du nazisme.
[6] Les prolégomènes désignent une longue introduction placée en tête d’un ouvrage, contenant les notions préliminaires nécessaires à sa compréhension. Ce terme est issu du grec ancien prolegomena, signifiant « choses dites avant ».
[7] Le concept de "peuple monde" désigne des entités sociopolitiques et culturelles dont la dimension dépasse celle d’un seul État, empire ou État-nation, s’étendant à une échelle continentale et/ou mondiale grâce à leur diaspora. Parmi les peuples-monde de la longue durée, on compte les Chinois, les Indiens, les Iraniens, les Grecs, les Juifs et les Arméniens.
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil