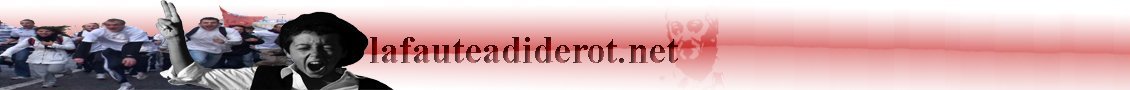
Les Accords de Munich signés en septembre 1938, qui constituent un élément essentiel du contexte de la signature du Pacte germano-soviétique, sont connus. La farce de la mission envoyée fin juillet 1939 à Moscou par la France et l’Angleterre, est également connue avec le témoignage du général Doumenc [1] et celui d’un autre participant aux négociations, André Beaufre, dans le livre Le drame de 1940. Le chef des travaillistes anglais, Clément Attlee, déclara à ce propos : « Les diplomates britanniques et français ont traité le gouvernement soviétique avec une telle désinvolture que nous aurions, nous travaillistes, agi comme Staline et signé l’acte du 23 août 1939 ».
Mais un autre élément majeur du contexte est beaucoup moins connu : les combats entre l’URSS et le Japon en Extrême-Orient et notamment la bataille de Khalkhin-Gol [2]. Cette bataille est oubliée dans la plupart des publications dans notre pays, alors qu’elle se déroule précisément juste au moment de la négociation et de la signature du pacte germano-soviétique ! [3]
Joukov, qui fut envoyé en urgence sur le front pour commander les troupes soviétiques déjà engagées dans les combats, résuma ainsi l’enjeu stratégique de cette bataille pour les Japonais : « Je pense que s’ils avaient réussi à Khalkhin-Gol, ils auraient déployé ultérieurement des offensives. La mainmise sur la Mongolie orientale et un débouché vers le Baïkal et Tchita, par la prise du Transsibérien entraient dans leurs perspectives » [4].
Autre élément du contexte extrême-oriental : des pourparlers entre la Grande-Bretagne et le Japon sont engagés en juillet 1939, Chamberlain ayant l’objectif d’arriver à un accord du même type que celui de Munich, afin de préserver les intérêts de l’Empire britannique. Ces pourparlers n’échouèrent que sous la pression des Etats-Unis [5].
Une chose est sûre, l’URSS craignait d’être engagée dans une guerre sur deux fronts. Le Japon occupe une grande partie de la Chine depuis 1937 [6] et au sein de l’Empire japonais deux clans s’opposent : le clan dit de la Route du Nord (hokushin-ron), partisan de la poursuite des conquêtes vers la Sibérie, et celui de la Route du Sud, partisan d’une conquête de l’Indochine, de l’Indonésie, des Philippines et des îles du Pacifique. L’échec militaire à Khalkhin Gol, d’une part, et la signature du Pacte germano-soviétique, d’autre part, entraînèrent la défaite politique du clan de la Route du Nord et une réorientation de la politique japonaise. En 1941, pressé par l’Allemagne d’entrer en guerre contre l’URSS, le Japon adoptera une attitude prudente prévoyant de tirer les marrons de feu seulement après une défaite de l’URSS. A l’automne 1941, des divisions sibériennes pourront ainsi être transférées pour la défense de Moscou et apporteront une contribution à la réussite de la contre-offensive de l’Armée rouge autour de la capitale [7].
Quelques éléments de chronologie
29 juillet – 11 août 1938. Bataille du lac Khassan entre le Japon et l’URSS.
30 septembre 1938. Accords de Munich.
11 mai 1939. Début de l’attaque japonaise à Khalkhin-Gol.
17 mai. Molotov, ministre des Affaires étrangères fait savoir que l’URSS accepte d’envisager des pourparlers avec l’Allemagne, en réponse aux avances de celle-ci depuis mars.
Fin mai1939. Joukov est envoyé sur le front de Khalkhin-Gol.
Juin 1939. Poursuite des combats.
2 juillet 1939. Nouvelle offensive japonaise.
Juillet 1939. Négociations entre la Grande-Bretagne et le Japon à l’occasion de l’affaire de Tientsin.
23 juillet. Nouvelle offensive japonaise.
20 août 1939. Début de la contre-offensive de l’Armée rouge.
20 août 1939. Fin des négociations Grande-Bretagne/Japon.
23 août 1939. Signature pacte de non-agression germano-soviétique. Humiliation du Japon non consulté alors que le pacte anti-komintern Allemagne Japon stipulait qu’il n’y aurait pas d’accord politique avec URSS sans accord de l’autre partie.
30 août 1939. Chute du gouvernement Hiranuma et nomination de Nobuyuki Abe comme Premier ministre au Japon.
30 août. La résistance japonaise cesse ; ordre de l’état-major impérial de se préparer à cesser les opérations offensives.
3 septembre. Nouvel ordre de l’état-major impérial face à la volonté de l’état-major de l’armée du Kwantung de poursuivre les combats.
15 septembre 1939. Accord Japon URSS de fin des hostilités.
16 septembre 1939. Cessez le feu URSS Japon.
17 septembre. L’URSS franchit la frontière polonaise, après que la défaite de la Pologne face aux armées nazies eut été avérée.
A lire sur ce sujet :
- Gauthier, Kristian (2016). « La bataille de Nomonhan et la Seconde Guerre mondiale en Extrême-Orient » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en histoire.
https://archipel.uqam.ca/9113/
- La Mandchourie oubliée : Grandeur et démesure de l’art de la guerre soviétique. Jacques Sapir. Editions du Rocher, coll. « Art de la guerre », 1996.
Un film a été réalisé sur cette bataille par l’URSS, mais il n’a pas été projeté, peut-être par crainte de provoquer l’empire du Japon. Lire à ce sujet l’article Une « drôle de guerre » à l’écran : Khalkhin Gol :
https://journals.openedition.org/cm/4186
Le film est disponible sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=J7AUvQ1DEBc
Ainsi qu’une video sur cette bataille :
https://www.youtube.com/watch?v=SYz-NSuUNMY
La bataille de Khalkhin Gol est évoquée dans le roman La fête est finie, de Philippe Pivion (publié aux éditions Le temps des cerises).
[1] Lire à ce sujet le texte de François Eychart publié dans Aragon. Un jour du monde. Chroniques de Ce soir (2e partie) 22.00€. N° 20 des Annales de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet. Texte accessible sur La faute à Diderot : https://lafauteadiderot.net/Aout-39-la-mission-a-Moscou-du
[2] Egalement dénommée Nomonhan, selon l’appelation japonaise
[3] Dans un livre récent intitulé Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, financé par le ministère des Armées, Olivier Wievorka consacre 6 pages au Pacte germano-soviétique sans mentionner ces combats. Il les évoque cependant quelques centaines de pages plus loin pour leurs conséquences sur la stratégie du Japon en Asie, comme si cet élément avait donc été sans répercussion sur les négociations d’août 1939 en Europe. Un autre historien du courant communiste, Roger Martelli, n’évoquait pas ce front dans un article consacré au pacte germano-soviétique. Relevons que cette concommitance est signalée dans l’article de wikipedia sur le pacte germano-soviétique : "Signé pendant l’offensive soviétique contre les Japonais en Mongolie, le pacte met un terme aux plans antisoviétiques japonais et de ce fait, même après la rupture du pacte le 22 juin 1941 par l’offensive allemande contre l’URSS, le Japon refusera toujours d’attaquer l’URSS par l’est."
[4] Dans Staline et la guerre. Editions Le temps des cerises.
[6] Selon Pierre Grosser, l’aide militaire soviétique explique la résistance de la Chine : https://www.persee.fr/doc/russe_1161-0557_2021_num_57_1_3094
[7] Sur ce sujet, lire l’article de Bernard Frederick : https://www.humanite.fr/histoire/operation-barbarossa/5-decembre-1941-loperation-barbarossa-se-fracasse-sur-moscou
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil