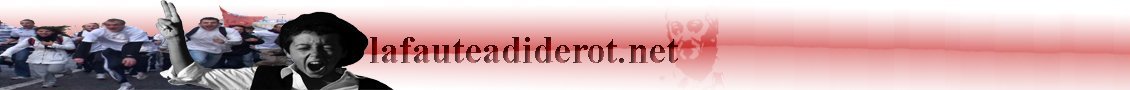
Au cœur du livre, le chapitre « Quelle décroissance ? » est consacré en grande partie au « nouvel écologisme théorique dans sa dérive naturaliste : Descola et Latour ».
En matière d’écologie, les philosophes Bruno Latour et Philippe Descola sont des références largement invoquées à gauche. Ainsi Jean-Luc Melenchon se glorifie d’avoir lancé « un slogan typiquement descolien » en proclamant : « Quand une forêt brûle, nous brûlons. » Plus concrètement, il s’appuie sur le travail de Descola pour s’opposer à la ligne ferroviaire Lyon-Turin : « cette idée de personnalité juridique d’un milieu de vie, on pourrait l’appliquer au chantier de la ligne de train grande vitesse entre Lyon et Turin, qui va vider les Alpes de l’eau qu’elle contient et détruire tout un milieu de vie ». Quant à Bruno Latour, même le quotidien l’Humanité participait récemment au concert de louanges à l’occasion de la diffusion d’un documentaire à sa gloire par la chaine Arte.
Il est donc crucial, étant donné la place des questions écologiques dans le débat politique, que des penseurs se réclamant du marxisme analysent la pensée de ces auteurs, ce que fait avec rigueur Yvon Quiniou, quand peu s’y risquent !
Je ne reprendrai pas ici dans le détail les développements d’Yvon Quiniou, je relève seulement que sur deux points essentiels, Yvon Quiniou se démarque de Descola. Il ne partage pas une certaine idéalisation des « sociétés archaïques ». Et, tout en affirmant partager ses préoccupations écologiques, Yvon Quiniou avance également « une condition impérative sans laquelle l’écologie vire à droite » : « je ne crois pas qu’il faille respecter à tout prix la nature en soi », comme si la nature avait des droits et devait être sacralisée, mais par rapport à l’homme, d’un point de vue strictement agnostique. C’est en quoi l’humanisme a la priorité sur le naturalisme global ». Quant aux thèses de Bruno Latour, Yvon Quiniou récuse notamment l’idée qu’il existe une « classe écologiste » qui puisse sauver le monde.
Si Yvon Quiniou reprend l’idée de « décroissance », c’est surtout pour récuser le « mythe » que la recherche de la croissance permettrait en elle-même de répondre à la crise actuelle. Il ne s’agit pas pour lui d’une illusoire dénonciation du progrès technique : « c’est la production technique humaine, elle-même liée de plus en plus à la science, qui est à la base de nos rapports sociaux et, tout autant et malgré bien des contradictions, des progrès multiples dans la vie de l’humanité » (…) « que ces progrès soient inégalement répartis entre les hommes au sein d’une nation ou d’une culture/civilisation ou, pire, entre les nations ou les cultures/civilisations du fait des rapports sociaux de classe, inégalitaires ou des rapports de domination mondiaux, ne change rien à l’affaire ». En conséquence, « il ne s’agit pas de renoncer à toute croissance sur la base d’une vision peu sérieuse, voire délirante de la Technique faisant abstraction de son apport économique. Au contraire, il s’agit de procéder à un examen critique de celle-ci dans toutes ses formes et ses effets, appuyé sur la science, bien entendu, mais inspiré par une vision émancipatrice pour l’humanité ».
La conclusion du livre est sans ambiguïté : « l’esprit critique nous oblige à séparer ce qui va et ce qui ne va pas dans la croissance. Ce qui ne va pas a été largement dénoncé dans sa dimension économique et sociale, qui, en abimant la nature abime l’homme lui-même. Par contre, on ne saurait écarter tout ce qui, dans la croissance, est lié au développement des sciences et des techniques et qui, maitrisé, contribue indéniablement au bien et au bonheur de l’homme, à savoir des hommes. En ce sens on pourrait conclure par cet aphorisme que nous avons mis en exergue de ce livre : « Toujours mieux et non toujours plus » ! »
J’ai évoqué certains développements et la conclusion du livre. J’ajouterai cependant un désaccord avec le passage du premier chapitre où Yvon Quiniou attribue au rapport Meadows (1972) un diagnostic du changement climatique. Dans les scenarios du rapport, la pollution est envisagée comme un facteur global, sans distinction de nature entre les différentes pollutions. Il n’y a rien dans le rapport Meadows sur le changement climatique. On pourrait se dire : en dénonçant les limites de la croissance, ce rapport traçait une voie pour éviter les pollutions de toute nature. Mais le lien éventuel entre pollution et croissance ne peut pas être examiné à partir de considérations théoriques générales, et les solutions impliquent un examen au cas par cas des caractéristiques des pollutions. Ainsi, le danger majeur pour l’humanité de la diminution de la couche d’ozone du fait de l’utilisation des gaz CFC (chlorofluocarbure) a pu être conjuré grâce au protocole de Montréal, en 1987, sans impact sur la croissance. Evidemment, la question des gaz à effet de serre est beaucoup plus complexe étant donnée la place des énergies fossiles dans l’activité humaine. Il est également significatif que dans le cas de la couche d’ozone, les Etats-Unis ont joué un rôle de précurseurs pour l’élimination des CFC alors que pour les gaz à effet de serre, ils se sont au contraire arc-boutés, avec succès jusqu’à présent, pour empêcher une réponse de l’humanité.
En fait, à l’époque du rapport Meadows, le changement climatique était loin d’être diagnostiqué de manière consensuelle par la communauté scientifique et ses effets l’étaient encore moins. Je conseille fortement à ce sujet la lecture de l’article Perdre la Terre, réécrire l’histoire du climat que Sylvestre Huet a consacré au livre Perdre la terre, qui propage la thèse selon laquelle « on savait tout » en 1979, soit 7 ans après le rapport Meadows :
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/05/13/perdre-la-terre-re-ecrire-lhistoire-du-climat/
Toujours à propos ce chapitre I du livre, qui a pour titre « La cause fondamentale, le dérèglement climatique lié à la productivité technique », il faut rappeler que le rythme actuel d’augmentation du CO2 dans l’atmosphère est beaucoup plus important que les tendances observées au 19ème siècle. A l’époque où le savant suédois Arrhenius fait ses calculs, à la fin du 19ème siècle, il prévoit que c’est au bout de 3000 ans qu’il y aurait un doublement de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. C’est depuis le milieu du 20ème siècle que nous sommes sur un rythme d’augmentation des émissions nettement plus rapide, et de très loin, et sur des niveaux à même d’impacter fortement le climat. Au minimum, on peut en conclure que niveau actuel des émissions ne peut donc avoir pour cause principale la révolution industrielle.
Et comme pour illustrer la problématique fondamentale exposée par Yvon Quiniou sur le progrès technique et ses bienfaits potentiels : c’est grâce à des progrès techniques que le changement climatique a été diagnostiqué, et donc qu’une réponse humaine est sinon certaine, du moins imaginable !
Le mythe irresponsable de la « croissance ». Pour une révolution culturelle, d’Yvon Quinou. Editions L’harmattan. 13 euros.
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil