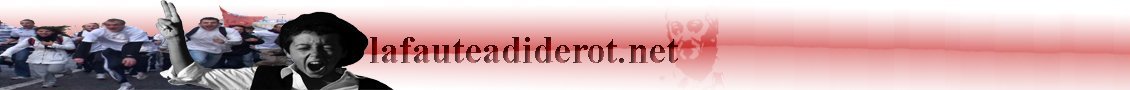
En guerre
En 1943, la guerre embrase le monde. En Europe, les armées de l’Axe reculent sous les coups de boutoir des Alliés. Ces derniers ont débarqué en Sicile en juillet et progressent vers le nord de la Péninsule au prix de durs combats.
Le régime italien, dont les troupes ont été défaites en Afrique du Nord, vit ses dernières heures. Le 25 juillet, mis en minorité par le Grand conseil fasciste, Mussolini est arrêté et son parti dissous. Le nouveau gouvernement du maréchal Bodoglio prend des contacts secrets avec les Alliés et le 8 septembre, un armistice est signé. La réaction de Hitler est immédiate. Tandis que des parachutistes allemands délivrent Mussolini interné au Gran Sasso [1] des troupes allemandes avec des renforts venus d’Autriche et des Balkans occupent le nord et le centre du pays. Elles désarment et internent la plupart des soldats italiens qui s’y trouvent (cCeux-ci-seront déportés en grande partie en Allemagne.
Le 10 septembre, les Allemands s’emparent de Rome malgré les efforts de la résistance locale. Le Feldmarschall Albert Kessselring établit son quartier général dans la capitale. Avec l’aide de milices fascistes locales encore fidèles au Duce, il instaure un régime de terreur.
Le troc
Le 26 septembre, dans la prison de la via Tasso, où il torture des partisans antifascistes tombés sous sa coupe, le SS Herbert Kappler, chef de la Gestapo, convoque des représentants de la communauté juive de la ville. Il leur ordonne de lui remettre dans les trente-six heures cinquante kilos d’or, faute de quoi il organisera des déportations. Après une collecte menée dans l’affolement, l’or lui est remis et envoyé à Berlin [2]. Mais c’est un marché de dupe : en effet, Kappler a déjà prévenu Rudolf Hoess, commandant du camp d’Auswitz-Birkenau, qu’il allait lui faire parvenir un « chargement » de plus de 1.000 juifs destinés à faire l’objet d’un « traitement spécial » recommande-t-il. [3] Puis il organise la chasse aux Juifs.
La rafle
A l’aube du 16 octobre, qu’on appellera plus tard le « samedi noir » (sabato nero) les soldats allemands encerclent plusieurs quartiers de Rome comprenant l’ancien ghetto, où une grande partie de la communauté juive vit confinée depuis le début de l’occupation [4] .Plus de mille personnes sont arrêtées, dont 200 enfants. Trois jours plus tard, ils sont convoyés vers Auschwitz-Birkenau. Seize d’entre eux survivront, mais aucun enfant.
Bien que cette rafle se soit produite « sous les fenêtres du Vatican », le pape Pie XII qui a pourtant condamné en 1937 le racisme hitlérien dans l’encyclique Mit brennender Sorge (« Avec une brûlante inquiétude »), demeure silencieux alors qu’il est directement informé de l’évènement, comme en témoignera la princesse Enza Pignatelli, qui vient d’assister à la rafle [5].
Cependant quelques Juifs parviennent à se soustraire à ce piège mortel, souvent grâce à l’aide de citoyens romains. Certains trouvent refuge dans des couvents ou des monastères, où ils sont exfiltrés de la ville, en particulier par le réseau de Mgr. O’Flaherty , qui a participé auparavant à la collecte d’or imposée par les nazis [6].
D’autres empruntent le ponte Fabricio enjambant le Tibre pour rejoindre la petite île de Tibérine (Isola Tiberina.) Là, au cœur d’une luxuriante végétation, comme isolé des tourments du monde, se dresse un vieil hôpital datant du XV° siècle, tenu par l’ordre hospitalier espagnol Fatebenefratelli (« faites le bien, frères ») [7]. Les fugitifs s’y réfugient, sachant qu’ils pourront bénéficier d’un secours.
L’hôpital
Giovanni Borromeo, le directeur de l’établissement est un fervent catholique, antifasciste de longue date. Pendant la Grande guerre, encore étudiant en médecine, il a servi comme infirmier. Devenu médecin, il est parvenu en 1943 à exercer au sein de cet hôpital religieux qui présente à ses yeux un grand avantage : tenu par un ordre d’origine espagnole, il est considéré de ce fait comme une zone d’extraterritorialité échappant aux contrôles des chemises noires de Mussolini. Dès sa prise de fonction, Borromeo s’est allié à deux médecins. Le premier, Adriano Ossicini, avait déjà échappé à plusieurs reprises à la prison pour activités antifascistes. Le second, engagé sous le nom de Vittorio Salviucci, pseudo de Vittorio Sacerdoti , avait été exclu comme Juif de l’hôpital d’Ancône ou il pratiquait. Depuis le début de l’occupation nazie, ces trois hommes offrent une assistance médicale et parfois une cachette à des juifs de la ville ou à des blessés des groupes de partisans cachés dans les forêts avoisinantes. Ils maintiennent un contact avec ces derniers grâce à un émetteur radio dissimulé dans les caves de l’hôpital. Ils correspondent en particulier avec le Fronte miitare clandestino du général Roberto Lordi, dont les partisans tiennent les abords de la capitale.
Dès l’arrivée des fuyards du ghetto à l’hôpital, Borromeo sait que les nazis qui les poursuivent ne vont pas tarder à se manifester. Il faut les soustraire au plus vite à ce danger.
Une semaine plus tard, en effet, les Allemands se présentent à l’entrée de l’hôpital. Un sergent SS et quatre hommes exigent d’inspecter les lieux. Borromeo se propose naturellement de les guider. A sa suite, le groupe arpente les couloirs.
Après quelques vérifications d’identité qui ne révèlent aucun suspect, le groupe arrive devant deux portes fermées, marquée hommes pour la première, femmes et enfants pour la seconde. Une autre inscription est très visible : Morbo di K. (Maladie K.) Borromeo leur explique que ce terme désigne une atteinte neurologique mortelle, très contagieuse dont il énumère les symptômes, qui vont de la simple toux à l’asphyxie. De l’autre côté de la porte, dans leurs lits, les fuyards du ghetto s’appliquent selon les consignes à tousser le plus fort possible pour justifier leur atteinte par ce mal…qui est dans la réalité une pure invention de l’équipe de médecins, destinée à les soustraire à toute intrusion allemande, avec la complicité du personnel et des moines du monastère [8]. Les Allemands hésitent. Peuvent-ils risquer de contracter une si terrible maladie simplement pour rechercher quelques Juifs, d’autant que dans leur esprit nourri de la propagande nazie rôde sans doute l’idée que le juif est porteur de maladies susceptibles de s’attaquer aux Aryens. Aussi font-ils finalement demi-tour.
Le subterfuge a réussi.
Après le départ des visiteur, Borromeo et ses amis parviendront à faire quitter les lieux à leurs malades imaginaires. Mais bien vite, d’autres fugitifs leur succèderont, dont les dossiers porteront l’indication à l’encre rouge Morbo di K. Autant de personnes en danger dont l’hôpital assurera la vie sauve puis l’acheminement vers des lieux plus sûrs.
Le 4 juin 1944, les troupes américaines entrent dans Rome, faisant de la ville la première capitale européenne libérée des forces de l’Axe. Les camps de concentration mussoliniens, dont certains sont ouverts depuis les années vingt pour les opposants politiques, sont enfin vidés. Huit mille Juifs y ont trouvé la mort, ce qui est très peu comparé à certains pays comme la France, où leur nombre total a atteint environ 79.000.
Le docteur Borromeo, après avoir occupé le poste de conseiller à la santé de la municipalité romaine, mourra dans les murs de son hôpital le 24 aout 1961. Il sera reconnu en 2004 "Juste parmi les nations".
De nos jours, à l’entrée de l’hôpital Fatebenefratelli est scellée une plaque commémorative. On peut y lire ces quelques mots : « Ce lieu a été une lumière dans les ténèbres de l’holocauste. Notre devoir moral est de nous souvenir de ces héros afin que les générations futures puissent les connaître et en prendre la mesure »
Sources
Bibliographie
Jennings (Christian) Syndrome K : How Italy resisted the final solution. The history press. 2022
Kertzer(David.I) Le pape et Mussolini.Editions les Arènes. Paris 2016
Poliakov (Léon) Bréviaire de la haine. Calmann-Levy 1951
Zucotti (Suzan) The Italians and the Holocaust Persecution. Rescue and Survival. Basic books, New York 1987.
Articles de presse et sites web
Buscemi (Francesco) “K syndrome, the disease that saved,” History Today, 69 ; no.3, 2019.
Chartier (Sixtine) Pie XII face à la Shoah. La Vie. 15/07/2022 Fisher (Howard)
Syndrome K and the Fatebenefratelli Hospital. Hektoe International. Uppsala, Sweden 2021
Pima(Lauren). “Le syndrome K, la maladie imaginaire qui a sauvé des juifs en 1943, cultea.fr, 2021.
PiPiot (Jean-Christophe). “Morbo di K,” Histomède, esanum.fr, 2020.
"Le syndrome K, la fausse maladie qui a sauvé une centaine de juifs italiens en 1943" - Slate.fr (septembre 2023
"Le syndrome K, la maladie imaginaire qui sauva des Juifs en 1943" - Cultea (mai 2021)
[1] Il fondera ensuite à Salo, au bord du lac de Gardes, l’état fantoche de la République sociale italienne, qui se rendra coupable de nombreux crimes.
[2] On retrouvera cet or, la guerre terminée, dans une caisse située à l’écart dans le bureau d’Ernst Kaltenbrunner, chef du RSHA (Reichssicherheitshauptamt Office central de la sûreté du Reich) Sans doute comptait-il s’en emparer pour son usage personnel.
[3] Encore à cette époque, et jusqu’à la fin de la guerre, le langage de l’extermination restera systématiquement « codé ».
[4] Ce ghetto, imposé par la papauté en 1555, a existé jusqu’en 1870 , date du rattachement de Rome au royaume d’Italie. Il sera le dernier a exister dans l’Europe occidentale avant qu’ils ne soient rétablis par l’Allemagne nazie en 1933.
[5] Le 28 octobre 1943, Ernst von Weizsäcker, ambassadeur d’Allemagne près le Vatican, à qui on doit cette expression « sous les fenêtres du Vatican » rassure son gouvernement : « Le pape, bien que sollicité par diverses parties, n’a pris aucune position contre la déportation des juifs de Rome et a fait tout son possible afin que cette délicate situation ne puisse compromettre ses rapports avec le gouvernement allemand et les autorités allemandes de Rome. » Il faut souligne néanmoins que Pie XII a recueilli en 1943 au Vatican des réfugiés juifs venus de l’Italie du Nord mais est resté là encore silencieux, laissant à l’Osservatore Romano le soin d’exprimer l’indignation de l’Église. Dès la libération de Rome, il insistera auprès de l’Etat-major allié pour que les soldats noirs soient interdits de pénétrer dans la ville sainte. Lorsqu’il était nonce apostolique en Allemagne, le futur pape s’était déjà associé à la campagne internationale de dénigrement lancée par le parti nazi contre les soldats noirs de l’armée française, accusés de violer les femmes allemandes et de répandre la syphilis.
[6] Après la guerre, cet évêque irlandais sauveur de nombreux soldats alliés et d’Italiens juifs ira visiter dans sa prison Herbet Kappler, l’organisateur de la rafle, et aidera sa conversion au catholicisme peu avant sa mort.
[7] De nos jours, l’Ordre, qui porte aussi le nom de Saint Jean de Dieu (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.) est présent dans plus de 50 pays et administre environ 300 établissements de santé.
[8] Nul ne sait exactement comment et par qui est venue l’idée de baptiser ce pseudo-syndrome du nom de K. Il est possible que ce soit en référence ironique à Kappler, le chef de la gestapo de Rome ou encore au général Kesselring, On peut aussi avancer le nom du célèbre médecin allemand Robert Koch, découvreur du bacile responsable de la tuberculose, affection qui provoque des quintes de toux et se transmet par voie aérienne.
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil