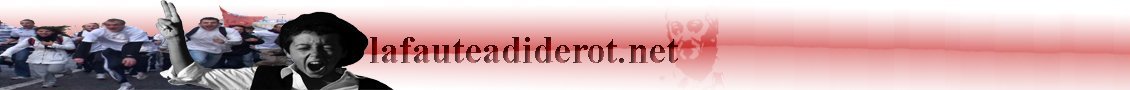
Pourquoi avoir écrit un nouvel ouvrage sur les Jacobins ?
Guillaume Roubaud-Quashie (GRQ). Car il y a des mésusages de masse de ce terme aujourd’hui encore. Les notions de « Jacobins » et de « jacobinisme » reviennent souvent, que ce soit dans la bouche des commentateurs d’actualité ou des hommes politiques. Généralement aujourd’hui, c’est devenu une référence paresseuse pour signifier « centralisation », alors que ces termes renvoient à une matière beaucoup plus consistante que cela, avec une signification révolutionnaire forte et il nous a semblé qu’il était important de comprendre ce que l’on dit quand on parle de « jacobins ». Il fallait dépoussiérer quelques mythes pour comprendre ce qu’il y avait dessous depuis le moment fondateur qu’est la Révolution française.
Pour y voir plus clair peut-on distinguer le jacobinisme historique des temps révolutionnaires, du jacobinisme plus ou moins fantasmé de la légende noire contre-révolutionnaire du jacobinisme comme référence au sein de la culture politique républicaine postérieure ?
Côme Simien (CS). Il y a effectivement deux choses bien différentes. Tout d’abord ce temps qui court de l’automne 1789 et l’automne 1794, au cœur de la Révolution donc, durant lequel est fondé puis se développe le club des Jacobins. Sa fermeture est ordonnée par la Convention thermidorienne en novembre 1794. Il y a, ensuite, une vie posthume du « jacobinisme », à partir de la fermeture du club. Désormais, le combat politique va sans cesse se ressaisir de cette notion. Dès 1795 et l’époque thermidorienne, l’étiquette va servir à dénoncer, du côté royaliste, tout ce que la Révolution aurait d’exécrable, de funeste. Mais le terme va également se mettre à désigner, dès le Directoire (1795-1799), ce qui forme la « gauche républicaine ». Après la fermeture du club, dans les usages mémoriels, le référent jacobin gagne en cohérence par rapport à ce que le jacobinisme avait pu être du vivant des Jacobins. Car durant les cinq ans d’existence réels du club, il est difficile de définir clairement une colonne vertébrale doctrinale aux Jacobins.
Justement, intéressons-nous à ce jacobinisme. Michelet avait distingué trois périodes qui correspondaient à trois identités successives : le moment parlementaire et élitiste, celui de la prépondérance des Girondins puis celui du jacobinisme classique, celui des Montagnards. Cette périodisation est-elle toujours pertinente selon vous ?
Côme Simien. Cette périodisation classique se retrouve en tout cas dans de nombreux ouvrages, et c’est d’ailleurs par elle que débute le livre de Michel Vovelle sur les Jacobins. Selon ce schéma, il y aurait un premier temps durant lequel les parlementaires comme Lameth ou Barnave auraient été prédominants et le club plutôt élitiste. Puis serait venu un second temps durant lequel des journalistes républicains et futurs Girondins, comme Brissot, y auraient occupé la première place. Pour finir, alors que les Girondins quittent le club, les Montagnards comme Robespierre y seraient devenus les plus influents : c’est le jacobinisme radical et classique qui fertilisera la culture politique de la gauche républicaine.
Cette tripartition, sans être dénuée d’intérêt heuristique, a pour inconvénient selon nous de trop se concentrer sur le club parisien, soit la maison mère qui se crée au couvent des Jacobins à Paris à la fin de l’automne 1789. Or, depuis plusieurs décennies la recherche a démontré combien le jacobinisme est d’abord et avant tout un mouvement, un réseau de clubs dans toute la France. 350 clubs à la fin de l’année 1790, puis 900 clubs l’année suivante. À ce moment il n’y a pas de chef lieu de département qui n’ait son club affilié au club parisien. Puis il y a un ralentissement dans le déploiement de ce réseau de clubs à la fin 1791 et au début 1792, avant une reprise durant l’été 1792, jusqu’au point culminant du mouvement jacobin en 1793-94 avec 6 000 clubs et près de 500 000 membres. Les villages sont alors atteints et on voit un élargissement du recrutement plus populaire. Cette chronologie n’est pas tout à fait la même que celle proposée par Michelet, qui n’est pas absurde pour autant. Plusieurs dynamiques, plusieurs échelles, plusieurs temporalités et plusieurs logiques spatiales jouent et se recouvrent les unes les autres à l’intérieur du mouvement jacobin.
Le renouvellement de la recherche invite à donc à ne plus concentrer le regard sur Paris et ses têtes de figure très connues.
Nous parlons spontanément du « club des Jacobins », mais il faut s’interroger sur la forme club, cette nouvelle forme d’organisation politique très différente des salons, des sociétés littéraires ou des loges de type maçonnique. D’où vient-elle ? Quelles sont ses spécificités ?
CS. C’est un vieux débat historiographique qui remonte à l’historien monarchiste et conservateur, Augustin Cochin (1876-1916), qui avait postulé que les origines du jacobinisme seraient à trouver dans les loges maçonniques, les salons et ce qu’on a appelé « les sociétés de pensée ». Ce sont elles, affirmait-il, qui auraient posé les germes d’une contre-société démocratique au sein de la société d’Ancien régime, ce qui aurait eu pour effet de miner cette dernière de l’intérieur. Avec les clubs jacobins, on aurait tout simplement changé d’échelle dans cette dynamique, et on aurait ainsi basculé dans une société démocratique généralisée (que Cochin regrettait pour sa part). Il y a eu beaucoup de travaux récents sur ces sociétés et notamment sur les salons (Antoine Lilti) ou sur la franc-maçonnerie (Pierre-Yves Beaurepaire) et il y a aujourd’hui un consensus parmi les historiens pour dire qu’on ne trouve pas là le modèle qui inspira la fondation du club des Jacobins en 1789. Le club est une forme de sociabilité politique dont on peut faire l’histoire, une histoire que connaissent les révolutionnaires français eux-mêmes. Cette forme de sociabilité politique nait en Angleterre en XVIIe siècle, dans le contexte des deux révolutions anglaises : dans les clubs, des hommes (pas de femmes ici) se retrouvent pour boire, manger et se divertir mais aussi pour discuter des affaires publiques avec une liberté critique de ton. Au moment où l’Angleterre devient une monarchie parlementaire, les députés prennent l’habitude de se réunir dans des clubs (plusieurs, souvent) pour préparer les séances du Parlement de Londres, selon leurs affinités politiques. Et comme l’Angleterre a des colonies, notamment les 13 colonies d’Amérique du Nord (celles qui deviendront les États-Unis), le modèle des clubs politique s’exporte rapidement outre-Atlantique, où il prend même un nouvel essor à la faveur de la Révolution américaine (1765-1783). Les clubs sont même l’un des fers de lance majeurs de l’époque de la guerre d’indépendance américaine. Le modèle des « clubs » y subit toutefois une inflexion décisive. Dès la fondation des « Fils de la liberté », à Boston, en 1765, on voit en effet émerger un nouveau type de club, ainsi que l’a bien établi Micah Alpaugh : des clubs fonctionnant en réseau, de façon coordonnée, selon le principe de l’association politique. La circulation des mots d’ordre et la mobilisation populaire s’en trouve accrue.
Ce nouveau modèle de clubs retraverse ensuite l’Atlantique, vers l’Europe cette fois : on le retrouve en Irlande, en Angleterre dans les milieux dits « radicaux » et finalement aussi en France. Les premiers révolutionnaires français de 1789, ceux qui se désignent comme des « patriotes » (Condorcet, Brissot, La Rochefoucauld…) connaissent très bien les réalités anglaises mais aussi américaines et ont cherché à acclimater ces formes de sociabilité politique dans un pays (la France) où elles demeuraient encore « neuves ». C’est ainsi qu’est fondée, en février 1788, la fameuse Société des amis des Noirs, qui compte plusieurs succursales en France. Dans cette société on retrouve bon nombre de futurs fondateurs du club des Jacobins. Donc quand le côté gauche de l’Assemblée constituante se demande, en novembre 1789, comment peser davantage dans le débat politique et à l’Assemblée à l’automne 1789, beaucoup d’entre eux connaissaient déjà, quoique de fraiche date, l’efficacité et la force d’entraînement des « clubs ».
Une fois le club fondé, quelles sont ses règles de fonctionnement ?
CS. Un règlement intérieur pour le club parisien est adopté dès février 1790 et ce règlement aura évidemment un rôle important par la suite lorsque le réseau des sociétés affiliées au club des Jacobins va se développer. C’est le patriote modéré Barnave qui en est le rédacteur principal. Ce règlement fixe les modalités de déroulement des séance, l’organisation interne ainsi que les règles des prises de parole. Il pose aussi l’existence d’un bureau élu pour 15 jours avec un président, un secrétaire, un trésorier etc. L’origine législative de club, fondé au point de départ par des députés, se lit dans les modalités retenues pour la prise de parole : ce sont les mêmes qu’à l’Assemblée nationale ! Par ailleurs, ce règlement affirme – c’est important - que les décisions prises collectivement au sein du club des Jacobins ne contraignent pas les députés membres du club au moment de leurs votes au sein de l’Assemblée nationale. Les représentants du peuple conservent donc une part essentielle de liberté.
Lorsque d’autres clubs se forment en province, certains s’inspirent de ce règlement parisien mais sans jamais le transposer mécaniquement. On y fait des ajouts ou des modifications pour prendre en compte les particularités locales. Par ailleurs, ces règlements locaux connaissent d’incessantes modifications, tout simplement parce qu’on y est à la recherche de la meilleure formule de démocratie interne possible. On constate ici très clairement combien il n’y pas de perspective de nivellement ou d’écrasement centralisateur : un club jacobin de province n’est pas contraint de s’organiser et de « vivre » comme le club parisien. Par ailleurs, on reste dans la logique d’association prévue dans le règlement intérieur de février 1790 : ce sont les clubs de province qui font la démarche de demander à s’associer aux Jacobins. Ils ne sont pas des émanations directes du club parisien qui, pour sa part, n’ordonne aucune création. Du reste, les demandes d’association sont étudiées par le club parisien, qui peut les accepter ou les rejeter. Pour finir, il faut bien noter que les clubs de province peuvent aussi s’associer entre eux sans passer par l’accord de Paris : on est là dans une logique très horizontale et non verticale du « jacobinisme ». S’associer, c’est échanger des correspondances, des discours, des informations et des réflexions et non pas envoyer des ordres. La puissance de ce réseau qui devient rapidement un réseau national, permet au club parisien de profiter d’une manne d’informations très importante.
Était-il envisageable que les clubs de province soient « purgés », le club parisien imposant des exclusions ?
CS. Il y a des exclusions incontestablement, mais qui ne sont pas du fait de Paris. Les clubs de province excluent certains de leurs membres pour différents motifs et cela se met en place assez rapidement, sans attendre l’An II et la « terreur ». Certains « jacobins », sont exclus pour absentéisme : ils ne viennent plus. D’autres car ils ont défendu des opinions contradictoires avec les principes du club par exemple, en faisant assaut de royalisme après l’arrestation du roi le 10 août 1792. On trouve aussi des cas de membres qui n’adoptent pas le code de conduite en venant ivres aux séances par exemple. Ce n’est pas si différent des organisations politiques modernes qui n’hésitent pas non plus à exclure certains de leurs membres – ou bien qui cessent de les considérer comme leur membre si celui-ci ne paie plus ses cotisations et ne participe plus à l’activité politique commune.
Ceci dit, il y a des exclusions plus politiques décidées en 1793-94, pour éliminer ceux qui défendraient des opinions considérées comme « contre-révolutionnaires ». Ces « épurations », selon le terme utilisé à l’époque, restent marginales en termes d’effectifs, et il faut faire ici la différence entre la force des annonces (l’organisation d’une « épuration ») et sa réalité concrète. Il y a par exemple un « scrutin épuratoire » à Paris qui est ouvert dès 1793 mais qui n’exclut que de manière limitée et qui n’est toujours pas terminé au moment de la chute de Robespierre, puis de la fermeture du club. On trouve la même chose en Province d’ailleurs. Ainsi le club normand du Havre qui, dans un contexte de révolte fédéraliste sévère, est jugé comme ayant eu la main épuratoire très lourde, n’exclut en réalité « que » 25 % de ses membres. Mais c’est un cas extrême : la moyenne est plus souvent de l’ordre de 1 à 2 %. Les purges massives dans les clubs jacobins vont en fait avoir lieu après le 9 thermidor et ce sont les autorités thermidoriennes qui en sont les responsables, pour éliminer les éléments qualifiés de « terroriste » (et régler au passage quelques comptes politiques et/ou personnels).
C’est ce qui explique la faiblesse du club qui est fermé sans grand remous en novembre 1794 ?
CS. Le club est mort plusieurs fois, en réalité, mais sa mort finale a bien lieu sur décision de la Convention en ce mois-là de novembre 1794. Mais il y avait déjà eu d’importants signes avant-coureur : le 9 Thermidor, il est fermé, sans s’être réellement mobilisé pour défendre Robespierre, puis il obtient l’autorisation de rouvrir mais s’avère désormais très affaibli. Moins de séances, beaucoup moins de membres et de public présents. En novembre 1794, cette fermeture à Paris est suivie par la fermeture imposée des clubs de province, qui ferment les uns après les autres dans les semaines et les mois qui suivent. Avant même la fermeture imposée à Paris en novembre 1794, le principe de l’association et donc du réseau politique avait été proscrit par la Convention nationale en septembre 1794. C’était priver le mouvement jacobin de ce qui avait fait l’essentiel de sa force.
La question de la centralisation n’est pas qu’une question de fonctionnement du jacobinisme mais aussi une question d’organisation de la République. Vous battez encore une fois en brèche le lieu commun du projet d’une république jacobine forcément centralisatrice.
CS. Tout à fait. Nous avons comparé le projet de constitution émis par Condorcet au nom des Girondins et les travaux produits dans ce sens par des membres du club. Sous la Convention, après le renversement de la monarchie, un comité de constitution à été chargé de réfléchir à une constitution pour la Première République. Comme les Jacobins sont conscients que ce sont leurs adversaires, les Girondins, qui dominent encore la Convention et le comité en question, ils organisent une sorte de « contre-comité » sous la proposition de Danton. Ce « contre-comité » où l’on trouve Collot d’Herbois, Robespierre et autres ténors du jacobinisme, mais il n’arrivera pas à un projet définitif. On trouve des réflexions diverses : ainsi Saint Just et Robespierre qu’on imaginait très proches, ont des propositions qui divergent parfois. Cependant, en croisant et comparant toutes ces contributions de figures importantes du jacobinisme, on ne trouve pas de principe centralisateur qui y soit plus affirmé que chez les Girondins. Chez les Girondins, la proposition de Condorcet présentée en février 1793, annonce d’emblée que la République « une et indivisible » avec un pouvoir exécutif élu directement par les citoyens, élection directe que refusent les propositions de Robespierre et de Saint Just. Condorcet pose qu’il faut un rouage administratif qui fasse appliquer la loi de manière uniforme sur tout le territoire ce qui implique que les municipalités soient sous la surveillance d’une autorité départementale, elle-même sous la surveillance du gouvernement. C’est ainsi que les municipalités, selon le projet de Condorcet, ne puissent lever des impositions locales d’elles-mêmes, sans l’accord de l’autorité départementale qui devra avoir celle du gouvernement. On voit que c’est fondamentalement centralisateur. Pour Robespierre et Saint Just, tout en acceptant d’unité et d’indivisibilité de la République, une large autonomie communale doit être garantie, que ce soit de moyens et d’actions.
Comment naît cette légende noire du centralisme jacobin qui annoncerait les grands systèmes totalitaires du XXe siècle donc ?
CS. Ce sont les thermidoriens qui, après avoir envoyé à l’échafaud des dizaines de révolutionnaires sans aucun procès, dans les jours qui suivent la chute de Robespierre, vont formaliser cette légende noire. Pour justifier de leur coup de force, ils affirment en effet sans relâche qu’il y aurait eu, au cours de l’année précédente (1793-1794) un « système de la Terreur » imposé par Robespierre, devenu une sorte de tyran asservissant le pays et le faisant sombrer dans l’anarchie et l’arbitraire. Or, disent ces mêmes thermidoriens, le « monstre » Robespierre aurait voulu centraliser le pouvoir en un point unique afin de pouvoir mieux se l’accaparer.
Le problème des Thermidoriens est qu’ils voulaient renverser Robespierre et ses partisans sans abolir les institutions du régime d’exception mises en place en 1793, et notamment le Comité de Salut public et le Comité de Sûreté général, de même que le Tribunal révolutionnaire (jugeant des crimes politiques). La solution rhétorique trouvée à ce problème fut la suivante : la Terreur n’était pas l’œuvre de la Convention et des institutions d’exception qui lui sont liés mais de Robespierre et, à travers lui, des Jacobins dont il aurait été le chef. Les sociétés jacobines auraient été les rouages de sa tyrannie, en formant des « sociétés d’inquisition ». Robespierre aurait voulu la centralisation comme moyen de sa tyrannie. Les clubs jacobins auraient été le levier de son ambition centralisatrice totale. Le couple « centralisation »/« jacobins » se trouve ainsi formé. Rappelons cependant combien il y avait de stratégie politique là dedans : les Thermidoriens n’étaient en réalité en rien des décentralisateurs. D’ailleurs, la constitution de l’an III qu’ils rédigent dans la foulée, celle qui donnera naissance au Directoire, est la plus centralisatrice de toute l’époque révolutionnaire.
Si on met de côté cet ensemble de falsifications sur le jacobinisme, qu’est-ce qu’on peut trouver comme éléments communs pouvant donner son identité au jacobinisme ?
Il n’y a pas d’idéologie structurée avec un corps doctrinal aboutissant à un programme d’action clair que les militants jacobins s’efforceraient d’applique sur le terrain et que l’on pourrait qualifier (hier comme aujourd’hui) de jacobinisme. Les idées avancées dans les clubs ne cessent de se déplacer ou de s’enrichir, au gré des inflexions du processus révolutionnaire (processus sur lequel les idées défendues dans les clubs exercent une influence certaine). Prenons un exemple, en 1794, les clubs jacobins demandent l’abolition de l’esclavage, ce qui n’était presque le vœu d’aucun d’entre eux en 1789. Autre exemple : en 1793, des Jacobins, sous l’impulsion notamment, de Robespierre et de Saint Just, mettent en avant le droit à l’existence de tout citoyen, ce qui est nouveau et pour le moins différent du libéralisme économique plus ou moins intégral défendu par de nombreux jacobins de 1789 (logique du « laisser faire-laisser passer »). Toutefois, on peut trouver des fils conducteurs autour des grands principes directeurs de la Révolution. Tout d’abord, les Jacobins soutiennent tous la Révolution et considèrent qu’il n’est pas encore temps, pour celle-ci, de s’achever (sous peine de ne pas tenir toutes ses promesses). Ils sont attachés aux grands principes proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen… à condition de se rappeler que le sens donné à ces principes évolue dans le temps court de la Révolution. À partir de l’automne 1792, moment de la rupture entre Jacobins et Girondins, s’affirme une autre particularité « jacobine » : alors que les Girondins se méfient désormais des sans-culottes parisiens (ce qui n’était pas forcément le cas quelques mois plus tôt), au point de proposer de délocaliser l’Assemblée nationale à Tours ou à Bourges afin de la soustraire à l’influence d’un peuple parisien jugé trop remuant et radical, les Jacobins, eux, dans le contexte d’une République en danger, prônent l’alliance stratégique avec les sans-culottes et soutiennent pour cela un certain nombre de leurs demandes (notamment, nous l’avons dit, en matière de droit à l’existence).
Pour finir, les Jacobins sont profondément attachés au principe de l’unité et de l’indivisibilité de la nation mais ce ne sont pas les seuls ! C’est un principe qu’ils partagent avec les Girondins ou avec l’autre grand club parisien, celui des Cordeliers. La nation se choisit des représentants qui font des lois s’appliquant à la nation entière. Logique centralisatrice ? Peut-être, mais l’essence théorique de cette « unité et indivisibilité » a été posée dès janvier 1789 par l’abbé Sieyès, à un moment où le club n’existe pas encore ! Ce principe a ensuite été reconnu par la Constitution de 1791 puis par la République dès sa fondation, en septembre 1792.
Bref, on mesure toute la difficulté d’identifier un corps de doctrine unifiée qui serait propre aux Jacobins, et les différencierait clairement des autres.
Pourtant le jacobinisme va survivre à la dissolution du club : un jacobinisme plus ou moins clandestin va se maintenir ce qui signifie bien qu’il y avait une identité propre… Comment le jacobinisme arrive-t-il à renaitre notamment à partir de 1830 ?
GRQ. Au XIXe siècle, lors de cette renaissance, la Révolution française n’est pas de l’histoire : c’est encore une question politique. Après des années difficiles de répression, sous l’Empire et la Restauration, le jacobinisme réapparait nettement sur la scène politique dans le contexte des Trois Glorieuses en 1830. L’ambition sociale et démocratique n’est pas morte et bien des révolutionnaires l’associent toujours au jacobinisme de Robespierre ou de Saint-Just. En 1830, il semble que l’on rejoue l’histoire : les révolutionnaires de 1830 « rejouent » 1789 et la question se pose vite de « refaire » ou non 1793, d’aller au-delà de la monarchie constitutionnelle qu’incarne d’une certaine manière la Monarchie de Juillet. Cela explique la relance du jacobinisme.
Il s’appuie sur des souvenirs et une mémoire populaire du jacobinisme historique mais aussi sur des sociétés et des organisations qui nourrissent et canalisent cette mémoire comme la Société des amis du peuple ou la Société des droits de l’homme qui mettent au cœur de leur programme politique, et non uniquement mémoriel, l’héritage jacobin. Pour cela, il y a un travail d’édition, concernant notamment les discours de Robespierre. Et puis il y a des figures de passeurs qui transmettent directement l’héritage comme Philippe Buonarotti, proche de Babeuf et auteur d’un livre important, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf (1828). Il y présente et défend la conjuration des Égaux menée par Gracchus Babeuf mais y fait aussi une synthèse des épisodes précédents, et notamment de la politique des Montagnards et de Robespierre, vue sous un angle très favorable. Il y met en valeur un aspect important pour lui, le babouviste : pour Robespierre, le droit à la propriété doit toujours être subordonné, au droit à l’existence en particulier. Buonarroti va ainsi mettre en valeur l’exigence démocratique et sociale forte du jacobinisme, compatible avec le babouvisme comme avec le socialisme et le communisme qui s’annoncent.
Dans les milieux libéraux et conservateurs, cette même lecture va être adoptée mais d’un point de vue péjoratif : le jacobinisme, c’est non seulement la Terreur mais aussi le suffrage universel donnant le pouvoir au peuple, aux « classes dangereuses » ; c’est le nivellement social et l’égalitarisme. Ainsi, le jacobinisme reste important dans le débat politique, avec un contenu en partie partagé, même si les appréciations divergent : « vous demandez le suffrage universel, vous êtes un jacobin et vous êtes pour la Terreur », en quelque sorte.
Ce deuxième temps d’un jacobinisme hérité par le biais de témoins semble s’achever autour de 1871. Pourquoi cette date butoir ?
GRQ : C’est une question difficile. Claude Mazauric y avait déjà réfléchi et avait avancé plutôt l’année de 1848 comme forme de « chant du cygne ». J’ai préféré prendre l’année 1871 comme date de fin, ce qui permet de replacer l’histoire des idées et notamment des idées politiques dans l’histoire plus globale des mouvements sociaux. 1871, c’est évidemment l’année de la Commune de Paris dans laquelle les références à la Révolution sont extrêmement fortes. La place des Jacobins revendiqués n’y est pas exclusive, mais est très forte. On pense à des figures comme Charles Delescluze qui sont à la tête de la Commune de Paris. C’est une sorte de « jacobinisme au présent ». La création d’un Comité de salut public lors des derniers moments de la Commune de Paris est bien significative, à certains égards, de cette mentalité néo-jacobine encore bien vivante, même s’il faut rappeler qu’il y a aussi des proudhoniens, des blanquistes, etc. au sein de la Commune. Remarquons d’ailleurs, que cette décision de création du Comité de Salut public pour ranimer l’énergie populaire à l’image de l’année 1793 n’a pas fait consensus chez les Communards, pas même chez ceux qu’on rassemble souvent sous l’étiquette de « Néo-Jacobins ». Au terme de cette expérience, de grandes voix s’élèvent comme celle de Courbet enjoignant à ne pas penser le monde de ce moment avec les vieilles catégories de la Grande Révolution.
Dans les décennies qui suivent, avec la stabilisation de la IIIe République, c’est la naissance des partis politiques modernes qu’a très bien décrite Raymond Huard. Le parti radical-socialiste naît mais ce n’est pas un parti jacobin, se définissant comme tel : il se réclame d’un héritage jacobin. Et puis il y aussi le rapport du mouvement socialiste au jacobinisme qui est complexe. On connaît la figure de Jaurès qui a dirigé une monumentale Histoire socialiste de la Révolution française. C’est l’interprétation de la Révolution d’un point de vue socialiste qui fut la plus audacieuse et la plus élaborée. Dans la lecture jaurésienne, l’association entre le robespierrisme et la démocratie est profonde, même si Jaurès n’était pas un « robespierrolâtre » absolu. Le socialisme jauressien ne peut pas se définir comme jacobin mais il y a bien héritage. Toutefois, il faut avoir en tête que cette Histoire socialiste, même si on en a fait des brochures, est longtemps assez peu lue, du fait de sa taille notamment. La réception chez les historiens, si on met de côté le cas d’Albert Mathiez, est tiède. Il faudra attendre Georges Lefevbre et Albert Soboul pour que cette monumentale histoire ait vraiment la place qu’elle mérite.
Par ailleurs, de nombreux socialistes insistent sur la nouveauté à laquelle correspond le socialisme, notamment pour se démarquer des radicaux comme Clemenceau. C’est le cas de Jules Guesde par exemple. La captation de l’héritage jacobin par les radicaux peut d’autant plus susciter un rejet de la référence jacobins chez les socialistes que les radicaux pratiquent des politiques répressives envers le mouvement ouvrier lorsqu’ils sont aux affaires.
Il faudrait aussi parler de la question du jacobinisme hors du socialisme français notamment au sein de la social-démocratie russe. Lénine et les bolcheviks aiment à mettre en avant une analogie : ils sont dans le même positionnement par rapport au mouvement révolutionnaire de leur temps que les Jacobins par rapport au leur. Ce sont les plus radicaux car leur attitude est pleinement révolutionnaire et ils refusent les demi-mesures et les atermoiements. Ainsi, alors que le terme de « jacobin » fut lancé par des ennemis de Lénine, celui-ci ne s’offusquera pas du qualificatif mais le reprendra à son compte. Lorsque les bolchéviks prendront le pouvoir en 1917, un Albert Mathiez interprétera la Révolution d’Octobre selon ce prisme.
Éloignons-nous du jacobinisme historique pour nous rapprocher de notre époque contemporaine. Alors que pourtant la société française change énormément durant les Trente glorieuses et parachève sa modernisation, alors que nous sommes de plus en plus éloignés de la société dans laquelle agissaient les Jacobins, on y discute toujours de jacobinisme. Comment cela se fait ?
GRQ. Effectivement. Le débat va être relancé notamment par Denis Richet et François Furet quand ils publieront une histoire de la Révolution française chez l’éditeur Hachette, en 1965. Jeunes et brillants historiens très liés au monde de la presse, Richet et Furet y développent la thèse du « dérapage » de la Révolution, notamment à partir de 1792 puis de l’influence croissante attribuée aux Jacobins sur le cours de la Révolution : cette séquence constituerait la phase sombre de la Révolution marquée par la violence, l’égalitarisme niveleur, etc. Il s’agit pour eux de « déjacobiniser » la Révolution mais aussi de « déjacobiniser » la gauche française. Il y a, tout particulièrement chez François Furet, une visée politique manifeste derrière un travail historique réel. Le jacobinisme est associé à la gauche communiste, étatiste, centralisatrice, autoritaire, etc., à une époque où le PCF est très puissant. D’une certaine manière, le jacobinisme annoncerait le « totalitarisme communiste du XXe siècle » et il faudrait s’en débarrasser. Cette vulgate sera diffusée par les « Nouveaux philosophes » mais aussi par les partisans de Michel Rocard au sein du Parti socialiste. Il y aura énormément d’échos dans la sphère médiatique à ce discours et même au cinéma. On pense au Danton d’Andrzej Wajda avec Gérard Depardieu, sorti en 1983, qui – alors que Danton fut pourtant un jacobin lui-même –, est une violente charge contre Robespierre et les Jacobins. Le film qui est une forme de charge contre la répression dans la Pologne du général Jaruzelski, associe ainsi communistes polonais et jacobins français. C’est peu dire qu’on ne sort pas des stéréotypes et des poncifs !
CS. Il faut bien avoir en tête les failles de cette interprétation du jacobinisme : le grand amalgame. On confond « Jacobins », « Montagnard », Robespierre, Saint-Just. Et l’on reste confiné dans une histoire des idées et non des pratiques historiques des acteurs. Par ailleurs, l’analyse d’un François Furet est sur le fond structurée par les enjeux qu’il perçoit comme ceux du XXe siècle : la toute puissance de l’État, l’affirmation des totalitarismes, etc.
GRQ. Aujourd’hui, il y a, incontestablement, un affaiblissement de la référence au jacobinisme presque réduite à cette association – infondée, on l’a vu – entre « jacobinisme » et « centralisation ». Pourtant, demeure la trace d’interprétations plus progressistes. Pour ne prendre que cet exemple, la voix de Ferrat résonne encore dans une partie de notre peuple. Tant que la Révolution française vivra dans la conscience nationale, les jacobins seront toujours avec nous.
Cet entretien est la version intégrale de l’entretien publié dans Les lettres françaises
Haro sur les Jacobins, Guillaume Roubaud-Quashie et Côme Simien. PUF. 19 euros
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil