
Ray CELESTIN : « Mafioso »
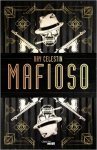
C’est simple et bien écrit : ça commence par des chapitres comprenant sous la date l’heure (cela fait, à l’occasion une sorte de flash-back, comme au 5)… Mais cela ne va pas sans obscurité plus ou moins occasionnellement : « J’ai eu l’impression d’être revenu dans l’hôpital de campagne de Saipan » (p 94) ; car je ne suis pas certain d’avoir tout lu ou j’ai pu oublier ! Mais je suis certain d’avoir tout lu : « C’est pour ça qu’il avait fait venir Ida de Chicago » (p 97). Et c’est un traité de criminologie ou de diverse délinquance (grâce aux exergues précédant les regroupements de chapitres), et c’est un roman historique (car ça fourmille !), et c’est un roman policier (à cause des deux enquêtes qui finissent par se rencontrer), et c’est un ouvrage traitant des milieux du jazz (surtout noirs, époque oblige (nous sommes en 1947 !) …, et c’est un roman où les conditions météorologiques jouent leur rôle !
Outre celles reproduites des pages 94 et 97, quelques citations qui prouvent le réalisme auquel l’auteur se soumet :
« Michael sortit du métro à Canal Street et plongea dans l’agitation de l’heure de la pointe du sud de Manhatan, le quartier des affaires, de la circulation heurtée, des trottoirs saturés, le tout dans les volutes de vapeur qui s’échappaient des grilles de ventilation » (p 188, on remarquera la précision de la description qui va jusqu’à la paraphrase le quartier des affaires !). Ou « Louis avait une nouvelle épouse qu’Ida ne connaissait pas. Ils parlèrent de ce qu’ils avaient vécu ces deux dernières années, se donnèrent des nouvelles de la Louisiane. Ils évoquèrent le bon vieux temps, à La Nouvelle-Orléans et à Chicago » (pp 235-236, ça confine au bavardage !) ou « Impitoyable patron d’un des quartiers les plus agités York, trafiquant de drogue, maître chanteur, maitre du cran d’arrêt, c’était aussi un homme à la carrure mince, qui s’habillait avec classicisme et lisant des livres de philosophie. Il avait passé trois ans - sur dix - en isolement carcéral et s’en était sorti en décrivant de la poésie » (p 279, c’est un des portraits de malfrats les plus attachants et les plus originaux, et je m’y connais ! ). Ou « Il se leva et alla à la table basse où il écrasa son mégot. Tout en pulvérisant les dernières flammèches, son regard se posa sur le canapé-lit. Ce canapé-lit tout dur et compact. Il s’interrompit, écarta la table basse, retira les coussins du canapé-lit et le déplia » (p 309, bel exemple de description d’une action, ce qui ne manque dans le roman …). Ou « Il quitta la salle, descendit les escaliers et se retrouva dans la fraîcheur matinale new-yorkaise. Helms et sa garde rapprochée étaient aussi sur le trottoir devant s deux Cadillac » (p 342, idem, mais l’action avance). Ou « Gabriel parcourut le secteur de Hell’s Kitchen, Chelsea, Midtown. Les docks de l’East Side. Il alla dans les quartiers chauds où Faron repérait ses victimes, les terrains vagues où il se débarrassait des corps » (p 358, idem, l’action se passe à New-York et l’action avance). Ou « … l’industrie du cinéma avait choisi de sacrifier les Dix d’hollywood. Comme quoi, les gens élisent leurs méchants de la même manière qu’ils élisent leurs dirigeants » (p 522, profonde vérité !). Ou encore : « Mais qu’est-ce qu’elle a fait pour nous, la société ? La civilisation ? Vraiment ? Ça nous a apporté quoi ? La bombe atomique et les camps de concentration ! Si c’est tout ce que la civilisation a à nous offrir, je crois que je vais essayer autre chose » (p 580, c’est d’un certain GC, lieutenant de police de son état, il est vrai que le caractère employé imite à la perfection ceux utilisés lors des audiences des tribunaux !) …
Cela se termine par une postface où le romancier explique les libertés prises avec le réalisme ou l’histoire : dates, l’anticommunisme, la rencontre Costello/MacCarthy qui rend plausibles les décisions de la Mafia, le blizzard de 1947 qui eut lieu quelques semaines plus tard …
Il n’en reste pas moins vrai que les USA sont le pays des inégalités sociales (accentuées par la Mafia), de l’hystérie anticommuniste et du racisme …
Ray Célestin : « Mafioso ». Editions le Cherche-Midi, 700 pages, 23 euros. En librairie.
Emmanuelle PIROTTE : « D’innombrables soleils ».

Christopher Marlowe (1541-1593) est un dramaturge, poète et traducteur de l’ère élizabéthaine. Emmanuelle Pirate s’attache à le faire revivre dans son nouveau roman, D’innombrables soleils ; même s’il faut croire Wikipédia , il se livra pendant son séjour à l’université à des activités d’espionnage. Emmanuelle Pirotte manie à merveille le suspens : ainsi page 23, ou pour l’imprévu ainsi page 27. On se prend à imaginer que c’est pour elle, Jane, qu’il écrit ses pièces, ses personnages féminins ou qu’il veut les réécrire (page 30)…
Marlowe est homosexuel, menteur, ivrogne, mais attachant (mais c’était une époque où l’homosexualité entre hommes était courante) : il mène une vie mystérieuse et violente ; la romancière s’est bien documentée sur son existence et elle est parfois hard, comme au chapitre 5, sur le mode du fantasme, peut-être… Lettres et roman traditionnel sont mêlés. Je ne sais pas si les poètes ont un sens supplémentaire (p 52), sont comme Emmanuelle Pirotte les imagine ; dès lors, le roman va devenir l’histoire des relations entre Jane et Christopher : Jane assiste, impuissante, au naufrage du poète (p 57). C’est entre-coupé de descriptions sur la rencontre de Walter avec celle qui allait devenir son épouse (chapitre 7), c’est entre-coupé de citations comme celle-ci : « La pièce sentait la chair malade, les fluides et la transpiration » (p 60) : on a l’impression que la fin de Marlowe est proche après ce qui lui est arrivé à Deptford. Dans le chapitre suivant, la romancière fait raconter les circonstances qui allaient ramener, Christopher Marlowe, blessé chez ses hôtes. Et sur les débats qui opposent Christopher et Walter… Cela ne va pas sans marivaudages, même physiques, comme au chapitre 9. Mais les lettres des amoureux adultères font le point sur l’évolution de leurs sentiments, Walter étant homosexuel occasionnellement (p 120 et pp 144-145)… Des considérations stylistiques viennent émailler le chapitre 13, agrémentées, si l’on peut dire, d’une bagarre entre Christopher et Walter… L’aveu des relations amoureuses entre Jane et Christopher vent ajouter son piquant de sel au récit. Page 135 (chapitre 14), ça commence par le retour de Jane et une scène très sensuelle, très érotique. Prise par sa passion pour Marlowe, Jane affirme son désintérêt pour la pièce qu’elle est en train d’écrire : « une femme s’obsède jusqu’à la nausée, désire jusqu’à la fureur, jusqu’à l’extase religieuse ou la souffrance la plus intolérable, jusqu’à la plus parfaite dissolution ; elle de noie, s’émiette, se dissout dans la passion » (p 151). Emmanuelle Pirotte porte un intérêt très vif au personnage de Marlowe ; au lieu de cela, Jane écrit une lettre à ce dernier… (pp 154-155).
La romancière se livre au mentir-vrai, d’une manière ou d’une autre. Emmanuelle Pirotte sait pertinemment qu’au-delà de la référence aragonienne, en dépit de la scène qu’elle décrit, que Marlowe est mort à Deptford, le 30 mai 1593 (son décès est entouré de mystère : il est décrit comme espion, bagarreur, hérétique)… Mais elle imagine une autre fin : « Vos tragédies manquent de femmes, Monsieur Marlowe » (p 25). C’est à ce moment-là que lui vient l’idée des Amazones qui ne gardent en vie que « leurs enfants femelles et tuaient les mâles ou les conservaient en esclavage » (p 173). Mais il étend cette comparaison à la reine Elizabeth (p 174) : méditation sur le pouvoir ? Et si le roman tout entier était une méditation sur le pouvoir ? Mais Jane est transfigurée par l’amour, par la passion. Et si Héro et Léandre était le véritable sujet du texte que le lecteur est en train de lire ? Et si l’ensemble des ouvrages écrits par la romancière annonçait Loup et hommes créé en 2018 ? Et le Nouveau Monde (p 195) ? En vérité, la vie de Marlowe avec Jane, est vouée à l’échec : « jouir pour ne pas souffrir » (p 205). Et si le sort de Marlowe n’était que « de ne plus pouvoir écrire et voir jouer ses pièces » (p 206) ? Dans l’épilogue qui sert de fin au roman, dans la lettre que Jane écrit à Christopher Marlowe, je relève ces citations : « Avais-je imaginé que je reconnaîtrais parmi elles ta chère silhouette, vive et légère, glissant mes côtés pour un brin de conduite, dans la nuit qui descend ? » (p 235). Jane note : « tu étais mort » (idem) avant d’écrire : « Tu avais cessé d’être, à cet instant précis où j’ai cru te sentir mes côtés » (id). Emmanuelle Pirotte, bien que connaissant les conditions du décès de Marlowe telles que les rapporte la tradition, innove en cette fin de l’ouvrage… « Je rêve souvent que tu es allongé prés de moi. Tu es endormi, je te pousse, je te fais rouler sur le ventre et je te pénètre. Non pas avec mes doigts, mais avec le sexe d’homme que je possède » (p 236). Avant qu’elle n’ajoute : « Je crois aujourd’hui que c’était ton choix de ne pas donner de fin à cette histoire d’amour et de mort. Qui devient une histoire d’amour et de vie, à jamais suspendue au bord d’une aube nouvelle. » (p 239). Ce sera le mot de la fin : la romancière a renouvelé la fin de son livre, sans trop y toucher…
Emmanuelle Pirotte : D’innombrables soleils. Editions du Cherche-Midi, 240 pages, 18 euros. En librairie.
Thierry VIMAL : « 19 tonnes ».

Après 3 romans publiés aux éditions de l’Olivier (de 2002 à 2005) et un quatrième chez Erick Bonnier en 2013, Thierry Vimal a choisi (pour lui permettre de survivre ?) de raconter par le détail l’assassinat de sa fille le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice. Le responsable du meurtre d’Amie, lui ressemble comme un clone (p 70, « A l’exclusion de sa violence conjugale, ce gars était mon clone. »), le narrateur prépare les obsèques de sa fille, entouré des sympathies de circonstances… Les alentours de la page 104 sont particulièrement émouvants avec la visite de la nécropole et l’histoire de la photographie d’Amie, on passera sur les pages où la prière, le prêtre, le Christ et mère Teresa sont omniprésents -p 137- (mais sans doute le narrateur a-t-il besoin de ces passages)… Thierry Vimal écrit un grand texte (sinon un long texte) comme il le dit page 133. Mais « la musique religieuse ne favorise pas mon recueillement » (p 150). Injustice, culpabilité d’avoir associé son chagrin à Laurette ; Vimal n’en finit pas de crier sa douleur. Il y a trop de références à Dieu : « Le père de l’agnelle de Dieu ploie ce soir sous la fatigue, (…), laissez-moi me retirer dans la cahute, avant ma métamorphose en soldat de Dieu » (p 197). Les journalistes sont des charognards évidemment, les Playmobil sont en trop (p 230), trop de relou (p 407), trop de Papounet (p 407), trop de cool (p 232)… On n’a pas les mêmes chanteurs en commun : moi, c’est plutôt Ferré, Ferrat, Brassens ou Bertin. « L’angoisse m’étreint le cardia oesophagien comme une lente de pou géante » : j’aime bien cette phrase, allez savoir pourquoi ! Sans doute, parce que ça résume bien le climat du moment … On a droit même aux descriptions des cauchemars cauchemars : « Tu imagines ma peur, Thierry ? Tu crois que dans mon état je suis prête à être réveillée par des hurlements ? On ne peut plus dormir ensemble, c’est impossible » (p 318). C’est écrit, parfois, dans un style bâclé , comme si le romancier avait besoin de ce style : « Les copines se sont carapatées » (p 342 ) … C’est trop long, je me répète : Thierry Vimal avait peut-être besoin de consigner tous ces moments pour évacuer sa douleur ; j’espère qu’il me pardonnera quand je m’énerve et que je fais mon travail de lecture … A la date du 2 septembre, c’est la dispute : « je suis complètement opposé au partage des locaux avec l’Hégémonie » (p 531). A celle du 3 septembre, les caractères changent trop, ce qui gêne le confort de la lecture (normaux ou courants, italiques, normaux maigres, capitales d’imprimerie). Page 577, on a droit à un traité sur l’islam et sur l’islamologie (« Comme quoi les musulmans s’expriment ! Mais leur parole doit être davantage relayée ! ») ; tout cela se poursuit par une déconstruction de Daesch. Il a trop de personnages (p 594), trop de mots d’amour (« ma puce, ma petite puce d’amour ») (p 594) : mais toute la tendresse est là ! « Le seul pays du monde à avoir conservé cette tradition d’ordonner des femmes imams, c’est la Chine communiste ! » (p 580) ; mais c’est la totalité des pages 577 à 590 qu’il faudrait citer.
Un roman à lire à condition de faire le tri ! Je m’interroge quand même : est-il bien nécessaire de trier car l’auteur a sans doute procédé au tour de la forme journal littéraire ? On lui pardonnera bien volontiers : « Vous n’en avez pas assez pris dans la tronche pour vous en rendre compte... » (p 667). « Amie douze ans… percutée… Combien de fois encore faudra-t-il le dire et l’écrire ? » (p 697). La séparation est proche (p 700)… Entre les fractions divergentes di conseil d’administration de l’association des victimes du 19 tonnes et les péripéties personnelles des dits adhérents ou les dissensions du couple Thierry / Sophie, on a du mal à s’y retrouver. Comme à la page 815, il y a trop de grossièretés du type « Putain ou Merde » ! Comme à la page 819, le ton de Sophie reste rempli d’insultes et de naïvetés, ou du moins hésite-t-il… Echanges de mails, de fax ou de messages web sans transition avec le texte du livre : ça ne facilite pas la lecture ! « Nous ressemblons à ce que nous sommes et tout est la Grâce d’Amie » : ce seront les mots de la fin !
Thierry Vimal : « 19 tonnes ». Le Cherche-Midi éditeur, 1001 pages, 25 euros. En librairie.
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil