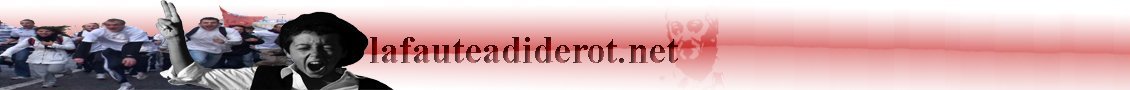
Marianne, de Philippe Foussier
Marie et Anne, la Vierge et sa mère, unies dans la sainteté, ont donné le prénom « Marianne », devenu symbole de la République française.
Depuis le 21 septembre 1792, quand la Convention nationale choisit, sans la nommer encore, « une femme vêtue à l’antique, debout, tenant dans la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la liberté, la gauche appuyée sur un faisceau d’armes, à ses pieds un gouvernail » pour représenter l’Etat et la République, Marianne a connu un parcours compliqué, semé d’embûches, tantôt oubliée, tantôt exaltée.
Les premiers bustes apparurent dans quelques mairies dès 1793 mais ce n’est que lentement que cette figure emblématique intéressera les arts. Pour que Marianne, comme symbole et comme nom s’impose, non sans contestations et rejets, il faudra attendre la fin du XIXe siècle.
Philippe Foussier, ancien Grand Maître du Grand Orient de France, journaliste à… Marianne, met en perspective son parcours chaotique mais persévérant en l’inscrivant dans les soubresauts de l’histoire républicaine et de ses aléas. Le Sud de la France lui sera plus favorable que le Nord. Les Marianne présenteront des différences selon les lieux et les orientations politiques.
« Selon les sensibilités politiques, précise l’auteur, on représente des Marianne tantôt en mouvement, affublées de symboles renvoyant à l’égalité, comme le niveau, et portant bonnet et cocarde tricolore, ou alors des Marianne au visage impassible, à qui la couronne de laurier, l’étoile ou les rayons solaires tiennent lieu de coiffe. Cette différence de tempérament politique se remarque encore aujourd’hui dans des mairies ou des régions aux sensibilités historiquement marquées. Il faut ici rappeler que la présence de Marianne dans une mairie n’est nullement obligatoire et qu’il n’en existe aucune représentation officielle ailleurs que sur les papiers à en-tête de la puissance publique, le cas échéant sur les timbres-poste et les pièces de monnaie. »
Au fil des pages, nous découvrons que nous connaissons bien mal cette Marianne, une et plusieurs, qui nous semble pourtant si familière.
La seconde partie de l’ouvrage, artistique, propose un choix d’œuvres significatives, depuis le premier sceau de la République de 1792 jusqu’à la superbe Marianne taguée de Christian Guémy, dit C215, de 2024, en passant, par exemple, par cette Marianne noire maçonnique attribuée, avec des doutes, au sculpteur toulousain Bernard Griffoul-Dorval (1788-1861). Réalisée en 1848 à la demande des loges toulousaines, elle marque la seconde abolition de l’esclavage.
Caricaturée par les ennemis de la République, Marianne résistera aux outrages pour resurgir en cinq Républiques, sous des atours différents mais toujours avec la même dignité.
Marianne, Philippe Foussier. Editions Dervy. 12,90 euros
Léo Taxil, le prince des fumistes, de Robert Rossi
Tous les Francs-maçons et les antimaçons ont entendu parler de « l’affaire » Léo Taxil. Peu en connaissent tous les ressorts. Ce livre est une opportunité de découvrir toutes les dimensions psychologiques, sociologiques, historiques, politiques des événements considérés.
L’ouvrage est tiré de la thèse de doctorat d’Histoire contemporaine soutenue à l’Université d’Aix-Marseille par l’auteur en 2014.
Gabriel Jogand-Pagès (1854-1907), Léo Taxil est tout d’abord un acteur majeur de la jeune presse satirique radicale marseillaise sous la République monarchiste de 1871 à 1879.
Son parcours, pour le moins ambivalent, le fait aisément passer d’un camp à un autre dans un contexte politique très polarisé entre républicains modérés et conservateurs. Robert Rossi ne se contente pas d’étudier les mystifications de Léo Taxil, il s’intéresse à la totalité de son parcours, témoignage d’une société agitée et pleine de contradictions.
« En quoi, s’interroge-t-il, ce polémiste marseillais est-il révélateur des problèmes de son temps, complètement investi dans les luttes féroces que se livrent républicains laïcs et catholiques conservateurs ? En quoi en outre son engagement dans le journalisme marseillais illustre-t-il le rôle des jeunes générations en politique ? Quel a été son rôle dans l’affirmation d’une presse fondée sur « le rire comme force capable de bousculer l’ordre établi » en ayant recours au canular et à la parodie ? Au-delà, comment aborder en tant qu’historien la biographie d’un homme qui aura pratiqué, tout au long de sa vie, la duperie, la supercherie et la mystification ? »
À travers l’analyse très fine des composantes politiques de l’époque et de leurs interactions, c’est aussi la fonction du rire des fantaisistes d’alors qui est interrogée. « Leur rire est de nature explosive : même anodin, il comporte une charge subversive. »
En 1879, Léo Taxil est républicain radical, libre penseur, anticlérical et Franc-maçon. En 1885, il est conservateur, croyant et antimaçon virulent : « la Franc-Maçonnerie est l’œuvre personnelle de Satan, sa religion, son culte, en même temps que sa milice parmi les hommes et son foyer de corruption sur la terre » écrit-il dans l’un de ses livres.
Il développe l’idée d’un culte satanique autour de l’affaire Diana Vaughan et crée une Ligue du Labarum antimaçonnique. Surfant sur le développement de la presse, ses prises de position ont beaucoup d’échos, suscitent maintes polémiques et aussi une forte résistance.
Robert Rossi nous fait tout d’abord découvrir dans le détail le parcours de ce « jeune dévoyé marseillais : « moule catholique, « marmite radicale », avant « l’expérience révolutionnaire marseillaise de 1870 ». La deuxième partie de l’ouvrage traite du journaliste pamphlétaire et des tentatives politiques très oscillantes de Léo Taxil. La troisième partie aborde le retour à l’anticléricalisme de 1879-1884, la libre pensée et son rapport à la Franc-maçonnerie. La quatrième partie présente et analyse la mystification elle-même (1885-1907) depuis sa conversion jusqu’à la révélation de la conférence du 19 avril 1897, en passant par l’invention du palladisme. Au cours de cette conférence, il livre nombre d’aveux, justifie son parcours chaotique par l’art de la fumisterie. Les réactions sont nombreuses dans les milieux catholiques, marseillais, maçonniques et antimaçonniques (souvent antisémites) occultistes, politiques et entraînent des conséquences judiciaires pour l’intéressé.
Si l’affaire Léo Taxil a eu un grand retentissement, l’antimaçonnisme s’est rapidement remis du choc pour un nouvel essor. Des éléments construits par Léo Taxil continuèrent de ressurgir, parfois à l’identique ou réinterprétés, pendant des décennies.
L’étude de la mystification ou des mystifications orchestrées par Léo taxil permet de mieux comprendre les subtilités de la relation entre mystificateur et mystifiés, un sujet très actuel. Si la personnalité de Léo Taxil continue de nous échapper en partie, son histoire nous apprend beaucoup sur l’époque, sur « les antagonismes profonds et du conflit impitoyable que se livrent pouvoirs civils et religieux dans un monde en totale mutation ». Mais, les mécanismes psychologiques qui ont permis à ces mystifications de prendre sont aussi vivaces aujourd’hui qu’hier.
Léo Taxil, le prince des fumistes. Robert Rossi
Editions La Tarente, Mas Irisia, Chemin des Ravau, 13400 Aubagne – https://latarente.fr/
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil