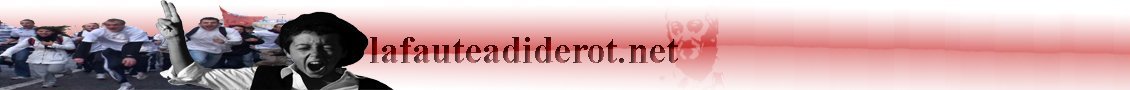
A l’initiative de la Fondation Gabriel Péri, le psychanalyste Djamel Abssi a participé le 23 août 2025 à un atelier lors de l’université d’été du PCF sur le théme "Pourquoi la psychanalyse aujourd’hui ?" Nous publions son intervention.
Pourquoi encore et toujours tenir compte de de la spécificité de la psychanalyse, à savoir d’une part l’inconscient, comme Freud, et après lui beaucoup d’autres le proposent et d’autre part que la cure analytique est une cure par le langage ? Je livre quelques repères en guise de préambule.
Il y a 125 ans Freud publiait son Interprétation des rêves [1] et 5 ans après il publiait ses Trois essais sur la théorie sexuelle. On le reconnaît aujourd’hui, ce sont deux ouvrages, parmi tous les autres [2], qui montrent l’apport du père de la psychanalyse à la connaissance de ce qui fait l’humain. Ces apports, comme beaucoup d’autres, ont dû affronter les pensées de l’époque et certaines ont finalement été acceptées avant ou après la mort de Freud.
Deux exemples de ces apports freudiens qui ont du faire leur chemin :
- la bisexualité qui est en chacun de nous.
- et un regard différent sur l’homosexualité. En 1935, Freud, sollicité par une mère qui craint que son fils soit homosexuel, lui explique, dans une lettre, que l’homosexualité n’est pas une maladie, ni une perversion, et il ajoutera que les homosexuels n’ont pas à être convoqués dans les tribunaux ni à être emprisonnés. Alors qu’en 1960, 25 ans après la lettre à la mère, une loi française classe l’homosexualité parmi les fléaux sociaux. Et en 1965, l’OMS définit l’homosexualité comme une maladie mentale. C’est en 1981, 46 ans après, que le ministère de la Santé renonce à cette classification.
Cet exemple de l’homosexualité pose, à lui seul, la question du rapport entre la psychanalyse et la société, pas seulement au moment où la discipline fait ses premiers pas mais tout au long de ce long temps où les deux, la psychanalyse et la société, évoluent, se modifient.
Si hier la psychanalyse a montré, même à contre-courant, même avec ses erreurs, sa pertinence, et a beaucoup apporté notamment sur le registre de la santé mentale, qu’en est- il aujourd’hui ? Est-elle mise à contribution dans les débats d’aujourd’hui ?
Deux questions, qui ont un rapport avec l’actualité, à titre d’exemple pour illustrer l’intérêt d’interroger la discipline :
1 - Que faire, dans les débats d’aujourd’hui, notamment sur les questions de genre, de la mise en avant par Freud de la bisexualité qui existe en chacun de nous ?
2 - Que faire, à propos du destin de l’espèce humaine, de ce que Freud écrit en 1929 dans Malaise dans la civilisation [3] : …dans quelle mesure l’espèce humaine réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l’humaine pulsion d’agression et d’auto-anéantissement ?
Je poursuis mon préambule. J’ai évoqué l’homosexualité qui a encore fait l’actualité, il y a quelques mois, grâce à une pétition pour saisir l’Union Européenne sur le fait que plus d’un pays sur deux de l’Union Européenne acceptent, aujourd’hui encore, sur leur territoire des thérapies dites « réparatrices » pour « guérir » de l’homosexualité, considérant qu’il s’agit donc d’une maladie.
Maintenant, ma première réponse à la question « pourquoi la psychanalyse aujourd’hui ? » est : parce qu’elle a déjà beaucoup apporté en un siècle. Je donne quelques repères.
Lors d’un congrès, le 5ème congrès international de psychanalyse, en 1918, Freud se met à faire une prédiction dans une intervention, il dit : « La conscience sociale s’éveillera et rappellera à la collectivité que les pauvres ont les mêmes droits à un secours psychique qu’à l’aide chirurgicale (…) A ce moment-là, poursuit-il, on édifiera des établissements, des cliniques ayant à leur tête des médecins psychanalystes qualifiés et où l’on s’efforcera, à l’aide de l’analyse de conserver leurs résistances et leur activité à des hommes,… à des femmes,... et à des enfants. Nous nous verrons alors obligés d’adapter notre technique à ces conditions nouvelles… Mais quelle que soit la forme de cette psychothérapie populaire… les parties les plus importantes et les plus actives demeureront celles qui auront empruntées à la psychanalyse dénuées de parti pris… ».
Cette prédiction de 1918 du père de la psychanalyse a été réalisée notamment en France. Des psychanalystes contribuent à l’édification de la pédopsychiatrie, et les consultations de psychanalystes s’inscrivent dans la plupart des dispositifs d’accueil destinées aux enfants progressivement mis en place. Dès 1925 Georges Heuyer, le fondateur de la psychiatrie française, accueille dans son service hospitalier la psychanalyste Eugénie Sokolnika, puis Sophie Morgenstern, suivies notamment par Françoise Dolto et Jenny Aubry.
Le Centre Claude-Bernard, fondé en 1946 à Paris sous l’égide du Général De Gaulle voit sa direction confiée à deux psychanalystes dont le Professeur André Bergé qui dirige la partie médicale. A la suite d’autres Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont créés dans toute la France. Pour la santé mentale en général, pour l’enfance et la jeunesse, pour la culture, l’apport des psychanalystes a été et est essentiel.
J’en profite, puisque je suis dans le cadre d’une université du PCF, pour dire que si la psychiatrie publique évolue à cette époque grâce à l’apport de psychanalystes, c’est aussi grâce à l’impulsion de militants communistes dans le secteur de la santé comme avec le psychiatre Lucien Bonnafé [4] . On lui doit beaucoup à Lucien Bonnafé parce que pour lui, aliénation mentale et aliénation sociale ne sont pas sans rapports.
En bref, en un siècle, la psychanalyse, c’est-à-dire les psychanalystes, ont beaucoup fait preuve de pertinence et ont beaucoup apporté à la société. Je n’oublie pas que la psychanalyse a joué sa part dans l’évolution de la pensée contemporaine et beaucoup de ses concepts sont aujourd’hui des outils pour des praticiens comme pour des chercheurs, et certains d’entre eux font partie du langage courant. Un exemple de concept pas trop méconnu, c’est celui de pervers polymorphe. Pervers polymorphe est une caractéristique que Freud attribue aux tout petits enfants (en maternelle) pour dire qu’ils sont à la recherche de ce qui peut se faire ou de ce qui ne peut pas se faire, ces petits sont des chercheurs de la limite. Le concept est un peu connu dans le monde éducatif et il lui a permis d’argumenter pour s’opposer à une proposition du Président Sarkozy consistant à signaler les enfants de maternelles ayant un comportement pas correct. Le Président pour cette proposition avait comme conseiller un certain Jean Michel Blanquer.
J’en reviens à la question « Pourquoi la psychanalyse aujourd’hui ? ». Quelle particularité a ce « aujourd’hui » par rapport à la psychanalyse ? Selon moi, il y a au moins deux dimensions à ce aujourd’hui :
- d’une part les effets des évolutions de la science,
- d’autre part, les effets du néolibéralisme.
Je commence par les évolutions des sciences, en prenant que l’aspect médical [5]. Les apports de la psychanalyse pour la santé mentale sont peu médiatisés bien que réels et font l’objet d’une exploration constante par des chercheurs du monde entier sur les plans technique, thérapeutique et théorique [6]. Les résultats ne sont pas pour rien dans le fait que depuis 1997 des sociétés et associations analytiques obtiennent le statut d’association d’utilité publique [7]. Par facilité pour moi, j’utilise un argument d’autorité en rappelant que Gérald EDELMAN, neurobiologiste et prix Nobel de médecine a dédié ses travaux sur l’esprit à Freud et à Darwin, l’un comme l’autre pionnier intellectuel. Dans l’un de ses ouvrages, il déclare « correcte scientifiquement parlant » l’hypothèse de l’Inconscient et juge le refoulement freudien « compatible » avec sa théorie de la sélection des groupes neuronaux [8]. Si cela vous intéresse, alors j’attire votre attention sur un livre de François Gonon, neurobiologiste, dont le titre est Neurosciences, un discours néolibéral, psychiatrie, éducation, inégalités, aux éditions Champ Social [9].
Cette situation face aux évolutions scientifiques n’est pas sans erreurs des psychanalystes et sans batailles notamment contre un classement se présentant comme officiel, un classement des troubles mentaux le DMS (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Discorders). Effectivement les médecins doivent actuellement coter leurs actes selon une classification orientée par le DMS 5 américain.
Dans une lettre adressée aux candidats aux élections législatives, des praticiens de la souffrance psychique affirment que ce manuel de l’Association Psychiatrique Américaine (APA) ne correspond pas à la clinique. Ils ajoutent que cela donne un catalogue d’un grand nombre de « troubles » aux contours flous propices à la médicamentation. Ne conviendrait-il pas, interrogent-ils, de s’en tenir aux critères de la grande psychiatrie européenne qui sont d’ailleurs communs à la psychanalyse ?
En fait, la psychanalyse aujourd’hui encore, participe après la perspective intrapsychique à ouvrir et à laisser ouverte la perspective interpsychique c’est-à-dire relationnelle. C’est dire que la dimension sociétale compte et donc la politique aussi.
Avant de développer la deuxième dimension de ce « aujourd’hui » à savoir l’effet du néolibéralisme, je dois préciser qu’il n’y pas à s’étonner que les psychanalystes du moins les freudiens, dont font partie les lacaniens, s’intéressent à l’évolution de la société. C’est même une question théorique. Pour les Freudiens ce qu’on peut appeler le psychisme ou l’appareil psychique d’une personne, d’un sujet, compte trois instances nommées par Freud : le Moi, le ça et le surmoi. Or le Moi d’un sujet est notamment construit par rapport aux autres notamment par identification. Lacan nous dit même, dans son premier séminaire, que le Moi est la somme des identifications. Au moins, c’est dire que le rapport à l’autre compte. Le ça est le siège des pulsions qui ont chacune un but et un moyen, plus précisément un but et un objet pour satisfaire cette pulsion. Or l’objet peut être une personne (comme on dit « cette personne est l’objet de toutes mes attentions »). C’est dire, là aussi que le rapport à l’autre compte. Plus fort encore c’est le Surmoi. Le Surmoi qui est la somme des règles, des lois, de la morale, de l’éducation, des interdits… bref une série d’éléments qui amène le sujet à pas faire n’importe quoi (sauf si il a un très faible Surmoi). Le Surmoi civilise d’une certaine façon. Or chacun voit bien que l’éducation, la morale, les interdits varient selon la société dans laquelle le sujet vit. C’est dire, là aussi, que le rapport à l’autre et à la société compte.
Rien d’étonnant donc que les psychanalystes s’intéressent aux évolutions de la société. Depuis plus de trente ans, l’intérêt des psychanalystes pour les effets de la société sur la subjectivité est très visible notamment dans l’édition. Il n’y a qu’à voir les ouvrages signés par les psychanalystes contemporains. Je cite par exemple l’essai de Clotilde Leguil Céder n’est pas consentir et le livre de Gérard Pommier Occupons le rond-point [10]. On peut aussi voir les titres des rencontres et colloques au sein de la communauté analytique, dont le séminaire de Louis Raffinot, Olivier Duris et Jérémie Clément : Le numérique et ses incidences subjectives ou le colloque titré Folies du monde, monde de la folie [11]. Ou encore on peut assister à la double conférence sur la place de la vérité que donneront le philosophe Gérard Bras et le psychanalyste Louis Sciara en mai 2026, organisée par l’association Autant Le Dire [12].
Sur l’apport de la psychanalyse un ouvrage est précieux celui de Pascal-Henri Keller et Patrick Landman dont le titre est Ce que les psychanalystes apportent à la société aux éditions Erès.
Et maintenant j’aborde ce « aujourd’hui » et la politique néolibérale.
La folie du monde est là. Ce n’est pas d’aujourd’hui diront certains, à juste titre. Mais aujourd’hui, surtout depuis moins d’un an, elle prend une forme particulière avec le trumpisme qui est la rencontre entre une foule aux abois et un milliardaire sans limite en place de sauveur. Et puis la personne Trump elle-même est une figure symbolique, pas n’importe laquelle mais une incarnation d’une force pulsionnelle sans filtre. Les américains ont choisi comme sauveur un prédateur qui joue au Monopoly en guise de géopolitique. Je prêche certainement à converti mais j’ajoute que c’est également au nom de sa loi de sa jouissance, qu’il se fait porte-parole désinhibé et pour une part désinhibant d’une foule en donnant corps et voix aux fantasmes les plus nauséabonds.
Je continue mon prêche en soulignant qu’il y a un Culte de soi et une haine de l’autre. Ainsi comme Freud le remarque en 1929 dans son ouvrage Malaise dans la civilisation : « il est toujours possible d’unir par des liens de l’amour une plus grande masse d’hommes, à la seule condition qu’il en reste d’autres, en dehors d’elle pour recevoir les coups ». Quelle actualité !
Je poursuis mon prêche à converti avec un prisme analytique. On peut voir en Trump le représentant du père de la Horde sauvage, mythe créé par Freud dans son ouvrage Totem et Tabou, en 1913 : un père sans limites, hors la loi, qui échappe à cette règle qui nous dit que tout, tout avoir ou être tout est impossible, il y a toujours du manque, il échappe à ce que les psychanalystes appellent la castration. Cela lui donne, il se donne une position que rien n’arrête et qui n’a de comptes à rendre à personne. C’est au nom de la loi de sa jouissance, qu’il élève la perversion au rang de système de gouvernance [13].
On commence à envisager les effets sur la subjectivité.
La psychanalyste Danièle Epstein ajoute que La folie du monde est aussi la folie de l’homme qui lui est aliéné. Politique et subjectivités s’imbriquent, se court-circuitent, se nouent. Nous incorporons les représentations du monde contemporain aujourd’hui celles du néolibéralisme. C’est ce qu’un autre psychanalyste dit, bien avant elle, Jacques Lacan avec cette formule : « l’inconscient c’est la politique ».
En mettant en acte un ultra capitalisme dérégulé, Trump et la très très grande bourgeoisie qui le soutient s’attaquent à ce que Freud appelait le travail de civilisation, c’est à dire qu’ils s’attaquent à une construction symbolique qui éloigne l’homme de l’animal et lui permet de faire société sans s’entre-tuer. De plus le symbolique pour les psychanalystes, les lacaniens, désigne le domaine du langage, des signes, des structures sociales, qui accompagnent voire organisent la compréhension de ce qui nous entoure. Le symbolique c’est ce qui permet de nommer et de donner sens aux choses et de les saisir. Le symbolique joue un rôle important dans la structuration de la subjectivité.
Freud nous a prévenus : la société, nous dit-il, est constamment menacée de ruine suite à une hostilité primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres, entendons si le travail de civilisation perd de sa force.
Pour ce qui est des effets aujourd’hui sur la subjectivité de chacun d’entre nous, j’ai évoqué très rapidement que la perversion était élevée au rang de système de gouvernement. C’est quoi la perversion ? Je commence par une idée clé que nous propose Lacan pour évoquer le pervers. Lacan nous dit que le pervers est celui qui jouit de l’effroi, de l’angoisse qu’il crée chez l’autre, l’autre qu’il a choisi comme objet de sa perversion. Prenons l’image du pervers exhibitionniste, il ne se satisfait pas de montrer son sexe à un public, par exemple, mais de l’effroi qu’il voit sur les visages de ce public. L’acte pervers nous crée de l’effroi nous sidère et nous interroge, comment est-ce possible se dit-on ? Sans avoir de réponse.
Cette situation nous l’avons de nombreuses fois avec Trump et aussi en France.
Ce genre de situation répété, éventuellement avec d’autres facteurs, comme par exemple l’idée que s’exprimer ça sert à rien, ce que disent aussi à leur échelle les victimes de pervers [14], crée de l’angoisse et une angoisse qui peut être culpabilisante. Or, je vais très vite, or les psychanalystes savent écouter l’angoisse, savent écouter la souffrance et ce n’est pas la moindre des pertinences de la psychanalyse aujourd’hui. Depuis environ cinq ans plus d’un patient sur deux vient à mon cabinet pour parler de l’angoisse dont ils souffrent.
Si la psychanalyse, c’est-à-dire les psychanalystes, sont écoutés, en plus du travail clinique, alors la psychanalyse peut-être un des éléments pour composer les antidotes de la folie du monde.
Ecouter la psychanalyse peut aider à entendre d’où vient cette attaque féroce contre le travail de civilisation, ce travail qu’est la construction symbolique permettant justement le vivre ensemble comme disent certains aujourd’hui.
Comment le trumpisme a pu se faire une si grande place ?
Il y a plus de 20 ans est arrivé un nouveau concept pour la communauté analytique, le concept de nouvel économie psychique. Un concept qui fait débat mais dont l’intérêt est de montrer comment la société est fortement interrogée par les psychanalystes ? On doit le concept de nouvelle économie psychique au psychiatre et psychanalyste Charles Melman.
Il a commencé à le développer lors d’une conférence à Paris à l’occasion d’un congrès psychiatrique ayant pour sujet « l’Homme à l’épreuve de la société contemporaine ». Dans son intervention Melman avait défendu la thèse suivante : nous passons d’une culture fondée sur le refoulement des désirs, et donc la névrose, à une autre qui recommande leur libre expression et promeut la perversion [15]. Il poursuit en affirmant que la santé mentale relève ainsi aujourd’hui d’une harmonie non plus avec un idéal mais avec un objet de satisfaction. Il va plus loin en ajoutant que la responsabilité du sujet se trouve effacée par une régulation purement organique. Il dit tout cela en 2002, et 5 ans plutôt Jean Pierre Lebrun, psychanalyste belge, avait développé dans son livre Un monde sans limites, essai pour une clinique psychanalytique du social certaines idées similaires à celles de Melman à partir des changements sociaux qu’il observait.
Lebrun commenta la conférence de Melman en ces termes : « La nouveauté, la force et la pertinence de son analyse indiquent qu’il ne s’agissait plus d’évoquer de simples modifications du social et leurs incidences sur la subjectivité de chacun, mais d’examiner une mutation inédite en train de produire des effets. Des effets qui pourraient être majeurs et concerner autant l’individu que la vie collective… » [16]. Ces propos datent de 2002.
D’une certaine façon, je peux facilement dire que la psychanalyse, des psychanalystes nous ont prévenu, que la toute-puissance, le jouir sans contrainte et tout de suite pouvait marquer fortement la société. La psychanalyse aujourd’hui a sa pertinence parce qu’elle cherche en permanence les effets du monde contemporain sur la subjectivité.
La situation repérée il y a plusieurs décennies, et vécue aujourd’hui, est angoissante parce que, visiblement, elle peut entraîner le monde sur la voie de l’ensauvagement et de la décivilisation [17].
Alors que pour Freud, l’angoisse est aussi un signal qui peut permettre de se préparer au danger, mais nos mécanismes de défense (refoulement, déni, humour…) en nous préservant de l’angoisse, nous empêchent de prendre la mesure du danger et de mettre en œuvre les décisions qui s’imposent. Ces mécanismes de défense peuvent nous empêcher de transformer nos angoisses en angoisses positives. Au nom de la jouissance, nos mécanismes de défense ouvrent la brèche aux démarches mortifères avec pour effet de se précipiter dans ce qui est vital d’éviter. Danièle Epstein nous dit : « A ne pas vouloir se présenter le précipice, on s’y précipite ». Et cette situation souligne que l’écoute des personnes est aujourd’hui indispensable.
Pourquoi la psychanalyse aujourd’hui ? Parce qu’elle peut permettre, elle peut contribuer à ouvrir les yeux, comme elle l’a fait au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Une autre réponse encore. La psychanalyse peut être utile et est déjà utile aujourd’hui face à une pression sur les diagnostics afin qu’ils soient adaptés, correspondent, aux capacités de la pharmacopée plus qu’aux sujets. C’est une pression très forte aujourd’hui. A ce propos, si cela vous vous intéresse, je vous conseille la lecture du livre du psychiatre et psychanalyste Patrick Landman Tous hyperactifs ? L’incroyable épidémie de troubles de l’attention. Patrick Landman, lors d’une conférence sur son livre, il y a cinq ans, a expliqué qu’il existait, selon le classement DMS, un syndrome celui dit de trouble de l’opposition systématique. Il y a cinq ans on n’en parlait pas trop et ce diagnostic n’était pas encore attribué à des personnes. Aujourd’hui on en parle beaucoup de ce TOP, trouble de l’opposition. Il faut s’inquiéter car on va, peut-être, voir apparaître un médicament pour ce trouble. Par ailleurs le chercheur qui a proposé la ritaline pour les hyperactifs avec trouble de l’attention a déclaré, certes après coup, qu’aux Etats Unis avec la ritaline et telle qu’elle est prescrite on pourrait avoir une génération de drogués [18].
En ce qui concerne la pression de la pharmacopée à propos notamment des symptômes chez les enfants le pédopsychiatre Thierry Delcourt donne une précision en 2021 dans son livre La fabrique des enfants anormaux [19] : Rappelons que les symptômes de l’enfant ont une signification dans son histoire et son psychisme ; qu’ils ont même une utilité, ne serait-ce que pour se défendre contre l’angoisse et la perception d’une menace de leur intégrité dans l’insertion scolaire, par exemple. S’ils se protègent, s’ils s’expriment, s’ils s’opposent par un comportement de repli, d’agitation, d’opposition active ou passive, ce n’est pas par hasard, et rarement parce qu’ils seraient atteints d’un trouble neurodéveloppemental [20]. De nombreux psychanalystes se retrouvent dans l’association Stop au DMS. Ce combat est une des pertinences de la psychanalyse aujourd’hui.
La situation d’aujourd’hui est marquée par la place de la violence. Ce n’est pas un scoop. Mais la réflexion sur la violence que proposent des psychanalystes ajouté à d’autres points de vue comme celui qui considère la violence comme un des effets des inégalités dans la répartition des richesses pour l’intérêt d’un très faible nombre de personnes, peut nous aider à la comprendre.
Les psychanalystes attirent l’attention en posant notamment une question : quelle est la pire violence qu’un sujet est capable de subir ? C’est la violence la plus fréquente, la plus douce, la plus soft, la plus invisible : c’est celle qui vous ignore dans votre existence de sujet, c’est-à-dire celle qui, par exemple, vous inclut dans un dialogue, dans un propos, dans une situation, mais avec la méconnaissance de qui vous êtes et surtout dans le refus de vous solliciter, le refus de savoir ce que vous pouvez en penser et / ou en éprouver en réalité, voire à avoir un avis là-dessus. Cet effacement du sujet est une situation traumatisante et violente. C’est la pire des violences, selon de nombreux psychanalystes, qu’il puisse y avoir et qui est aujourd’hui particulièrement fréquente dans toutes les formes de relations sociales où l’on attend des travailleurs, des collaborateurs, qu’ils participent à leurs tâches sans engagement subjectif et on ne leur demande pas ce que cela peut leur faire.
L’effacement du sujet, l’effacement de sa subjectivité, que l’on peut ressentir et qui s’exprime quand une personne dit par exemple « j’ai le sentiment d’être interchangeable », ou « je n’ai pas mon mot à dire », ou encore « je sais ce n’est pas cohérent mais ce sont les consignes que je dois suivre » ou encore comme beaucoup de femmes le disent « je suis invisible ».
Un autre paramètre compte, selon moi, pour cerner la violence, c’est l’appauvrissement du langage qui participe à l’affaiblissement du travail de civilisation et à la désubjectivisation du sujet parce qu’il réduit la symbolisation, un des trois axes essentiels de la subjectivité avec l’Imaginaire et le Réel comme nous disent les lacaniens. Or on le sait notamment depuis le stage de Freud à la Salpêtrière, en 1886, que la parole influence le réel corporel. C’est en écoutant parler les patientes que Freud découvre qu’il peut mettre à jour un sens inconscient jusque-là interprété comme simulation. Et oui, on doit la psychanalyse à ses patientes. Et particulièrement à l’une d’elle qui lors d’une séance dit à Freud : mais écoutez-moi plutôt ! Freud lui répond : j’y consens.
Je pense également que la vérité est en train de perdre son statut cardinal, et cela n’est pas sans conséquence sur la violence de la société. La place de la vérité se modifie que ce soit pour les vérités de fait comme les découvertes scientifiques ou pour les vérités de situation qui nous disent si tel ou tel événement a eu lieu ou pas par exemple. On connaît la toile de fond, même si elle n’explique pas tout à elle seule, avec les fakes news et les esprits complotistes qui troublent et faussent les débats et surtout les repères.
A propos de la subjectivité d’une personne, disons-le au passage, et ce n’est pas rien, il existe un lieu, un espace où la subjectivité du sujet peut prendre une très bonne place, toute sa place, c’est cet espace qu’est la cure analytique. Le sujet a une liberté de parole, il est même invité à ne pas se censurer et à associer sans craindre de passer du coq à l’âne. C’est même la seule règle qui lui est proposé de suivre.
L’analyste, lui, avec le secret professionnel, est amené à avoir ce que Freud appelait une écoute flottante ce qui veut dire une écoute égale à tout ce qui se dit pour aider le patient à entendre ce qu’il dit. Bien sûr l’analyste est à l’affût de l’inconscient et donc à ses expressions (lapsus, rêves, mots d’esprit…). Le patient et l’analyste, surtout le patient, travaillent donc à définir, au-delà de la levée de tel ou tel symptôme, le désir du sujet, le désir du patient. Le parcours est à chaque fois singulier.
Encore une dimension, que je n’ai pas abordée, c’est à propos de la création artistique. On sait depuis Freud que c’est un immense apport au travail de civilisation. Parce qu’elle se place et dans la symbolisation et dans l’imaginaire. Mais pas seulement. La création artistique, nous a expliqué Freud, est le résultat d’une sublimation c’est à dire de la transformation d’une pulsion personnelle (une pulsion sexuelle pour être précis) mais qui n’aboutit pas et se transforme en une activité qui a une dimension sociale puisqu’elle n’est pas, entre autre, sans lien avec un public. Pour ces raisons (symbolisation, imaginaire et sublimation) on trouvera toujours des psychanalystes pour défendre l’activité artistique et les artistes, même s’ils ne sont pas les seuls à sublimer. Voilà une pertinence de plus pour la psychanalyse aujourd’hui. Si elle était davantage écoutée peut-être que l’activité culturelle aurait été considérée comme essentielle lors de la période marquée par le Covid. Les Italiens, eux, pendant cette même période, n’ont pas fermé les salles de cinéma.
Cerise sur le gâteau, de surcroît, comme disent les lacaniens, la thérapie analytique guérit. Quand vous demandez à un psychanalyste si la cure apporte une guérison vous avez une forte chance que le psychanalyste commence sa réponse par une question : qu’entendez-vous par guérison ? On peut le comprendre parce qu’une analyse va ou peut aller bien au-delà de la demande de lever tel ou tel symptôme ou de tel ou tel sentiment de malaise voire de la souffrance. Il reste qu’avec l’analyse le patient ira mieux et surtout il décidera du chemin à prendre pour son désir que sa cure, sur le divan ou en face à face avec son psy, peut permettre de cerner. Certains psychanalystes, comme Juan David Nasio, répondent, eux, plus directement par l’affirmation : la psychanalyse guérit.
Cela fait beaucoup de raisons pour dire que la psychanalyse a sa pertinence aujourd’hui :
a) elle a beaucoup apporté jusqu’ici
b) elle peut participer à la résistance à l’angoisse du fait du libéralisme
c) elle peut servir à prévenir la perversion prise comme mode de gouvernance
d) elle dénonce la pression économique et morale des labos pharmaceutiques qui cherchent à orienter les diagnostics
e) elle s’oppose à l’ignorance du sujet, à la mise à l’écart voir à l’effacement de la subjectivité
f) elle défend l’activité culturelle
g) cerise sur le gâteau elle offre un espace de liberté pour la subjectivité en accompagnant les patients pour un choix du chemin de leurs désirs. [21]
Un doute ou une question peut se formuler, au-delà de certaines critiques qui relèvent plus du stéréotype et de l’idée reçue que de l’argumentation. La question peut se formuler de la façon suivante : face à tous ces enjeux, les psychanalystes arriveront-ils à relever tous ces défis tant la situation actuelle et celle en perspective abîment l’homme, la femme, les enfants ? Simple question qui donne le vertige : qu’en sera-t-il de cette discipline quand, par exemple, l’extrême droite aura le pouvoir, avec son lot de décisions politiques et la peur qu’elle instaurera ? Un spectre nous hante.
Avec ou sans ce spectre qui nous hante, il lui faut, à la psychanalyse, certainement reprendre la démarche de Freud dans sa prédiction de 1918 qui finit par Nous nous verrons alors obligés d’adapter notre technique à ces conditions nouvelles. C’est-à-dire aujourd’hui, comme le formulent les psychanalystes Thierry Roth et Bernard Vander Mersch membres de l’Association Lacanienne Internationale : actualiser la théorisation et la technique de sa clinique, préciser son éthique, soutenir la spécificité de sa pratique [22].
Actuellement les psychanalystes ne cessent de réfléchir à la théorie comme à leur technique. Ils ne cessent pas à se remettre à l’ouvrage. Ils réinterrogent les découvertes de Freud, les propositions de Lacan et également leur technique. Ils le font beaucoup au regard de ce qui bouge, s’exprime dans la société aujourd’hui et ce depuis quelques décennies. Juste pour illustrer, je donne quelques informations : la psychanalyste Gorana Manenti tient un séminaire sous le titre Sortir la psychanalyse du patriarcat. Gérard Pommier dans son ouvrage Le féminin, révolution sans fin cite à plusieurs reprises les erreurs, selon lui, de Freud et Lacan. Le psychanalyste, disciple de Lacan, et communiste Pierre Bruno, qui nous a quittés en juillet dernier, est un auteur prolifique. Il a notamment abordé dans ses écrits une critique de la psychanalyse freudienne [23]. Ginette Michaud avec son livre Harriet et la Pierre de folie, aux éditions Erès, illustre comment s’approprier une théorie n’est pas incompatible avec le fait de la transformer. Thierry Roth nous propose une nouvelle catégorie, une nouvelle structure : les névroses de récusation [24].
Un travail de réflexion existe à plusieurs voix sur les textes bien sûr mais également sur le mouvement psychanalytique lui-même. Guy Dana, dans la revue Figures de la psychanalyse qui regroupe des contributions sous le titre Pour repenser la psychanalyse commence son article par ces lignes : « Je ne suis pas particulièrement inquiet pour la psychanalyse en ville, bien qu’il y ait des problèmes de fond (…) par contre, ce qui se passe dans les institutions est dramatique et devrait être traité à part ; sans exclure nos propres erreurs, comprendre la désaffection et le rejet de la psychanalyse dans le monde de la psychiatrie, par exemple, nécessiterait une analyse approfondie (..) mais fondamentalement (…) les institutions ont perdu la liberté d’initiative et sont empêtrées dans une cascade de protocoles qui dénaturent le métier ».
La réflexion critique n’est pas absente au sein de la communauté analytique. Je mentirais si j’affirmais qu’aucun conservatisme n’existe chez les psychanalystes [25]. Par ailleurs, certains psychanalystes, trop peu à mon avis, font l’effort de s’adresser à des publics pas forcément initiés à la psychanalyse pour donner leur point de vue de psychanalyste sur des questions de société comme par exemple Hélène Godefroy sur la haine du féminin et sur le transgenre [26] ou Jean-Pierre Winter sur le lien entre inconscient et responsabilité ou encore Danièle Epstein sur l’homme contemporain face à la folie du monde [27]. Ou encore à plusieurs reprises avec Frank Gautret sur le fait religieux, sur l’angoisse et sur le pervers narcissique [28].
Bref ça réfléchit, ça bouscule, ça dit des conneries. Heureusement car cela permet d’affirmer la pertinence de la psychanalyse aujourd’hui et de se préparer à une question qui n’a pas de réponse encore : Et demain qu’en sera-t-il de la psychanalyse ?
La société est-elle, elle, curieuse de la psychanalyse ? De nombreux faits le montrent : les magazines et leurs numéros spéciaux sur le sujet ; les fictions comme En Thérapie sur Arte ; les nombreuses prises de paroles publiques sur le bien-fondé ou l’escroquerie de la thérapie analytique… les podcasts interactifs sur l’inconscient de France Inter [29]. Mais comment cela s’articule ? Et la situation de la psychanalyse dans la société est-elle à la hauteur ? Trois éléments peuvent nous interroger :
- l’enseignement de la discipline freudienne est en peau de chagrin dans nos universités et
- la psychanalyse en tant que telle n’est plus au programme de philosophie en Terminale et
- il faut regarder en arrière dans le temps pour trouver en grand nombre de psychiatres qui dans leur formation ont travaillé en tenant compte de la psychanalyse.
Je ne m’étends pas sur ce qui interroge pour l’avenir de la psychanalyse mais juste pour dire qu’aujourd’hui elle a besoin que la société veille et défende la discipline.
Et pour revenir à la question pourquoi, la psychanalyse aujourd’hui et pour finir je donne la parole à Isabelle Adjani : "L’analyse aide à se rapprocher de soi. On entend souvent dire que l’analyse vous change. Mais non, ça ne vous change pas, ça vous rend à vous. Vous ne devenez pas quelqu’un d’autre, c’est la personne que vous étiez avant qui était une autre. On peut avoir une sorte de désillusion pas toujours facile à vivre lorsque l’on découvre qui l’on est. On se dit : « Voilà, c’est donc moi et il va falloir vivre avec. ». Mais à partir de là, on va pouvoir prendre les vraies décisions. Dire : « Je sais qui je suis et donc, j’aime ça, je n’aime pas ça, ceci me rend heureuse et cela malheureuse. » Des pans de sa vie tombent, les masques aussi. On change d’amis, il y a des gens avec qui on ne peut plus continuer, ni l’amitié ni le travail, et on accepte la perte. On apprend ce qui est bon pour soi. Alors que c’est fou ce que l’on peut s’habituer à vivre ce qui n’est pas bon pour soi ! " [30]. C’est la réponse de l’actrice à la question pourquoi, pour quoi la psychanalyse aujourd’hui où le pour quoi est aussi bien écrit en un seul mot qu’en deux mots. Isabelle Adjani [31] nous dit, en quelque sorte, qu’à partir de la réalité qu’elle prend, au sens qu’elle la travaille, elle arrive à pouvoir prendre les vraies décisions pour ce qu’elle désire. Elle nous dit donc que l’analyse c’est prendre la réalité pour ses désirs.
A lire également sur le site :
[1] L’ouvrage est, en fait, publié en 1899. Freud a demandé à l’imprimeur d’écrire comme année de parution 1900.
[2] Effectivement, auraient pu être cités les ouvrages : Psychopathologie de la vie quotidienne, Le mot d’esprit et son rapport à l’inconscient, Névrose, psychose et perversion, Cinq leçons sur la psychanalyse…
[3] Cet ouvrage est parfois titré Malaise dans la civilisation et parfois Malaise dans la culture.
[4] Or Lucien Bonnafé signe le manifeste en forme d’autocritique titré « la psychanalyse, une idéologie réactionnaire » imposé par la direction du PCF en 1949. Un an après, lors du 1er Congrès Mondial de Psychiatrie à Paris, il énonce les bienfaits de la leçon freudienne. En 1975, malgré son appartenance au PCF, il dénonce l’usage répressif de la psychiatrie en Union soviétique. Pour en savoir davantage, il y a la thèse de Danielle Papiau titrée « Psychiatrie, psychanalyse et communisme » qui est accessible. Il y a aussi un article d’Eric Le Lann sur le site lafauteadiderot.net intitulé La condamnation de la psychanalyse en juin 1949 : un épisode peu connu du « stalino-jdanovisme ». Lucien Bonnafé est co-auteur du texte Le problème de la psychogénèse des névroses et des psychoses avec Jacques Lacan et Henri Ey. En 1949, la même année que l’autocritique, la psychanalyse est l’objet d’une seconde condamnation provenant, cette fois, des autorités du Vatican. Augusto Gemelli, « psychologue de confiance du pape » condamne la psychanalyse comme « dépourvue de caractère scientifique » et comme « mouvement qui a un contenu matérialiste, positiviste et antireligieux ».
[5] Je n’aborde pas l’Intelligence artificielle par exemple. Je cite tout de même le livre du psychanalyste Yann Diener L’Inconscient inculqué à mon ordinateur.
[6] Par exemple les études sur les patients adolescents déprimés ou sur les comportements suicidaires, etc.
[7] C’est le cas de la Société Psychanalytique Française depuis 1997, de L’Ecole de la Cause freudienne depuis 2006 et de l’Association Lacanienne Internationale depuis 2007.
[8] Ne me demandez pas ce que c’est.
[9] Vous pouvez le voir et surtout l’entendre sur Youtube car il a été reçu, pour un entretien autour de son livre, dans le studio Lacan la WebTV créé par l’Ecole de la Cause Freudienne.
[10] Entendons le rond-point des gilets jaunes.
[11] Organisé par l’association Le Cercle Freudien en mars 2025
[12] L’association Autant le dire, installée en région parisienne, organise tous les ans un cycle de conférences pour entendre et discuter le point de vue de psychanalystes sur des questions de société.
[13] J’y reviens plus bas.
[14] C’est ce que dit aussi celui ou celle qui en est à sa 12ème manifestation pour rien contre la retraite à 64 ans.
[15] Ce que nous vivons aujourd’hui lui donne raison.
[16] Lebrun va encore plus loin en ajoutant : sa lecture radicale de la situation actuelle nous amène à devoir penser un changement de grand ampleur aux conséquences anthropologiques incalculables, qui installe la congruence entre une économie libérale débridée et une subjectivité qui se croit libérée de toute dette envers les générations précédentes, autrement dit, produisant un sujet qui croit pouvoir faire table rase de son passé.
[17] N’est-ce pas ce que disent, d’une certaine façon, ceux et celles qui en reprenant une citation de Brecht affirment que « le ventre est encore fécond, d’où surgit la bête immonde ».
[18] J’ai pu le constater dans mon cabinet avec un jeune qui avait une forte dépendance à la ritaline.
[19] Aux éditions Max Milo. Résumé proposé par l’éditeur : "La maîtresse dit que mon fils n’est pas normal, qu’il a un handicap." "Votre enfant est hyperactif. Il perturbe la classe. Il a besoin d’un traitement." "Il a 4 ans, l’institutrice dit que mon fils travaille mal, qu’il faudrait qu’on lui fasse passer un test de QI" Tous les jours, Thierry Delcourt entend ces "mots qui tuent" de parents désemparés qui doivent faire subir à leur enfant des tests pour détecter un trouble neurodéveloppemental, un handicap, puis les rééduquer et leur prescrire des médicaments. Aux Etats-Unis, le nombre de jeunes concernés avoisine les 20 %. En France, il a augmenté de 300 % en quinze ans. Or, ces enfants ne sont pas handicapés ni anormaux, ils sont seulement anxieux, insécurisés ou en difficulté psychique. Au-delà du scandale que ce livre dénonce, il est une aide aux parents pour lutter contre la stigmatisation de leur enfant. Il s’adresse aussi aux enseignants afin de les aider à trouver des solutions pour que l’enfant fasse de sa différence une force.
[20] Luis Sciara, psychiatre et psychanalyste a publié Entendre la parole des enfants et des adolescents aux Editions Erès. Luis Sciara est membre de l’association Stop DMS.
[21] Ces raisons ne sont-elles pas justement trop nombreuses ? Freud nous alerte quand il y a trop d’arguments où chacun d’entre eux est parlant, il faut veiller si la somme des arguments ne crée pas un doute. C’est l’exemple, d’école maintenant puisque c’est étudié notamment en analyse de discours, de l’argument dit en chaudron. Freud évoque cette argumentation à partir d’un de ses propres rêves dans lequel un voisin lui dit : vous m’avez rendu le chaudron que je vous ai prêté, en mauvais état car il est maintenant percé. Pour se défendre Freud, dans son rêve, donne trois arguments, qui concourent chacun à le disculper, mais ne s’accordent pas ensemble et créent plus qu’un doute tout en révélant la mauvaise foi de Freud rêvant. Ces trois arguments sont : "Premièrement, je te l’ai rendu en bon état ; deuxièmement, ton chaudron était déjà percé quand je te l’ai emprunté ; troisièmement, je ne t’ai jamais emprunté de chaudron".
[22] Thierry Roth et Bernard Vandermersch le formulent à l’occasion de la présentation de leur prochain séminaire : Les défis de la psychanalyse pour demain.
[23] La psychanalyste Silvia Lippi a dit de lui : … un analyste réellement marxiste qui n’a jamais reculé face à son désir de joindre Marx et Lacan, pour penser la psychanalyse à venir.
[24] Thierry Roth avec son livre Les névroses de récusation paru cet été aux éditions Erés, ajoute donc une nouvelle structure parmi les névroses avec donc la névrose obsessionnelle et l’hystérie. Ce n’est pas rien comme avancée de la théorie. Il finit son livre par ces deux phrases : « Les conséquences cliniques des changements sociétaux nous mettent au défi d’avancer avec précaution, avec rigueur mais aussi avec inventivité. Nos patients nous y obligent. »
[25] Un psychanalyste a pris la parole lors d’une réunion entre membres d’une association analytique pour affirmer que metoo est une mode.
[26] Le titre de sa conférence sur le transgenre était : Transgenre, alors on opère ?
[27] Danielle Epstein va publier, à la fin de cette année ou au début de la prochaine un livre titré L’air de la démesure : croissance et jouissance.
[28] Le titre de sa conférence était : le pervers narcissique a-t-il deux grandes oreilles et une queue ?
[29] La direction de la station a mis fin à cette production
[30] Extrait d’un entretien paru dans Psychologie magazine en 2010
[31] J’aurai pu choisir bien d’autres témoignages. Notamment une autre comédienne Sarah Biasini qui nous dit : … L’analyse permet de comprendre ses angoisses viscérales, instinctives, et les réactions violentes qui vont avec. Selon Valéria Bruni-Tedeschi, l’analyse nous permet de ne pas être ligotés. Pour l’humoriste Florence Foresti la psychanalyse l’a enrichie, essentiellement dans son rapport aux autres. Et ce serait trop long de citer les avantages de la psychanalyse pour l’acteur Fabrice Luchini. Il y a plusieurs vidéos sur Youtube où l’on voit et entend l’acteur évoquer la psychanalyse.
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil