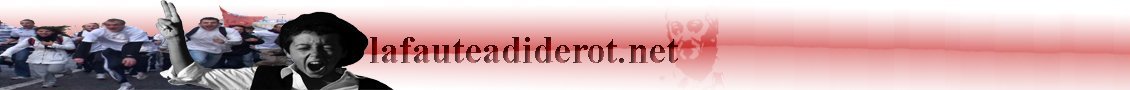
Il y a 50 ans, le 25 avril 1975, décédait Jacques Duclos, dirigeant prestigieux du Parti Communiste Français mais inconnu des jeunes générations. Pour évoquer sa mémoire, nous avons interrogé Pierre Blotin, ancien dirigeant du PCF, qui a travaillé durant plusieurs années à ses côtés. Dans ce témoignage passionnant, il revient sur certaines pages d’histoire, livrant parfois sa propre interprétation, et expose aussi son regard sur l’actualité brulante.
Avant d’en venir aux questions, pourrais-tu te présenter ?
Je suis né en novembre 1939… en même temps que débutait la Seconde Guerre mondiale. En décembre 1955, élève à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Versailles, désireux de lutter contre la guerre d’Algérie j’ai reçu une carte provisoire d’adhérent au Mouvement de la Jeunesse Communiste … qui n’existait pas encore officiellement ; le congrès transformant l’UJRF ( union de la jeunesse républicaine de France ) en UJCF n’eut lieu que quelques mois après. J’ai eu des responsabilités départementales à la JC. Ensuite, au PCF : secrétaire d’une section puis du “comité” regroupant les cinq sections de Saint-Denis, alors “bastion” communiste de la région parisienne.
En 1967 la direction du parti m’a demandé de quitter mon travail au ministère de l’Education Nationale pour devenir le secrétaire de Jacques Duclos. On ne disait pas encore “collaborateur”. Il ne serait d’ailleurs venu à l’idée de personne de proposer un “collaborateur” à l’ancien dirigeant du parti communiste clandestin sous l’occupation nazie ! J’ai eu la chance de travailler à ses côtés jusqu’en 1972, donc de vivre au plus près sa campagne présidentielle de 1969. J’ai ensuite dirigé l’Ecole Centrale du parti , puis j’ai travaillé au secrétariat de Georges Marchais. J’ai encore eu une grande chance : diriger pendant huit ans une fédération du parti -le Val d’Oise. Je suis entré au Comité Central en 1979. Élu au Bureau Politique en 1985, j’y ai exercé plusieurs responsabilités ( notamment le suivi des questions concernant la jeunesse, la formation des militants, le travail avec des candidats à des élections nationales, comme André Lajoinie pour la présidentielle de 1988 ) . J’ai ensuite eu, au secrétariat du parti, la responsabilité de la communication et des rapports avec la presse. J’ai été élu conseiller régional du Languedoc-Roussillon. Puis, quand Robert Hue a été élu premier dirigeant du parti, j’ai travaillé à ses côtés, comme conseiller et responsable des rapports avec la presse puis des relations du PCF avec les autres forces politiques. J’ai décidé en 2000 de quitter mes responsabilités nationales. Voila mon parcours. Je n’ai certes pas tout bien fait ! Mais, oui, quelle chance j’ai eu !
Je vais maintenant m’efforcer de répondre à tes questions. Je ne suis pas historien. Mes réponses seront d’abord un témoignage - à regarder avec esprit critique. Je vais dire comment j’ai vu Jacques Duclos entre 1967 et 1972, alors que j’ignorais beaucoup de choses sur les événements historiques dont il avait été un acteur, et que j’apprenais auprès de lui ce qu’était “la politique” au niveau de responsabilité qui était le sien. Je vais aussi faire part de mes réflexions cinquante ans après, avec un autre regard, appuyé sur une expérience que je n’avais pas à l’époque. Je ne prétends pas détenir LA vérité concernant la personnalité et l’action de Jacques Duclos. Au-delà du travail que j’effectuais auprès de lui, des rapports humains chaleureux se sont établis entre nous. Je ne revendique pas l’objectivité. Juste la sincérité.
Tu as donc travaillé avec Jacques Duclos de 1967 à 1972. Et tu es sans doute une des rares personnes l’ayant côtoyé pouvant aujourd’hui témoigner. Commençons par un aspect personnel : peux-tu nous dire quelques mots de la relation qui s’était établie entre vous dans ce travail ? Quelle sorte d’homme était-il au quotidien dans le travail à l’égard du jeune homme que tu étais alors ?
Quand j’ai commencé à travailler avec Jacques j’avais 27 ans, il en avait 71. C’était pour les communistes de ma génération une légende vivante. Il avait la réputation d’être toujours exigeant, parfois impitoyable. Nous étions dans la même fédération. Il m’avait sans doute entendu intervenir lors de réunions, mais je n’avais jamais eu l’occasion de parler avec lui. Je n’en menais pas large en entrant pour la première fois dans son bureau ! Il s’est avancé vers moi avec un grand sourire, et la main tendue en s’exclamant : “ Ah, c’est toi ! “ … Ouf !
Tout de suite il m’a mis au travail. Tout s’est passé très vite. Des relations de confiance se sont établies entre nous. De son côté beaucoup de bienveillance ; du mien un grand respect bientôt doublé d’affection.
Jacques m’a appris beaucoup de choses pendant ces cinq années passées auprès de lui.
D’abord, en liaison avec son activité quotidienne de dirigeant du parti et de président du groupe communiste au Sénat. J’ai découvert les réalités - grandeurs et misères… - de la vie politique au niveau national. Je n’en retiendrai ici qu’un seul aspect - sans doute en souvenir d’une engueulade pour un projet de débat avec un adversaire que je lui suggérais d’attaquer de façon trop personnelle :“Non ! Pas ça ! On peut polémiquer durement, mais toujours en respectant l’adversaire en tant que personne. S’il n’est pas respectable, tu ne débats pas avec lui, et tu dis pourquoi !” . Venant de ce polémiste redouté, la leçon m’est restée en mémoire !
Jacques m’a appris beaucoup de choses sur l’histoire politique dont il avait été un acteur majeur. Sur les événements auxquels il avait pris part, et sur leurs protagonistes. Sur l’histoire du mouvement ouvrier et socialiste français. Sur le communisme français, dont il aimait souligner les racines profondément ancrées dans l’histoire de France. Il m’a aidé à me faire une opinion sur les évolutions qui ont marqué l’histoire du PCF et en ont plusieurs fois modifié l’identité, et du même coup l’image qu’en avaient les Français . Il en avait été un acteur : du Front Populaire à la Résistance et la Libération, mais aussi en des périodes laissant des souvenirs moins glorieux, comme les années 1950 - les années “staliniennes” du PCF. Et même si tout ne lui convenait pas dans les transformations engagées dans les années 1960-1970, il se faisait un devoir d’afficher son soutien aux dirigeants qui les conduisaient - Waldeck Rochet, puis Georges Marchais.
Justement, ces transformations semblaient prendre le contrepied de ce qu’avait été Jacques Duclos dans ces années “staliniennes”. Cela n’a-t-il pas été un problème pour toi, pour votre relation ?
Ces transformations, j’en étais un fervent partisan. Elles étaient aux antipodes de “l’orthodoxie stalinienne” et du “soviétisme” dont Jacques Duclos s’était fait le héraut et l’implacable défenseur quelques années auparavant. Mais le Jacques Duclos que je côtoyais quotidiennement était radicalement différent !.. C’était pour moi une énigme. Une énigme pour laquelle j’ai trouvé des explications mais pas de réponse qui aurait pu me conduire à justifier certaines positions, certains comportements passés.
Je travaillais chaque jour avec lui sur des discours ou des articles exposant pour des auditeurs français ou des revues de pays étrangers les choix d’un Parti Communiste Français prenant toujours plus ses distances avec le “modèle soviétique”. Et c’était le même homme - avec la même force de conviction - qui quelques années auparavant se proclamait “meilleur stalinien” ! Le même homme qui, au nom de la fidélité à ses engagements de jeunesse pour la Révolution russe d’octobre 1917, avait accepté l’inacceptable, justifié l’injustifiable !
Vivre à ses côtés la campagne présidentielle de 1969 m’amena à de nouvelles réflexions. J’ai pu constater non seulement la passion qu’il mettait, mais le bonheur qu’il éprouvait à montrer son idéal communiste pour la France et son peuple sous un jour bien différent du “communisme” soviétique. Dès la décision du Bureau Politique de le proposer comme candidat il avait été clair : ”Ne perds pas ton temps à me préparer des fiches sur des questions que je traite depuis cinquante ans dans mon activité parlementaire… Il faut qu’on travaille pour montrer sous son vrai jour l’idéal communiste qui m’anime”. Sous ce jour là il était bien différent de l’image qu’il avait donné de lui-même dans les années cinquante !
Les questions que je me posais, je ne me sentais pas autorisé à les lui poser du haut de mes trente ans et de ma bien petite expérience … mais il les devinait. Il ne considérait pas qu’il avait à se justifier. Encore moins à se renier. Mais chaque fois que l’occasion se présentait, je voyais bien qu’il me livrait des informations ou des réflexions pour m’aider à comprendre.
Qu’y avait-il à comprendre ? D’abord le véritable culte qu’il avait pour la Révolution Française. Il s’était fait relier une collection des discours des révolutionnaires français. Je me souviens de l’avoir vu revenir de chez le relieur en caressant amoureusement le dernier volume qui venait de lui être livré ! Il rappelait avec fierté que le premier hymne que les révolutionnaires russes de 1917 ont chanté était la Marseillaise. Il connaissait les déchirements et les drames - les crimes aussi ! - par lesquels la révolution de 1789 en était arrivé à “dévorer ses propres enfants”. On peut déplorer cette réalité historique sans pour autant rejeter cette révolution qui a fait naître la France moderne et a contribué à changer l’Europe et le monde de cette époque, expliquait-il. Les procès staliniens, les crimes, les injustices commises au nom d’une révolution pour la justice … lui paraissaient comme une malheureuse mais peut-être inévitable répétition qui ne pouvait conduire à remettre en cause l’événement majeur qu’avait été Octobre 1917 et la naissance puis le développement de l’Union Soviétique. Il refusait de mêler sa voix à celle des anticommunistes. il y aurait vu une trahison de ses engagements de jeunesse. Il considérait faire son devoir en s’en tenant à ce refus.
Cependant, il partageait la volonté de la direction du PCF des années 1960, qui, avec Waldeck Rochet, successeur de Maurice Thorez (mort en juillet 1964), prônait une voie révolutionnaire pacifique et démocratique, permettant d’éviter que les mêmes causes produisent un jour en France les mêmes effets. Tout comme Waldeck Rochet, il rappelait certaines intuitions de Maurice Thorez, à la fin des années 1950, concernant “la démocratie comme création continue“. On en trouve d’ailleurs la trace dans la formule employée plus tard par Waldeck Rochet, puis Georges Marchais : “une démocratie avancée ouvrant la voie au socialisme”... (J’approuvais à l’époque la formule qui rompait avec l’orthodoxie soviétique… Elle n’avait malheureusement aucune chance d’être comprise massivement dans la population !).
J’ajoute un indice et une anecdote suggérant que tout n’était pas chez lui si simple qu’on pourrait le penser. L’indice d’abord : Il m’a souvent dit son admiration pour Marcel Cachin. Pas seulement pour l’ancien dirigeant socialiste compagnon de Jean Jaurès, qui devint en 1920 l’un des fondateurs emblématiques du Parti Communiste Français. Mais pour le dirigeant communiste qu’il fut ensuite. Pour Marcel Cachin, que par respect et admiration il avait toujours vouvoyé, et dont j’appris plus tard par des “anciens” du Bureau Politique, qu’il lui arrivait, dans les années 1950, de se mettre en colère contre les dirigeants du PCF “stalinien”. Il les admonestait, en frappant le sol de sa canne : “ je ne comprends pas comment des jeunes gens aussi intelligents que vous peuvent dire des bêtises pareilles !”.
L’anecdote maintenant : On est en 1970. Un congrès du PCF va bientôt s’ouvrir. Comme lors de chaque congrès, de nombreuses délégations étrangères et beaucoup de personnalités de différents pays ont été invitées, ou ont manifesté leur souhait d’assister au congrès. Les principaux dirigeants du parti doivent réserver du temps pour s’entretenir avec elles. De nombreuses propositions sont faites à Jacques Duclos. Je suis chargé de les lui transmettre et, s’il est d’accord, de caler les rendez-vous. Parmi ces propositions, il en est une qu’il refuse d’emblée, sur un ton qui m’indique qu’il ne souhaite pas que j’insiste. C’est pourtant ce que l’on me demande de faire à plusieurs reprises. Enfin, excédé, il s’explique clairement : “Non ! c’est définitivement non ! Je refuse de serrer la main d’un assassin !”. Un assassin ? La réponse à cette interrogation m’a permis d’apprendre et de réfléchir : la personnalité en question était le peintre mexicain Siqueiros. Il avait organisé, le 24 mai 1940 une tentative d’assassinat de Trotsky. Celle-ci avait échoué de peu. Trostsky avait été assassiné le 21 août suivant par un agent stalinien indiscutablement identifié. Siqueiros avait toujours nié les faits mais il avait été reconnu coupable et emprisonné jusqu’en 1944. Et, en 1970, Jacques Duclos, connu pour son passé stalinien et son combat virulent contre le trotskysme et les trotskystes, refusait de lui serrer la main… J’appris à cette occasion que déjà, quand Trotsky, expulsé d’Union Soviétique par Staline, et craignant que celui-ci le fasse assassiner, avait séjourné en France, entre 1933 et 1936, Jacques Duclos et Maurice Thorez étaient intervenus auprès du gouvernement pour qu’une protection lui soit accordée. Décidément, il faut se garder des idées toutes faites quand on cherche à comprendre l’homme que fut Jacques Duclos…
Le soutien inconditionnel à l’URSS, la posture d’”orthodoxe” intransigeant pourfendant ceux qui déviaient de “la ligne”, Jacques Duclos les inscrivait dans son histoire personnelle. Celle de l’ancien combattant de la grande boucherie de 1914-1918. Celle du militant clandestin dans l’Espagne des années 1920-1930 bientôt ensanglantée puis asservie par Franco, dans l’Allemagne des années 1930 où s’imposait le nazisme. Celle du dirigeant communiste français soutenant partout dans le monde les communistes persécutés. Dénonçant dans les années 1950 le Maccarthysme aux Etats-Unis et la “chasse aux communistes” dans de nombreux pays, il se laissait persuader par ses interlocuteurs soviétiques que les procès, les emprisonnements, les déportations, voire les exécutions n’étaient que la riposte aux complots impérialistes contre le pays du socialisme ! N’avait-il pas été lui-même plusieurs fois emprisonné par ses adversaires au pouvoir (en 1927, le total de ses condamnations s’élevait à trente ans de prison !) ? N’était-il pas retourné en prison en 1952 sous le prétexte farfelu d’un “complot” dont la “preuve” absurde était selon le ministre de l’intérieur la présence de pigeons dans sa voiture ( des pigeons morts destinés à la cuisine et dont l’autopsie -oui, la police les a fait autopsier ! - montra qu’ils n’avaient jamais été “voyageurs” porteurs de messages pour Moscou ! ) ?
Ces explications ne pouvaient tout justifier, tout excuser. Il ne le souhaitait pas. Ce n’était pas non plus ce que je recherchais… Mais le souvenir de mes interrogations n’a en soi aucun intérêt. Ce qui me paraît important, et qui peut être source de réflexions pour les communistes français d’aujourd’hui, c’est que dans le PCF de cette époque, à tous les échelons, des militants ont affronté les mêmes questionnements. Des générations de communistes aux expériences bien différentes se côtoyaient dans la même action politique. Dans des situations historiques nouvelles, la culture politique que se forgeaient les plus jeunes ne pouvait être la même que celle que s’étaient forgée les plus anciens. Mais les uns et les autres étaient attachés à leur parti, et fiers de ce qu’il avait apporté à la France et à son peuple. Et ils étaient amenés à construire ensemble des réponses nouvelles “pour que le parti communiste soit toujours mieux communiste“, comme nous disions alors.
Pour conclure sur cette question, je veux faire référence à la notice que le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (le Maitron comme on l’appelle du nom de son créateur ) consacre à Jacques Duclos. Elle souligne que c’est dans les périodes “d’ouverture politique” du PCF ( le Front Populaire, la Libération ) que “Duclos a donné toute la mesure de ses talents de politique, de tacticien, de négociateur et de propagandiste” . Et, en écho au rappel des moments où il fut aux avant-postes pour défendre et promouvoir l’orthodoxie stalinienne, elle interroge l’hypothèse selon laquelle son comportement dans les “moments d’ouverture politique” pourrait mieux correspondre à son “tempérament profond”.
C’est bien “l’énigme” toujours - et peut-être pour toujours - non résolue que j’évoquais précédemment.
Et puis, commémorer le cinquantenaire de la mort de Jacques Duclos, c’est évoquer l’histoire - pas seulement celle du PCF, mais plus largement l’histoire de la France au XX° siècle - et je pense à l’avertissement de l’historien Marc Bloch, torturé et fusillé par la gestapo en 1944 : “ le satanique ennemi de la véritable histoire : la manie du jugement” …
Parlons de l’année 1969, la fameuse année où Jacques Duclos a été candidat du PCF à l’élection présidentielle. Avant d’en arriver à ce moment, il y a d’abord le référendum qui voit le succès du Non et le départ de De Gaulle comme il l’avait lui-même annoncé dans cette hypothèse. On a l’impression qu’à ce moment la droite la plus atlantiste s’est saisie de l’occasion pour pousser De Gaulle vers la sortie. Était-ce l’analyse que faisait alors Duclos et le PCF de la situation, comme l’a écrit Guy Konopnicki dans un livre ?
Je crois que pour comprendre 1969 il faut revenir à 1968. Dix ans après le retour au pouvoir du général De Gaulle, plébiscité à 80% par les Français, dix millions de nos concitoyens participaient en mai 1968 à un puissant mouvement populaire. L’un des mots d’ordre les plus rassembleurs pendant ce mouvement était “ Dix ans ça suffit ! “. Comme, malgré tout, cela s’était terminé par une victoire de la droite aux élections législatives, De Gaulle a pensé qu’il lui serait possible de se relégitimer par un vote populaire. Il organisa un référendum et annonça qu’il quitterait le pouvoir si le NON l’emportait. C’était une erreur : beaucoup de Français considéraient encore que dix ans, ça suffisait ! La partie de la droite qui n’était pas seulement “non-gaulliste” mais viscéralement “anti-De Gaulle” a saisi l’occasion : au prétexte que le projet gaulliste conduirait in fine à la suppression du Sénat - son bastion au sein des institutions - elle contribua à ce que le NON l’emporte. Avec le départ du général comme inévitable conséquence.
Que cette partie de la droite saisisse la première occasion pour pousser De Gaulle vers la sortie, ce n’était pas une surprise ! Entre elle et lui, c’était depuis longtemps la guerre. Une guerre sur laquelle il n’est pas inutile de revenir. Elle a eu pour toile de fond la question des rapports entre la France, l’Europe et les Etats-Unis … C’est on ne peut plus d’actualité en ce printemps 2025 !
La droite anti-gaulliste de l’après Seconde Guerre mondiale se souvenait de la grande peur de 1936-1937 : elle avait applaudi - ouvertement ou en sourdine - au mot d’ordre “plutôt Hitler que le Front Populaire” lancé par des dirigeants du grand patronat français. Dans la foulée, elle avait tout naturellement choisi Pétain plutôt que De Gaulle. Certains s’étaient vautrés dans la collaboration avec les nazis, d’autres avaient eu la trahison plus discrète, d’autres encore avaient fermé les yeux pour ne pas voir…
En 1944, les dirigeants Américains voulurent imposer à la France un Gouvernement Militaire Allié des Territoires Occupés ( AMGOT en était l’acronyme anglais ). Il s’agissait de placer sous la tutelle des Etats-Unis l’Europe occidentale que l’armée américaine était en train de libérer du nazisme. De Gaulle s’y opposait, mais à lui seul il n’avait pas les moyens politiques d’empêcher les libérateurs d’imposer leur loi. Il ne pouvait compter sur la droite française traditionnelle, prête, une fois encore, à se coucher devant les vainqueurs. Profondément anticommuniste, mais avant tout soucieux de la France et de son indépendance, il fit le choix de former un gouvernement rassemblant des personnalités issues des mouvements représentés au Conseil National de la Résistance dont il s’agissait de mettre en œuvre le programme. Un gouvernement avec des ministres communistes, dont Maurice Thorez comme Ministre d’Etat. La droite de la capitulation et du renoncement était écartée. Je me souviens d’avoir entendu, dans le bureau de Jacques Duclos où ils se retrouvaient souvent des anciens ministres et parlementaires de cette époque raconter comment devant eux De Gaulle accablait de son mépris et de ses sarcasmes cette droite dont il savait à quel point, en retour, elle le détestait.
Si la France avait cédé, c’est toute l’Europe occidentale qui aurait été vassalisée. L’accord entre ces deux grands politiques qu’étaient Charles De Gaulle et Maurice Thorez a fortement contribué à mettre en échec le projet américain. Un tel accord n’allait de soi ni pour l’un ni pour l’autre. Jacques Duclos avait servi d’intermédiaire. Il en parlait avec une fierté à mes yeux légitime.
Écartée du gouvernement mais pas des jeux parlementaires, la droite antigaulliste multiplia les manœuvres hostiles. Les organismes américains agissant sur le territoire européen ne restèrent pas inactifs… Tant et si bien que De Gaulle démissionna le 20 janvier 1946 ; début mai 1947, les ministres communistes furent exclus du gouvernement ; en avril 1948 une scission de la CGT largement “aidée” par la CIA aboutit à la création de Force Ouvrière ; en mai 1948, le Congrès de La Haye sur “l’unité européenne” lançait un processus d’unification européenne. Une unification clairement “inspirée” par les Etats-Unis comme une arme nécessaire dans la “guerre froide” qui commençait.
La droite anti-gaulliste pouvait célébrer sa victoire ! Elle s’affirmait comme la droite atlantiste, alignée sur les Etats-Unis, patrons de l’Alliance atlantique et de son bras armé : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord - l’OTAN. Gaullistes et communistes rejetés dans l’opposition, elle pouvait se retrouver dans cet atlantisme avec le parti socialiste SFIO. Ce fut ce qu’on appela “la troisième force”. Dans un climat d’instabilité permanente, avec de multiples gouvernements aux durées de vie et aux capacités d’action limitées, elle dirigea cahin-caha le pays jusqu’en 1958. Avec à son actif la soumission aux Etats-Unis, une construction européenne orientée vers la lutte contre l’Union Soviétique, les offensives pour remettre en cause les conquêtes sociales du Front Populaire et de la Libération, et les guerres coloniales - dont la guerre d’Algérie sur laquelle se brisèrent les gouvernements successifs.
Jusqu’en 1958, où De Gaulle - qui avait minutieusement préparé son coup pendant sa “traversée du désert” - revint au pouvoir. Dix ans après … nouveau renversement, et nous voila revenus à ton questionnement sur le référendum de 1969 !
Pardon pour ce long développement ! Je plaide coupable ! Je n’ai pu m’empêcher de rappeler ces faits au moment où les anciens atlantistes défilent en larmes devant les micros et caméras pour dire leur déception, leur frustration, leur douleur devant le comportement de la nouvelle administration états-unienne. Ils l’accusent de trahison. De leur point de vue, ils n’ont pas tort. Et loin de moi l’envie de prendre la défense de Donald Trump ! Mais ils ne veulent pas voir qu’aujourd’hui comme hier les dirigeants américains agissent avec comme boussole les seuls intérêts des Etats-Unis. Hier, l’Union Soviétique était l’ennemi principal, et l’union politique européenne étroitement liée à l’organisation militaire de l’OTAN un outil efficace pour le combattre. Aujourd’hui, la Chine est leur premier souci. A défaut de pouvoir la soumettre, ils espèrent pouvoir négocier, comme à Yalta en 1945 avec l’URSS de Staline, un nouveau “deal” de partage des influences dans le monde. Ils veulent négocier dans le meilleur rapport de forces possibles. Il faut pour cela essayer d’empêcher la Chine d’avoir trop d’amis ou d’alliés. Ils considèrent que la stratégie anti-Russie menée jusqu’à présent n’a fait que précipiter la Russie de Poutine dans les bras de la Chine. Ils s’inquiètent par ailleurs de l’émergence de nouvelles puissances sur tous les continents. Elles pourraient compliquer le “jeu” géopolitique s’il n’était plus le jeu à deux qu’ils recherchent, mais un jeu à plusieurs. Dans cet esprit, le renforcement de l’Union Européenne ne les intéresse pas, et si la Russie de Poutine la déstabilise comme elle a entrepris de le faire, ils n’y voient pas matière à s’inquiéter outre mesure !
Les prédécesseurs de Trump avaient déjà annoncé ce changement de cap. Enfermés dans leurs certitudes, nos atlantistes n’ont pas voulu entendre. Et les voilà pris au dépourvu quand Trump passe aux actes, à sa manière, dans l’outrance et la brutalité. Quand ils auront fini de se lamenter, il faudra bien passer à l’étape suivante : une Europe sombrant dans le “chacun pour soi et l’Amérique (peut-être) pour les plus dociles” ou une nouvelle construction européenne refusant tout expansionnisme grand-russe par la force, mais inventant les moyens de coexister avec une Russie contrainte au respect de ses voisins et assurée, en retour, de n’en être pas elle-même menacée. Bref un continent européen pacifié de l’Atlantique à l’Oural. Vaste programme !
Cette situation nouvelle pose aussi un problème aux communistes français. Inspirée par les Etats-Unis comme une arme dans la guerre froide, la construction européenne a été d’emblée combattue par le PCF. Mais il y avait, en France comme dans les pays européens qui avaient tant souffert des deux guerres mondiales dans la première moitié du XX° siècle, une profonde aspiration à l’union des nations et des peuples d’Europe pour qu’y règne enfin la paix. Le combat des communistes contre la construction européenne fut perçu comme un refus de prendre en compte cette aspiration, et comme avant tout guidé par l’allégeance à l’Union Soviétique - ce qui n’était évidemment pas faux en 1947 et dans les années suivantes ! Tout cela a laissé des traces. Dans l’opinion : on ne nous a pas cru quand, bien tardivement - dans les dernières décennies du siècle - nous avons voulu cesser de dire toujours NON à l’Europe. Nous voulions dire OUI à une autre construction économique, sociale et politique, pour une Europe de progrès social et de paix. Mais face à des projets que nous jugions tellement contraires à ces objectifs nous répondions encore et toujours NON !.. Des traces, il ne pouvait manquer d’y en avoir au sein même de notre parti après tant d’années de positionnements facilement vécus comme anti-européens par principe.
Puisqu’après l’évocation du référendum de 1969 nous allons aborder l’élection présidentielle de la même année je me permets une interrogation qui fera pour moi la transition entre les deux sujets.
Dans l’opinion, à l’ouverture de la campagne présidentielle, Pompidou, successeur naturel de De Gaulle, et Duclos, candidat communiste, étaient tous deux considérés comme anti-européens, Defferre, candidat socialiste, et Poher, centriste, comme pro-européens. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles davantage de voix d’électeurs socialistes en désaccord avec la position anti-unitaire de Gaston Defferre n’ont pas franchi le pas vers le vote Duclos. Sans doute cela a-t-il été également le cas pour des électeurs centristes votant sans enthousiasme pour Poher… Si la barrière de l’anti-européisme ne les avait pas retenus, Jacques Duclos aurait-il pu devancer Poher et être au second tour face à Pompidou ? Le paysage politique de l’après De Gaulle en aurait peut-être été changé… Ce n’est jamais bon de refaire l’histoire à coup de “si”... Il n’est toutefois pas interdit d’essayer d’en tirer des leçons : la clarification des positions du PCF sur l’Europe ne s’impose pas seulement au moment des campagnes pour les élections européennes. Elle s’impose particulièrement aujourd’hui alors qu’on voit se dessiner un monde nouveau dans le chaos international qui accompagne la réorientation de la politique américaine.
Le PCF présente ensuite Jacques Duclos, faute d’accord avec le PS (alors SFIO) pour un candidat commun. Après une campagne courte et menée tambour battant, il fait un résultat de plus de 21% alors que le candidat socialiste Gaston Defferre ne rassemble que 5,01% des votants et que François Mitterrand comme candidat de la gauche avait réuni 35% des voix à l’élection précédente, en 1965. Ce résultat a-t-il surpris Jacques Duclos et la direction du PCF ? Quelles leçons en ont-ils tiré sur la capacité du PCF à rassembler ?
Quelle campagne ! Et quel résultat pour le candidat communiste … 21% au premier tour, beaucoup en rêvent aujourd’hui, pas seulement au parti communiste !
Une campagne singulière pour une élection singulière. Celle de 1965 avait été la première élection du Président de la République au suffrage universel. Elle avait surtout permis au général De Gaulle de faire ratifier par le suffrage universel son statut de président-fondateur de la V° République. La fête avait certes été gâchée par la percée de François Mitterrand, candidat de toute la gauche, mais l’objectif avait été atteint. En 1969, non seulement De Gaulle n’était plus candidat, mais, bousculé par le mouvement de mai 1968, puis battu au référendum de 1969, il avait dû abandonner le pouvoir. Un homme politique battu ce n’est pas exceptionnel dans notre histoire républicaine. Mais il ne s’agissait pas de n’importe quel homme politique. Un personnage historique était déchu. La péripétie politique prenait une dimension tragique. C’est dans ce climat inédit qu’allait se dérouler la première campagne opposant des candidats n’ayant pas de légitimité présidentielle antérieure.
Pour Jacques Duclos, c’était une première : il était le premier candidat communiste à l’élection du Président au suffrage universel. Son passé faisait de lui un homme d’Etat expérimenté. La notice biographique du Maitron rappelle qu’il avait été élu député pour la première fois en 1926, et souvent réélu jusqu’en 1958. Il avait négocié pour le PCF le programme du Front Populaire. Après le succès et la formation du gouvernement Blum, soutenu par le PCF, il fut élu, en juin 1936 vice-président de la Chambre des Députés, et réélu en janvier 1938. Pendant tout l’été trente six, avec Maurice Thorez il rencontra tous les mercredis en tête à tête le Premier Ministre du Front Populaire, Léon Blum. Premier dirigeant du PCF clandestin dans la Résistance, avec son ami de toujours Benoît Frachon, à la Libération il négocia avec le général De Gaulle la participation des communistes au gouvernement. Et de 1945 à 1947 il eut “un rôle politique et parlementaire de tout premier plan. Le 19 juin 1945, c’est lui qui proposa à l’Assemblée la nationalisation des banques, assurances, électricité, sidérurgie, chimie, et de la marine marchande”. Dans un tout autre registre, il fut, dans l’opposition aux gouvernements de troisième force, le dirigeant combatif d’un groupe communiste à l’Assemblée qui compta jusqu’à cent cinquante députés… Et pourtant, il incarnait pour l’opinion publique le PCF résistant, protestataire, tribunicien. Allait-il être crédible comme candidat à la Présidence de la République ? Il était identifié comme un homme “du passé”, son activité politique s’était beaucoup réduite au cours des dernières années, il s’était plutôt consacré à l’écriture de livres consacrés à l’histoire, celle de la Commune de Paris de 1971, celle d’Octobre 1917 vu de France… Sa campagne serait-elle en phase avec les préoccupations des Français en 1969 ? Il avait soixante-treize ans, quelle campagne allait-il pouvoir mener ? Comment allait-il se comporter devant les caméras de télévision ?
La première question qui surgit dans le parti dès l’annonce de sa candidature fut celle de son âge. Quelle réaction allait avoir la jeunesse un an après le mouvement de mai 1968 auquel elle avait largement participé, bien au-delà de la jeunesse étudiante ? Il fut donc décidé d’un premier grand meeting en direction des jeunes au stade de Saint-Ouen … Les organisations du PCF et de la Jeunesse Communiste organisèrent une participation massive des jeunes. Et ce fut plus qu’un succès : il suscita l’enthousiasme d’un auditoire juvénile au début sceptique, voire réticent, et qui , au fil du discours du tribun faisant acclamer son idéal d’un communisme “jeunesse du monde” , se réchauffa puis s’enflamma littéralement ! D’anciens jeunes militants de l’époque, aujourd’hui septuagénaires, en parlent encore !
Au-delà de la jeunesse, ce furent, partout en France durant une campagne menée à un rythme d’enfer, des meetings rassemblant des foules impressionnantes et … impressionnées par une éloquence solidement appuyée sur les attentes et les aspirations populaires. Cette capacité à enthousiasmer et à mobiliser ses auditoires, je l’avais constatée dès sa première réunion de campagne, qui, à sa demande, avait réuni, dans sa ville, à Montreuil, quelques centaines de militants communistes. Il avait, comme on dit “mis le paquet” pour convaincre qu’il fallait sans tarder partir en campagne. Emporté par son élan, il s’était écrié de toute la puissance de sa voix : “Alors, debout camarades, pour mener et gagner cette bataille”... et, installé au fond de la salle, j’avais vu la moitié des auditeurs se lever d’un bond avant même qu’il eut fini sa phrase ! Un peu surpris lui- même, il avait marqué un temps d’arrêt avant de poursuivre. Il évita par la suite de provoquer pareille situation, mais il sut utiliser le pouvoir de séduction, de conviction et de mobilisation que lui donnaient ses talents de tribun.
Jacques n’était pas familier de la télévision (ce fut la première fois qu’on l’utilisa autant dans une campagne présidentielle). Les réalisateurs communistes de l’ORTF étaient nombreux et respectés dans leur milieu car liés à des productions (fictions, documentaires ou émissions populaires) remarquées au cours des années précédentes. Ils furent réquisitionnés pour lui prodiguer leurs conseils. Je me souviens des séances “d’entraînement” qui eurent lieu alors. Jacques écoutait poliment les conseils concernant la façon dont il devait s’exprimer - je voyais bien qu’il ne se faisait pas trop de souci à cet égard ; être lui-même : il savait que c’était ce qu’il avait de mieux à faire. Par contre, il s’attachait à se familiariser avec les techniques télévisuelles et la façon dont elles pourraient être utilisées pour valoriser ou non son expression et l’image qu’il voulait donner de lui-même. On lui conseillait “d’oublier la caméra”, il choisissait plutôt de maîtriser ce qu’il allait proposer à la caméra. Il savait que l’exercice allait être redoutable, et qu’il ne fallait jamais cesser de le redouter, il s’y préparait donc avec soin. Le résultat fut pour beaucoup de gens une surprise : amis et adversaires partagèrent vite l’opinion que la notice du Maitron déjà citée résume ainsi : “son savoir-faire, ses rondeurs, ses allures de grand-papa, sa remarquable utilisation du petit écran redoublèrent sa popularité”.
Cette élection fut aussi marquée par l’apparition des sondages d’intention de vote comme élément d’appréciation de l’efficacité des candidats à convaincre leurs électeurs. Au début, au parti communiste on était plutôt méfiants devant ces sondages dont des journalistes de l’Humanité se procuraient les résultats auprès de confrères de journaux de droite. Puis, les indications qui étaient ainsi communiquées ont peu à peu confirmé la possibilité d’un bon résultat, en même temps qu’elles annonçaient la déroute de Gaston Defferre, sanctionné pour son refus de l’union.
Le bon résultat attendu de la campagne de Jacques Duclos et l’échec prévisible du candidat socialiste ont permis, pour la première et seule fois dans l’histoire de l’élection présidentielle sous la V° République, de lancer un appel crédible au vote communiste comme “le vote utile à gauche”. Il n’y a donc pas eu de grande surprise lorsque se sont confirmés les 21% de l’un et les 5% de l’autre. Par contre, il y a eu du regret au constat du faible écart avec Alain Poher : “ à si peu de voix Jacques aurait pu être au second tour “ … Il avait d’ailleurs envisagé cette éventualité et s’était préparé à provoquer Georges Pompidou pour un débat sur les réponses à apporter aux attentes du monde du travail. Il reçut des messages l’encourageant dans cette voie, venant quelquefois de personnes assez éloignées du parti communiste. Il en reçut même après le premier tour qui formulaient le souhait que Poher se retire afin qu’il y ait un vrai duel droite-gauche. Je me souviens que lors d’une réception dans une ambassade d’un pays du Maghreb où il m’avait demandé de le représenter, l’Ambassadeur me tint pour que je les lui répète des propos allant dans ce sens…
La campagne avait été épuisante, et Jacques était très fatigué, mais il était content. Pour de multiples raisons, dont l’une très personnelle : lui, l’ancien “stalinien” que d’aucuns avaient présenté comme un repoussoir qu’il fallait écarter pour engager le parti sur une voie nouvelle, avait été choisi comme le meilleur candidat communiste possible. Il n’avait pas déçu. Au contraire, sa campagne avait permis un résultat sur lequel personne n’aurait parié les années précédentes, quand lui-même s’était mis en retrait pour se consacrer toujours plus à l’écriture sur des sujets historiques.
Le résultat de la candidature Duclos fut évidemment apprécié très positivement par la direction du PCF, et, au-delà, très largement dans le parti. Cependant, ce résultat ne retrouvait pas le niveau de l’électorat communiste d’avant 1958. Des électeurs de la gauche non communiste avaient certes voté Duclos, mais en nombre quand même limité. Le bon résultat communiste était bien sûr étroitement lié à l’échec de Gaston Defferre sur une ligne anti-unitaire. Sans aucun doute le succès de Jacques Duclos montrait qu’une bonne campagne d’un candidat communiste déterminé et combatif pouvait rassembler largement. C’est certainement ce qui, en 1981, a nourri des espoirs malheureusement déçus quant à la possibilité de Georges Marchais - qui lui aussi fit une remarquable campagne qui lui valut une popularité amplement méritée - à faire un résultat comparable. Après le succès de 1969, le parti communiste a accentué sa campagne pour continuer à être le meilleur pour l’union à gauche. Mais François Mitterrand, bien que venu de la droite “bien à droite”, mais aguerri dans l’art de la manœuvre politicienne, et ne reculant devant rien pour arriver à ses fins, a eu l’habileté de se positionner sur le même créneau de l’union à gauche. Il s’est emparé de la direction du parti socialiste pour bénéficier d’un outil militant et d’un réseau d’élus indispensables pour une campagne présidentielle efficace. Et c’est lui qui a pu se proclamer porteur du “vote utile à gauche” . On connaît la suite…
Après cette année 1969 et jusqu’à sa mort, quel rôle Jacques Duclos a-t-il joué au sein de la direction ?
La campagne présidentielle avait été menée à un rythme effréné. Son engagement avait été total. A vrai dire, on se demandait comment il avait pu “tenir” ! Son épouse, Gilberte, s’était plusieurs fois alarmée. Il avait encore réussi à marquer de son empreinte le second tour de scrutin avec sa formule renvoyant dos à dos Pompidou et Poher, bonnet blanc et blanc bonnet . Il avait quitté son bureau le soir en me disant : “ je ne veux pas utiliser la parabole de la peste et du choléra, ça n’est pas ma façon de parler de deux personnes, même s’il s’agit d’adversaires ; d’ailleurs, on ne peut parler comme ça de candidats dont l’un deviendra Président de la République. Il faut trouver autre chose “ . Je n’ai pas trouvé, mais lui, si ! Il est arrivé le lendemain matin en me disant “ j’ai relu des choses dans ma bibliothèque … bonnet blanc et blanc bonnet, ça sera très bien !”. Encore une nuit où il n’avait pas dû beaucoup dormir ! Après une telle campagne qu’il soit très fatigué ne pouvait surprendre !
En réalité c’était plus que de la fatigue. Depuis des années, il souffrait de différentes maladies. Avec une formidable volonté, il avait mené campagne jusqu’au bout. Mais son état s’était fortement aggravé. L’Humanité annonça qu’il cessait provisoirement ses activités pour raison de santé. Il quitta son pavillon de Montreuil pour aller se reposer dans les Hautes Pyrénées, à Louey dans sa maison familiale, et dans la Nièvre, où Gilberte possédait une maison. Il m’invitèrent d’ailleurs à les rejoindre pour quelques jours dans la Nièvre. Ce fut chaleureux, avec même une ou deux escapades gastronomiques - Mais chut ! On n’en parlait pas devant Gilberte… qui faisait semblant de croire qu’il n’y avait pas eu d’entorse au régime qu’elle veillait à faire respecter par Jacques.
Il décida d’achever le plus rapidement possible la rédaction de ses Mémoires, dont le premier tome - De Verdun au parti communiste - avait été publié en 1968. Il connaissait les menaces que faisaient peser sur lui ses nombreuses maladies. Comme toujours il était déterminé à lutter, mais il pressentait que le temps lui serait compté. Il voulait certes raconter et faire savoir ce qu’avait été sa vie et comment il l’avait vécue. Mais au-delà, il savait que ce faisant il entrerait dans un inévitable débat contradictoire sur des événements et des périodes historiques dont il avait été l’un des acteurs. Il ne voulait pas se dérober. C’était pour lui un indispensable moment de confrontation avec son passé.
A-t-il eu raison ? Était-il en mesure, dans les années 1970, de tout dire de ce qu’avait été l’histoire de l’Internationale Communiste et de l’Union Soviétique à laquelle le Parti Communiste Français et lui-même avaient été si étroitement mêlés ? Etait-ce même opportun ? A cette époque, il pensait - et la plupart des dirigeants communistes français l’espéraient encore - que le système soviétique trouverait en lui-même les ressources nécessaires pour corriger les erreurs, répudier les crimes, éradiquer vraiment les pratiques qui dénaturaient l’idéal communiste, et répondre enfin aux immenses espoirs qu’avait suscité la Révolution d’Octobre 1917. Toute initiative extérieure pouvait provoquer des réactions de crispation empêchant de telles évolutions. Il connaissait aussi les pressions et les menaces des dirigeants soviétiques visant à dissuader le parti communiste français de prendre ses distances avec le “modèle soviétique”. Ce n’étaient pas les meilleures conditions pour revenir sur le passé… Il a cru pouvoir malgré tout faire entendre “sa” vérité… Encore une fois, attention à la néfaste “manie du jugement” !
Il travaillait seul. L’image me revient (toujours avec émotion…) des cahiers d’écolier sur lesquels il écrivait avec application. Il les confiait à Hélène, sa secrétaire, qui s’affairait sur sa machine à écrire ( eh oui ! En ce temps-là on ne connaissait pas les claviers d’ordinateurs ! ). Puis Hélène et moi - l’un lisant à haute voix le texte dactylographié et l’autre vérifiant sur les cahiers , nous nous assurions que ce texte était en tous points fidèle au manuscrit de Jacques. Après quoi je lui remettais le document. Je pouvais faire des propositions de modification sur la forme - en vérité j’en fis très peu. Et quelquefois, avec une grande prudence, je posais des questions à propos de passages qui me paraissaient devoir être plus précis. Il y eut quelques rebuffades m’indiquant qu’il ne fallait pas insister … Il se radoucissait quelques instants après et me confirmait gentiment mais fermement qu’il avait bien réfléchi et ne voulait pas en dire davantage. Ses raisons, lorsqu’il me les expliquait, ne me paraissaient pas toujours évidentes. Mais il s’agissait d’événements que je n’avais pas vécu, et …c’étaient ses raisons, c’étaient ses Mémoires…
Jacques leur consacra donc beaucoup de son temps dans les années qui suivirent l’élection présidentielle. Le sixième et dernier tome parut en 1973. Il ne se désintéressa pas pour autant des évolutions que connut à cette époque le PCF, avec la maladie de Waldeck Rochet et la mise en place de son successeur, Georges Marchais. Il intervint ponctuellement mais significativement dans la vie politique française, et conserva une activité internationale faite d’articles dans diverses revues, de voyages et de rencontres avec des personnalités de différents pays.
Waldeck Rochet ne fut malheureusement pas longtemps secrétaire général du PCF, mais il fit à ce poste, avec beaucoup d’intelligence et de créativité, un travail remarquable. Je regrette qu’on ne le rappelle pas suffisamment… Waldeck ne mérite certainement pas cet effacement de la mémoire collective des communistes français ! Lorsque sa maladie se déclara, il apparut vite qu’il ne pourrait plus poursuivre ses activités. Il fallut choisir un successeur. Les historiens spécialistes du PCF s’accordent à souligner que la vieille garde “thorézienne” a joué un rôle décisif. Elle a été consultée et a tranché pour désigner Georges Marchais. Jacques Duclos ne m’en a absolument rien dit. Mais je sais quelle influence déterminante il avait sur cette “vieille garde”. Georges et lui n’étaient pas de la même génération, ils n’avaient pas la même expérience militante, et pas non plus les mêmes caractères… Leurs relations étaient loin d’être de même qualité que celles qui avaient lié les “anciens” de la direction du parti. Une décision politique avait été prise. A partir de cette décision à laquelle il avait évidemment contribué de façon déterminante, Jacques Duclos s’engagea pour soutenir sans faille le nouveau premier dirigeant du parti. Il prononça l’allocution d’ouverture du XIX° congrès, en février 1970, au cours duquel Georges Marchais fut élu secrétaire général adjoint. Au XX° congrès, en décembre 1972, faisant le lien avec la politique unitaire qui avait abouti au Front Populaire en 1936, il affirma son soutien à la politique de recherche d’un accord programmatique avec le parti socialiste. Il confirma ce soutien jusqu’à la signature du programme commun, en juin 1972. De même, l’ancien dirigeant du PCF dans la Résistance, avec le bureau politique unanime, apporta son soutien à Georges Marchais quand celui-ci fut odieusement mis en cause pour avoir été en Allemagne pendant la guerre, au titre du Service du Travail Obligatoire (STO).
Toujours engagé dans les rapports du PCF avec les partis communistes du monde entier, il écrivit pendant ces années de nombreux articles dans différentes revues. Notamment des revues soviétiques ou de partis au pouvoir en Europe de l’Est. Il me demandait de préparer des projets : il m’indiquait les idées et les arguments qu’il voulait développer, puis il ajoutait benoîtement : “n’oublie pas d’insérer des citations des “pères fondateurs” ( Marx, Engels, Lénine…), ‘ils’ seront plus réceptifs !” - Je n’éprouvais pas le besoin de lui demander qui étaient ces ‘ils’... Il participa à des rencontres, à Moscou et ailleurs, avec des dirigeants communistes de différents pays. En décembre 1971, il se rendit au Chili, il y rencontra le président Allende. Dans le prolongement de sa visite à Hanoï en 1968, il participa en juillet 1972 à la conférence des partis communistes européens pour soutenir le Vietnam. Son autorité dans le mouvement communiste international contribua à éviter que la condamnation par le PCF de l’intervention armée soviétique en Tchécoslovaquie, en août 1968, ne conduise à une rupture. Laquelle aurait immanquablement été suivie de mesures de rétorsion destructrices que le parti communiste de l’URSS n’aurait pas hésité à prendre. Georges Marchais, dont l’autorité sur le parti restera fragile jusqu’en 1981, n’aurait peut-être pas eu les moyens de résister.
En retrait de la vie politique française, il fut pourtant conduit à sortir de sa réserve début 1970. Après le mouvement de Mai 1968, le départ du général, puis l’élection sans éclat de Pompidou, Michel Debré, ancien Premier Ministre devenu figure tutélaire du gaullisme de l’après De Gaulle, avait lancé une campagne accusant l’opposition - particulièrement le parti communiste - d’être “l’anti-France”. Il fallait riposter, et Jacques Duclos participa, le 17 février 1970, à la première d’une nouvelle émission politique qui allait marquer la vie politique française pendant plusieurs années : A armes égales. Il y était opposé à Michel Debré sur le thème de “la patrie”. L’émission eut un certain retentissement.
Quatre ans plus tard, un autre débat se termina plus tristement. Le 12 novembre 1974, au Sénat, Michel Poniatowski et Jacques Duclos s’affrontèrent. Très malade, et souffrant ce jour-là terriblement, Jacques ne put s’imposer avec sa maîtrise et sa verve habituelles. Il fallut se rendre à l’évidence : l’heure était venue de mettre un terme à sa longue et riche vie militante. Il fut hospitalisé une première fois le 10 janvier 1975. (Je me souviens d’être allé l’embrasser à la clinique où il venait d’être opéré. Ce fut notre dernière rencontre). Hospitalisé une seconde fois trois mois plus tard il décéda le 25 avril, chez lui, dans son pavillon de Montreuil. Près de deux cent mille personnes accompagnèrent en cortège son cercueil de la place du Colonel Fabien au cimetière du Père Lachaise.
Abordons brièvement une autre période, capitale pour l’histoire, les années de la Seconde Guerre mondiale, où Jacques Duclos passe dans la clandestinité à Bruxelles, et dirige le PCF avec Benoît Frachon, sur le sol national, et Charles Tillon à partir de 1941. Tu n’as pas été témoin des événements mais Jacques Duclos a-t-il évoqué avec toi cette période terrible et la manière dont il l’a vécue au quotidien ?
Ce fut une période particulièrement importante dans la vie de Jacques Duclos. Maurice Thorez avait été mobilisé dès le début de la guerre. Il fut ensuite rappelé à Moscou par l’Internationale Communiste. Il y resta jusqu’en 1944. Jacques Duclos dut assurer pendant ces cinq années la direction du PCF. Il dirigea le parti clandestin sous l’occupation nazie avec son vieil ami Benoît Frachon. Celui-ci n’était pas pour Jacques Duclos un dirigeant du PCF comme les autres. Dans ses Mémoires, il raconte avec émotion comment, jeunes militants syndicalistes révolutionnaires dans les années 1920, ils se lièrent d’une amitié fraternelle - complicité fraternelle serait sans doute une expression plus juste. Sous l’occupation, pour des raisons de sécurité évidentes, ils étaient géographiquement éloignés l’un de l’autre, et dans les messages adressés à Jacques pour l’informer de l’opinion ou des propositions de Benoît, celui-ci était significativement appelé l’Oncle. Et c’est ensemble, à bord d’une voiture des FFI (Forces Françaises de l’Intérieur regroupant forces armées communistes et gaullistes) que Jacques et Benoît entrèrent dans Paris le 25 Août 1944.
Tu as raison de parler d’une période terrible : terrible pour les peuples frappés par une guerre sanglante et dévastatrice ; terrible pour les Juifs d’Europe en proie à un génocide froidement organisé et méthodiquement exécuté au nom d’une idéologie criminelle ; terrible pour les communistes des pays occupés - c’est au nom de la lutte contre “le judéo-bolchévisme” qu’agissaient les assassins nazis et leurs supplétifs locaux ! Et bien sûr terrible pour les communistes français qui, par milliers, furent poursuivis, arrêtés, torturés, emprisonnés, déportés, et souvent assassinés. Pour tous les communistes, quelles que soient leurs responsabilités dans l’organisation clandestine, le danger était permanent. Pour Jacques Duclos comme pour les autres, et on peut imaginer ce qu’aurait été son sort si la police de Vichy ou la Gestapo avaient réussi à l’arrêter …
De la façon dont il a personnellement vécu cette période, Jacques me parlait peu. Sauf bien sûr pour répondre aux questions que je posais pour l’amener, s’il le souhaitait, à préciser ou développer certains passages du manuscrit de ses Mémoires. Il ne voulait pas faire étalage de la détermination, du courage, et des qualités de dirigeant dont il avait fait preuve pendant ces cinq années. Mais s’il ne parlait pas facilement de lui, il parlait volontiers des autres. De ces résistants, de ces rescapés de l’horreur qu’il recevait fréquemment. Lorsqu’il me faisait fixer un rendez-vous pour l’une ou l’un d’entre eux, il ne manquait pas de me dire : “tu sais, lui, ou elle, a fait ceci ou celà à tel moment. Quel courage, hein ! “ Et il m’expliquait comment il ou elle avait à la fois exécuté une décision du parti et fait preuve d’intelligence et d’initiative pour éviter de mettre l’organisation, donc d’autres camarades, en danger. Il essayait de me faire comprendre comment ces hommes et ces femmes communistes avaient vécu le paradoxe de cette période terrible. Dans une lutte sans merci contre un ennemi coupable de crimes épouvantables, ils risquaient chaque jour leur vie et voyaient tant de leurs camarades se faire voler la leur. A leur tour, ils ont dû aller jusqu’à tuer. C’était pour eux une inévitable obligation. Et parce qu’il était juste, le combat fut exaltant. Ils ont accompli des actes de courage et d’abnégation dont ils étaient légitimement fiers.
Jacques me parlait donc davantage du rôle que ses visiteurs avaient eu pendant la Résistance que de son propre rôle. Mais lorsqu’ils passaient par mon bureau avant d’entrer dans le sien, eux me parlaient de lui, de son rôle à la tête du parti communiste clandestin bien sûr, mais aussi et surtout de l’admiration qu’ils avaient pour lui, de la confiance qu’ils lui faisaient encore, plus de vingt ans après la fin de la guerre. J’étais bien sûr impressionné par les récits que me faisaient les uns et les autres de ce qu’avaient été leur vie et leur action dans ces années terribles. Je l’étais tout autant par leur comportement les uns vis-à -vis des autres : les liens fraternels si forts qui continuaient à les unir avaient ceci de particulier qu’ils les liaient entre eux et en même temps avec leur parti. Pour celles et ceux qui venaient rencontrer Jacques, il incarnait ce lien plus de vingt ans après la fin de la guerre, comme il l’avait incarné pendant les années terribles. Il en avait conscience autant qu’eux. Je me souviens de la façon dont ils les accueillait dans son bureau, les bras largement ouverts, et de ce retentissant “ Alorrrsss ! comment vas-tu ?” qui résonnait de son accent où - l’image fut souvent employée par des journalistes : les r roulaient comme les cailloux emportés par les gaves pyrénéens… Il y avait entre eux une fraternité profonde faite des dangers encourus, des risques partagés, des petits et grands succès remportés dans une lutte implacable. Tout cela, ils et elles l’avaient vécu là où les événements les avaient dispersés, séparés les uns des autres mais unis par ce parti clandestin dirigé par Jacques Duclos.
J’en parle avec émotion. Mais souvent quand on entreprend de raconter Jacques Duclos tel qu’on l’a connu, on est ému, grave, et soudain amené à sourire, voire à rire franchement au souvenir d’une anecdote. Un souvenir me revient quand j’évoque les liens entre Jacques et de nombreux anciens résistants. Lorsque je travaillais à ses côtés, beaucoup d’entre eux avaient encore des responsabilités importantes, dans l’organisation du parti, ou comme élus. Il arrivait que la direction du parti estime qu’il fallait adresser des critiques ou faire des remontrances à tel ou tel d’entre eux. C’est naturellement à Jacques que l’on confiait cette tâche. Il me faisait alors venir dans son bureau. Il me disait “tu va me convoquer untel. J’ai deux mots à lui dire …” Mais c’est à moi qu’il disait beaucoup plus que deux mots. Celà commençait invariablement par “Je vais lui dire…” et pendant de longues minutes j’avais droit à une engueulade en règle… péremptoirement conclue par ces mots : “oui, voilà ce que je vais lui dire. Convoque le ”. Le jour venu, le fautif arrivait, inquiet de ce qui l’attendait ; je l’introduisais dans le bureau de Jacques … Et là … un Jacques Duclos tout souriant lui ouvrait les bras : ”Alorrrsss, comment vas-tu ?”. Il avait déjà dit tout ce qu’il avait à dire - pas à lui, mais qu’importe ! Et son visiteur finissait par aborder de lui-même, souvent en faisant amende honorable, le sujet des reproches que la direction du parti souhaitait lui adresser … Tout se passait sans éclats de voix … mais rarement sans éclats de rire !
J’en reviens (m’en suis-je vraiment écarté ?) à la fraternité qui unissait entre eux les anciens du parti communiste clandestin et qui les unissait à Jacques Duclos. Au nom de cette fraternité, ils étaient attentifs les uns aux autres. Ils veillaient les uns sur les autres. Ils se préoccupaient des familles de celles et ceux de leurs camarades qui n’avaient pas survécu, morts au combat, assassinés par la gestapo, morts en déportation. Ensemble, ils veillaient avec exigence à ce que soit respectée et honorée leur mémoire, la mémoire de la Résistance. C’est dans ce contexte qu’un événement particulier m’a beaucoup fait réfléchir. Un jour, Jacques m’appelle dans son bureau. Avec une gravité inhabituelle dans nos rapports il me demande d’inscrire à l’agenda de ses déplacements une cérémonie prévue en Normandie. Il me précise : “Je vais faire un discours. Tu n’auras rien à préparer, c’est très personnel : il s’agit de réhabiliter la mémoire d’un camarade, Georges Déziré, qui a été accusé à tort d’avoir trahi. Il a été condamné, puis exécuté. Cette terrible décision a été prise sous ma responsabilité. Je dois l’assumer publiquement, en présence de sa veuve, de sa famille et de ses camarades.” Son émotion était évidente. Je n’ai pu m’empêcher de penser qu’il y avait sans doute eu d’autres dramatiques erreurs, certainement explicables par les conditions particulières de la guerre et de la clandestinité, mais dont le souvenir devait être terriblement lourd pour celles et ceux qui en avaient été , à un degré ou un autre, responsables.
Les liens entre les anciens résistants ne se résumaient pas à la fraternité unissant les communistes. Le parti communiste clandestin a certes joué un grand rôle dans la résistance à l’occupation nazie, mais des mouvements de résistance animés par des dirigeants de toutes opinions ont aussi joué un rôle - en premier lieu ceux qui se revendiquaient du général De Gaulle. Au-delà de ce qui ne cessait d’opposer les forces politiques, les courants de pensée auxquels ils adhéraient ou dont ils étaient proches, des hommes et des femmes ont risqué leur vie dans un même combat. Un lien particulier s’est tissé entre eux. Particulièrement entre les communistes et les gaullistes agissant sur le territoire national. Ils ont été souvent conduits à s’aider les uns les autres face à l’ennemi commun. Ce lien a perduré au cours des décennies qui ont suivi la guerre, par-delà ce qui les a opposés, parfois violemment. J’ai pu constater qu’ils savaient utiliser leurs relations au sein d’organisations d’anciens Résistants, d’anciens déportés, de familles de victimes du nazisme et du pétainisme, pour peser dans certains débats politiques. Quelles qu’aient été les responsabilités des uns et des autres au sein d’organisations politiques, syndicales ou autres, dans des assemblées élues, voire dans tel ou tel gouvernement, les relations qu’ils pouvaient avoir entre eux étaient toujours marquées du souvenir des combats communs.
J’ai en mémoire une anecdote qui en témoigne. Jacques Duclos était un débatteur redouté de ses adversaires. Il ne les ménageait pas. Même s’il les connaissait personnellement (et à l’époque où je travaillais avec lui, après tant d’années de vie parlementaire, il en connaissait beaucoup !), son attitude dès son entrée dans le studio de télévision ou de radio où ils allaient s’affronter leur indiquait clairement que ce ne serait pour lui en aucun cas une raison pour les épargner. Pourtant, un jour où il était opposé à une importante personnalité gaulliste, je l’ai vu se comporter tout autrement. Son adversaire avait été un authentique résistant. Il était gravement malade. A peine arrivé dans le studio, Jacques s’est précipité vers lui. Chaleureux et attentionné, il lui a demandé de ses nouvelles, l’a assuré de sa solidarité dans l’épreuve qu’il traversait. Le climat dans le studio fut après cela bien différent de ce qu’il était habituellement. Le débat fut sans concession, mais empreint de respect et d’humanisme.
Je viens d’évoquer les liens qui s’étaient tissés entre résistants communistes et gaullistes, et j’ai précisé que je parlais en l’occurrence de “gaullistes agissant sur le territoire national”. De tels liens ne pouvaient exister avec d’autres gaullistes ! Ce n’est un secret pour personne que De Gaulle redoutait que l’organisation militaire créée par le PCF - les Franc Tireurs et Partisans Français (les FTP comme on disait) - puisse servir à une prise du pouvoir par “les communistes” lorsque les nazis seraient contraints à se retirer. Dans son entourage londonien, composé de gens aux origines politiques diverses, certains étaient farouchement anticommunistes. Ils firent en sorte de limiter les parachutages d’armes destinés à la résistance communiste. Des parachutages attendus d’urgence par certaines unités de FTP ne sont jamais arrivés, et les conséquences ont été dramatiques…
On s’en souvenait encore parmi les anciens résistants plusieurs décennies après la fin de la guerre. Jacques Duclos s’en souvenait. J’ai pu le constater dans des circonstances assez inattendues : lors de la mort du général de Gaulle, survenue le 9 novembre 1970. L’annonce de son décès a provoqué une grande émotion, et des émissions spéciales ont été organisées sur toutes les radios. L’une d’entre elles avait réuni un grand nombre d’anciennes personnalités de toutes les organisations de la Résistance, appelées à se succéder au micro pour apporter leur témoignage. Avant d’entrer dans le studio, elles avaient été rassemblées dans une salle, assises en silence les unes à côté des autres, sans aucun ordre préétabli, mais en fonction des chaises disponibles. Jacques une fois installé, je m’étais placé à l’écart. Je me sentais bien petit face à ces personnages historiques. Je les regardais les uns et les autres en songeant à ce qu’ils et elles représentaient pour notre pays. Soudain, un cri de douleur retentit - je m’en souviens, c’était un cri aigü, exprimant de la souffrance, mais aussi une certaine indignation. Je vis alors Jacques Duclos se rasseoir tranquillement. Il venait d’écraser de tout son poids le pied de l’un des responsables londoniens que je viens d’évoquer. Il n’y eut aucun commentaire. Ceux qui étaient là savaient parfaitement de quoi il retournait ! Chacun se présenta devant les micros pour rendre hommage au général. Dans la voiture nous ramenant au siège du Comité central, une certaine lumière dans les yeux de Jacques me dit qu’il ne regrettait rien…
J’ai déjà longuement parlé des liens unissant Jacques Duclos et les anciens résistants communistes. C’est à leur solidité et leur pérennité que l’on doit une particularité notable du PCF au cours des décennies qui suivirent la Seconde Guerre Mondiale. C’est ce que souligne la notice du Maitron que j’ai déjà citée [1] : “Dès que Thorez rentra à Paris le 27 novembre 1944, Duclos redevint le numéro deux du PCF. Jamais il n’aura cherché au cours ou au lendemain de la guerre, à supplanter le secrétaire général - qui lui en demeurera reconnaissant - et avec qui il travaillera en totale complémentarité. Mais Duclos restera l’homme clef du PCF (souligné par moi P.B.) et en supervisera quotidiennement l’activité, tout en s’occupant particulièrement de la propagande et des élections.” . Si Jacques Duclos avait une telle place dans la vie du parti communiste, c’est qu’il avait une place particulière dans le cœur des militants (dans le parti, on l’appelait affectueusement “le p’tit Jacques”). Cette place particulière était la conséquence directe de sa popularité auprès des anciens résistants, et plus généralement des communistes de la génération de la guerre. Et en parlant des anciens résistants, je n’évoque pas seulement les communistes clandestins sous l’occupation nazie, mais aussi - et c’est très important - les résistants “avant l’heure”, celles et ceux qui s’étaient levés pour défendre la République Espagnole assassinée par Franco avec l’aide d’Hitler et Mussolini. Jacques Duclos avait joué un rôle déterminant dans la mobilisation française et internationale pour ce premier combat (hélas perdu !) contre le fascisme mussolinien et l’hitlérisme. Sa popularité dans le parti français mais aussi dans les autres partis communistes, dans l’Internationale Communiste, déjà importante après le succès du Front Populaire en 1936, en avait encore été grandie.
Je pense que cette popularité et cette autorité conquises dans les années 1930 lui ont permis de préserver l’unité du parti quand est parvenue en France, en Août 1939, l’incroyable et aberrante nouvelle de la signature par Staline du pacte germano-soviétique. Il n’a alors désavoué ni Staline, ni l’Internationale. Il a appliqué ou fait appliquer les consignes qui lui parvenaient de Moscou. Jamais il ne m’a dit quoi que ce soit de ce qu’il pensait vraiment à ce moment. Mais je l’ai connu plus convaincant sur d’autres sujets ! Je ne l’ai pas entendu développer l’argumentation “officielle” selon laquelle l’Internationale Communiste et le PCF auraient mal apprécié “le caractère de la guerre”. Elle aurait été caractérisée à tort comme l’affrontement entre différents impérialismes, qui ne pouvait concerner les communistes, et non comme l’affrontement des peuples et des nations avec le nazisme antisémite, anticommuniste, antihumaniste, antidémocratique… Il savait bien que telle n’était pas l’analyse que lui-même avait développée depuis la montée du fascisme en Italie, puis de l’hitlérisme en Allemagne. Encore moins depuis l’aide apportée à Franco par Mussolini et Hitler pour abattre la jeune République Espagnole. Cette argumentation sur “l’analyse erronée du caractère de la guerre” ne fut, à mon avis, qu’un habillage idéologique après-coup de l’acceptation par les partis communistes - en l’occurrence par la direction du PCF - de la désastreuse “stratégie” de Staline !
Pour sa part, Jacques Duclos se contentait de dire : “ nous reprenions les arguments des soviétiques expliquant le pacte par le refus des occidentaux de conclure une alliance défensive avec l’URSS” . C’était factuellement vrai, mais il savait bien que cela ne pouvait justifier l’erreur criminelle de Staline. L’Union Soviétique baissait la garde et ne se préparait pas à l’inévitable affrontement avec l’Allemagne hitlérienne. Des millions de soviétiques l’ont payé de leur vie quand 22 mois plus tard Hitler lança ses troupes pour envahir leur patrie. Dans le même temps le pacte désarmait les communistes des pays européens qui s’apprêtaient à affronter les armées de la croisade contre le judéo-bolchévisme. Beaucoup d’entre eux les avaient déjà affrontées en Espagne. Le pacte germano-soviétique a aussi servi de prétexte aux gouvernants français pour interdire le PCF, pourchasser ses dirigeants et militants, dont certains furent ensuite remis aux occupants, torturés, déportés, assassinés !
Je persiste à penser que Jacques Duclos, en ce mois d’Août 1939 où lui parvint la nouvelle de la signature du misérable pacte, était parfaitement lucide. Il a fait un choix politique, sans doute difficile. Les communistes étaient dispersés à cause de la mobilisation des hommes en âge de porter les armes. Beaucoup étaient désemparés. Il fallait leur expliquer que l’essentiel devait être de rester unis et de s’organiser en vue de ce qui allait suivre. Et pour qui avait compris ce qui venait de se passer en Espagne, pour qui avait lu Mein Kampf [2], ce qui allait suivre ne faisait aucun doute. D’ailleurs, le parti fut aussitôt interdit et la chasse aux militants commença. Il fallait passer dans la clandestinité, ce qui demandait un énorme travail d’organisation. C’est à ce travail que Jacques Duclos consacra l’essentiel de son activité. D’abord en France, pendant une période de semi-clandestinité, puis depuis la Belgique, d’octobre 1939 à juin 1940, où le délégué de l’Internationale Evgen Fried avait installé une base technique- postes émetteurs-récepteurs, planques, réseaux, etc.. - qui permettaient un travail efficace. Le 12 ou 13 juin 1940 il rentra à Paris. Il y assista à l’entrée des Allemands. Déménageant plusieurs fois dans Paris puis dans la grande banlieue, il dirigea le parti clandestin depuis le territoire national jusqu’à la fin de la guerre.
Comme tu t’en doutes je ne peux terminer l’évocation de l’action de Jacques Duclos dans cette période sans aborder la question de la demande faite aux autorités d’occupation pour la reparution légale du journal l’Humanité. Je précise d’abord que ces négociations n’ont pas abouti. L’Humanité clandestine a joué un grand rôle dans le combat du parti communiste contre l’occupation nazie.
Comme je l’ai déjà indiqué, dans la foulée de la signature du pacte germano-soviétique des directives furent données par l’Internationale aux partis communistes d’Europe. L’une d’entre elles appelait ces partis à négocier avec les occupants la poursuite de la parution des journaux communistes, ou leur reparution s’ils avaient été, comme en France, interdits. Cela revenait à placer ces journaux sous le contrôle des nazis qui exigeraient évidemment un droit de regard et de censure sur leur contenu. Cette décision aberrante - à vrai dire déshonorante pour ceux qui l’ont édictée - avait été prise à Moscou. Personne ne peut imaginer que cela aurait pu se faire sans la participation de Maurice Thorez, membre éminent des organismes de direction de l’Internationale, présent dans la capitale soviétique, et secrétaire général d’un des partis communistes concernés.
Jacques Duclos était alors à Bruxelles, accompagné de Maurice Tréand, qui travaillait depuis longtemps avec lui, et en compagnie d’Evgen Fried, dit Clément, délégué de l’Internationale auprès du PCF depuis 1930. Ils apprirent ensemble la décision et l’ordre qui leur était donné de l’exécuter. Ils quittèrent Bruxelles le 6 juin. Jacques Duclos et Maurice Tréand se séparèrent en chemin et gagnèrent Paris par des voies différentes. Dès le 17 juin, Maurice Tréand prit contact avec les occupants pour négocier la reparution de l’Humanité. Personne ne peut croire que Jacques Duclos aurait pu l’ignorer.
Et pourtant il écrit dans ses Mémoires : “Des camarades, animés sans aucun doute de bonnes intentions et qui, par la suite, se battirent courageusement contre les occupants, pensèrent que la presse du parti pourrait paraître légalement puisqu’aussi bien d’autres journaux étaient publiés. Ils firent donc des démarches en ce sens. La direction du parti désavoua ces démarches, et les auteurs reconnurent leur erreur “.
Lorsqu’il écrit cela, Jacques Duclos sait que ce n’est pas la vérité. Il sait que des communistes connaissant cette vérité ont témoigné, et que des historiens ont recoupé ces témoignages avec des informations recueillies par ailleurs. Et pourtant, il sert à ses lecteurs cette version à laquelle personne ne peut croire ! Pourquoi ? Cette question, je me la suis longtemps posée ! sans vraiment trouver une réponse. Seulement des éléments qui peuvent suggérer une hypothèse que des historiens trouveront sûrement trop peu fondée, et peut-être entachée d’une affectueuse complaisance avec celui qui a tenu une si grande place dans ma vie militante… Tant pis ! Je les livre quand même à la réflexion…
D’abord, lorsqu’il m’en a parlé, Jacques Duclos n’a jamais prétendu avoir, en juin quarante, fait part à Maurice Thorez et à l’Internationale d’un quelconque désaccord avec la décision qui lui avait été transmise. Il ne m’a pas non plus dit qu’il l’avait approuvée. Et l’on sait par un message reçu par lui dès son retour à Paris, dont il n’a jamais caché l’existence (bien au contraire) que son alter ego à la direction du parti clandestin, Benoît Frachon, avait clairement manifesté sa désapprobation - “l’Oncle n’est pas d’accord” indiquait clairement ce message. Pour moi, il a laissé faire Maurice Tréand et l’équipe mise sur pied pour l’accompagner dans ses démarches. Ils ont constaté que les exigences des occupants rendaient l’affaire impossible. Il l’a fait savoir, et en Août, Maurice Thorez a indiqué qu’en fait il était en désaccord avec cette demande de reparution. C’est cette version selon laquelle Maurice Thorez avait condamné la démarche, qui a été répandue dans le parti à la Libération.
On peut penser que Jacques Duclos a refusé de porter seul le chapeau d’une décision qu’il n’avait certes pas désapprouvée, dont il avait supervisé l’exécution, mais qui avait été prise sans lui, et que Maurice Thorez avait mis trois mois à désapprouver. En même temps il restait fidèle à sa ligne de conduite : rester “dans son couloir” de second soutenant sans faille Maurice Thorez. Il n’ignorait rien des critiques, le plus souvent sourdes mais quelquefois plus virulentes, de certains communistes - notamment parmi les anciens résistants - reprochant à celui-ci d’être resté à Moscou pendant toute la durée de la guerre pendant qu’eux risquaient leur vie dans la lutte contre les occupants. Il combattait durement ceux qui s’appuyaient sur ces critiques pour contester la légitimité du Secrétaire Général. On peut penser que, ne voulant rien faire qui nuise à Maurice Thorez, mais ne voulant pas non plus accepter le rôle de bouc émissaire, il a choisi de camper sur une version des faits totalement inacceptable, dans l’espoir qu’un jour peut-être la vérité se ferait jour… Ce n’est qu’une hypothèse. Y en a-t-il une ou plusieurs autres plus crédibles ?
Jacques Duclos a écrit en 1969 pour la revue Les cahiers d’histoire de l’Institut Maurice Thorez un texte émouvant sur Eugène Fried, l’envoyé de l’Internationale communiste auprès du PCF dans les années 1930 et assassiné par les nazis. A-t-il évoqué avec toi ce personnage et en quels termes ?
Jacques a souvent évoqué devant moi le rôle important joué par Evgen Fried auprès de la direction du Parti Communiste Français, et la profonde amitié qui les liait. C’est en novembre 1930 que Fried fut désigné comme représentant de l’Internationale auprès du PCF. Dans cette période chaotique de la vie du jeune parti communiste, une grande partie de l’activité de direction devait s’effectuer plus ou moins clandestinement, c’est dans ces conditions qu’Evgen Fried devint “le camarade Clément”. Il s’impliqua personnellement dans la formation idéologique et politique, et dans l’aide quotidienne à apporter à des nouveaux dirigeants mis en place en Août 1931, parmi lesquels Maurice Thorez, Jacques Duclos, Benoît Frachon. Il contribua de façon décisive à structurer une direction efficace. Il veilla personnellement au choix des cadres appelés à prendre des responsabilités dans la vie interne et l’action du parti.
Dans l’article que tu cites, Jacques Duclos rappelle l’aide apportée par Clément dans la période qui précéda le Front Populaire. Il comprit toute l’importance des événements du 6 février 1934, qui montraient la réalité du danger que représentaient les organisations factieuses d’extrême droite. Il appuya Maurice Thorez dans sa décision de répliquer à leur mobilisation du 6 février, qui avait tourné à une émeute clairement dirigée contre les institutions de la République, par une manifestation le 9 février. Puis il encouragea les dirigeants du PCF à développer avec audace une politique de rapprochement avec le parti socialiste. C’est cette politique qui permit au PCF de jouer un rôle décisif dans la formation puis la victoire du Front Populaire trois ans plus tard.
Selon Marcel Cachin ce serait Clément qui aurait inventé la formule “le Front Populaire du pain, de la paix et de la liberté”. Cette formule marquait une rupture avec la conception selon laquelle les communistes ne pouvaient envisager la participation ou le soutien à un gouvernement que s’il s’agissait d’abolir le capitalisme et de ”construire le socialisme”. Au contraire, Maurice Thorez expliqua clairement que le but du Front Populaire “pour le pain, la paix, la liberté” n’était pas de prendre le pouvoir pour abolir en France le capitalisme et instaurer une société “socialiste” qu’on ne pouvait à l’époque imaginer autrement qu’à l’image de la société soviétique. Il s’agissait précisait-il “d’éviter à la France la honte du fascisme”. La précision était absolument nécessaire - pour les citoyens et les futurs alliés du PCF qui devaient savoir quelles étaient exactement ses intentions ; et d’abord pour les militants communistes, qui lors de la première grande manifestation commune avec les militants socialistes avaient défilé en scandant le mot d’ordre qui était le leur depuis 1920 : “des soviets partout” ! Ce serait aussi Clément qui aurait conseillé à Maurice Thorez d’aller au-delà du rapprochement avec le parti socialiste, et de proposer une alliance au Parti Radical, alors que l‘Internationale y était opposée.
J’ai évoqué précédemment le rôle de Clément au printemps 1940 pour permettre aux communistes français, belges, et aux communistes européens qui pouvaient se trouver en Belgique, de disposer d’une base technique pour s’organiser dans la clandestinité. Dans son article de 1969, Jacques Duclos rappelle qu’ils restèrent en contact - Jacques en France, et Clément en Belgique - jusqu’en 1943. “A un moment donné (début 1943) une lettre que je reçus de lui me donna à penser qu’il sentait le filet de l’ennemi se resserrer autour de lui. Il demandait s’il était possible d’organiser son installation en France, ce qui nous posait des problèmes difficiles à résoudre, mais nous étions décidés à faire le nécessaire pour le faire venir. Malheureusement, peu après, nous apprenions qu’il avait été tué par la Gestapo (le 17 Août). Rentrant dans le logement où il habitait, il se trouva nez à nez avec des sbires de la Gestapo et sans doute tira-t-il sur ces individus qui l’abattirent sur place, ce qu’ils n’auraient pas fait dans d’autres conditions, heureux qu’ils auraient été de pouvoir le cuisiner”.
Je ne peux manquer de citer la conclusion de l’article de Jacques Duclos : “...si j’écris ces lignes, c’est parce qu’il n’est pas juste qu’en raison des conditions de son travail clandestin, la mémoire de ce grand disparu ne soit pas honorée comme elle le mérite. Militant tchécoslovaque, le camarade Fried, notre Clément, fut un communiste exemplaire. Il est mort pour son idéal dans la bataille contre les nazis qui avaient piétiné, morcelé sa patrie, et c’est le coeur plein d’émotion que ma pensée va à sa mémoire, et c’est la pensée affectueuse d’un camarade de combat, d’un frère, d’un ami.”
La portée de cet article, publié en 1969, quelques mois après l’intervention armée soviétique pour mettre au pas la Tchécoslovaquie, patrie de Fried, me semble aller bien plus loin que la seule commémoration d’un “camarade de combat”. Il n’y a plus, en 1969, d’Internationale Communiste, mais il y a un mouvement communiste international au sein duquel les dirigeants soviétiques veulent continuer à jouer un rôle prépondérant. Dans la droite ligne des pratiques staliniennes, ils ne se privent d’aucun moyen pour y parvenir. Plusieurs partis en ont fait les frais. D’autres, dont le Parti Communiste Français, sont l’objet de menaces accompagnées de tentatives d’organisation de “dissidences” clairement “aidées” par Moscou. C’est dans ces conditions que Jacques Duclos choisit de souligner “l’ouverture d’esprit” la “hardiesse de pensée” de Clément, en rappelant que “à l’époque où il travaillait en France, nous avions tendance, sous l’impulsion de Maurice Thorez à aller loin dans la voie de l’unité de lutte de la classe ouvrière et de l’union des forces démocratiques, jamais Clément…ne tenta de nous retenir … Il ne s’agissait pas pour lui de se substituer à la direction de notre parti, mais de lui faire part de ses impressions, et par celà même d’apporter sa contribution à l’analyse de la situation que nous étions amenés à faire. … Clément fut un ardent défenseur de notre politique unitaire, qui était discutée dans certains cercles de l’Internationale Communiste…”.
Et pour être bien clair, Jacques Duclos ajoute : “... bien des fois j’eus l’occasion d’évoquer avec lui la grande figure de Dimitrov …” . Dimitrov, l’ancien secrétaire général de l’Internationale, qui devint Premier Ministre de Bulgarie en 1946, et prôna alors l’idée que dans les conditions nouvelles créées par la victoire sur le nazisme, on pouvait envisager dans un certain nombre de pays de “faire l’économie de la dictature du prolétariat”. Cette idée fut reprise par Maurice Thorez en juin 1947, dans son rapport au XI° congrès du PCF à Strasbourg. Elle ne le fut qu’une seule fois ! Elle était aux antipodes de la ligne que Staline voulait imposer pour les années d’après-guerre. En septembre 1947, une conférence de neuf partis communistes d’europe de l’Est, d’URSS, de France et d’Italie rappela tout le monde à l’ordre (Jacques duclos indique dans ses Mémoires que “cette conférence fut assez pénible pour nous, délégués français, car certaines délégations semblaient décidées à faire en quelque sorte notre procès” ). Le 12 juillet 1949, Georges Dimitrov mourut non pas en Bulgarie, mais dans un sanatorium près de Moscou. Officiellement c’était “de maladie”. Des analyses réalisées quelques années plus tard confirmèrent de fortes suspicions d’empoisonnement : elles révélèrent une présence anormale d’uranium dans son organisme. Ce n’est évidemment pas innocemment que Jacques Duclos l’évoquait avec insistance en 1969, dans son hommage à Clément !
N’évitons pas une question qui peut être gênante : on rappelle parfois les insultes lancées par Jacques Duclos à l’encontre de militants du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire venus perturber un rassemblement du PCF. Quelle est ta réaction quand on rappelle cet épisode ?
Je n’étais pas présent à ce rassemblement organisé par la fédération de Paris. C’est le lendemain matin dans le bureau de Georges Marchais que j’ai appris ce qui s’était passé. Il y avait d’abord des interrogations et des critiques à l’encontre des organisateurs qui auraient dû faire en sorte que Jacques Duclos, venu pour une soirée consacrée au féminisme, n’ait pas à répondre à des perturbateurs agissant de façon délibérément provocatrice, au nom d’une cause relevant d’un tout autre sujet. Mais le sentiment qui dominait après son comportement et ses propos, c’était la consternation. Visiblement surpris par une irruption dont l’éventualité n’avait pas été évoquée devant lui, il avait perdu son sang-froid. Il était venu soutenir les femmes communistes agissant dans leur parti pour une meilleure prise en compte des aspirations et des luttes des femmes pour leurs droits et pour l’égalité. Il avait d’autant plus à dire sur ce sujet que le féminisme - comme d’autres luttes sur des questions “sociétales” - avait trop souvent été relégué au second plan avec l’argument fallacieux : “il faut d’abord en finir avec le capitalisme, après les problèmes de société se régleront d’eux-mêmes” ( comme si l’exemple soviétique ne montrait pas une réalité bien plus complexe, et même contradictoire !). Il n’était pas par principe hostile aux formes nouvelles - parfois provocatrices - que pouvait prendre ce combat. Je me souviens que , quand je travaillais avec lui, il recevait assez souvent la visite amicale d’une représentante du Mouvement de Libération des Femmes (le MLF) qui se distinguait par des actions spectaculairement choquantes pour les “bien-pensants”. Mais Jacques était né en 1896. Une autre époque ! Comme le note sa notice biographique : “Sa formation première se partagea entre l’instituteur laïc et le curé qui lui inculqua une solide éducation chrétienne …”. Si ses idées sur d’autres sujets avaient depuis beaucoup évolué, ce n’était pas vraiment le cas à propos de l’homosexualité … A quelque chose malheur est bon dit un proverbe bien de chez nous : après ce consternant incident, la direction du PCF a dû, avec l’accord de Jacques - affirmer des conceptions plus en phase avec les réalités des sociétés modernes !
Que pourrais-tu dire sur ce qu’il faut, d’après toi, retenir du dirigeant Jacques Duclos à de jeunes militants communistes de 2025 ?
D’abord, je me permets de dire aux jeunes militants que tu évoques : ne cherchez pas de “modèle” à copier. On connaît cette fière affirmation : “ni dieu, ni César, ni tribun”… J’y ajoute volontiers, ni modèle ! Il n’y a pas une seule et unique façon d’être communiste, pas une seule et unique façon d’être un dirigeant communiste. A chacune, à chacun d’inventer sa façon de l’être. Nous, communistes, sommes attachés au collectif - et je viens d’évoquer l’histoire d’un homme communiste qui a consacré sa vie à organiser, renforcer, faire connaître et apprécier un collectif pour lequel il a beaucoup donné - mais il n’y a pas de collectif fort, créatif et dynamique, s’il n’y a pas des personnalités fortes, dynamiques et créatives sachant unir leurs différences dans une action commune. J’ai eu l’occasion, en quittant mes responsabilités nationales, il y a 25 ans, de dire combien je trouvais regrettable, à vrai dire nuisible, l’habitude que nous avions prise de ne confier des responsabilités à des jeunes militants qu’à partir du moment où ils avaient appris à travailler comme nous ; où ils entraient dans le même moule où nous étions entrés avant eux ; bref où devenant comme nous ils n’étaient plus réellement des jeunes militants ! Et, bien avant, dans les années 1970, c’est avec soulagement que j’ai applaudi l’abandon du dogme de la nécessaire “unité de pensée et d’action” des communistes - comme si plusieurs dizaines de milliers (plusieurs centaines de milliers à l’époque) d’hommes et de femmes pouvaient à tout moment et sur toutes choses, penser exactement pareil, et agir exactement de la même façon !
Pas de modèle donc. Mais autre chose est la connaissance de ce qu’ont été des dirigeants prestigieux comme Jacques Duclos. De ce qu’ils ont réellement été dans leur complexité, et pas dans des représentations hagiographiques ou au contraire visant à leur dénigrement. Cette connaissance est nécessaire à la compréhension des époques et des événements dont ils ont été des acteurs. Comprendre ce passé permet de mieux discerner dans la complexité des situations auxquelles on est confronté le nouveau dont on peut s’emparer pour construire l’avenir. La transmission de l’expérience historique entre les générations successives de militants est à mon avis une dimension essentielle du combat politique.
De la personnalité de Jacques Duclos, je propose de retenir d’abord la curiosité. Il était perpétuellement à l’affût des possibilités d’apprendre des choses nouvelles, dans tous les domaines. Il lisait beaucoup, et pas seulement des livres “politiques”. Je recevais les livres qui lui étaient adressés, et j’avais intérêt à les lire aussitôt, avant qu’avec une amusante dextérité il ne les subtilise et les emporte pour les dévorer ! Cette curiosité était au cœur de sa recherche d’ouverture aux autres. Aujourd’hui, la vie politique et sociale est, en France comme dans de nombreux autres pays, durement affectée par une tendance sans cesse accentuée à l’enfermement des individus dans des “bulles” où ils sont assignés à résidence en fonction de leur âge, leur condition sociale, leur profession, leurs loisirs, leurs centres d’intérêts, etc.. et où ils se parlent entre eux et rien qu’entre eux, sans avoir accès à ce que d’autres peuvent avoir à dire, à leur apprendre, à apprendre d’eux - sans pouvoir construire quoi que ce soit avec eux. Attention à ne pas laisser se refermer une “bulle communiste”, un entre-soi communiste qui empêche d’entendre les autres, et du même coup d’être écouté d’eux !
L’ouverture aux autres ne peut accepter l’entre-soi, pour autant, elle n’est ni l’éclectisme ni le relativisme. Tout n’est pas équivalent. Elle appelle le débat sincère et honnête, la confrontation des idées - pas dans le but de faire dire à l’autre que nous avons raison, mais avec la volonté de rechercher ce qui peut permettre d’avancer ensemble dans la compréhension du monde pour mieux le transformer. C’est dans un esprit d’ouverture que Jacques Duclos a joué un grand rôle dans l’établissement de liens fructueux entre le PCF et les intellectuels. Son admiration pour Jaurès n’y fut pas pour rien. Le dirigeant socialiste, le fondateur de l’Humanité, avait eu le souci d’élargir au monde intellectuel son combat pour rassembler les différentes composantes du mouvement ouvrier français décimées et éparpillées après la fin dramatique de la Commune de Paris. Jacques Duclos ne l’avait pas oublié. En 1938, pendant cette période d’intense activité qu’il appela dans ses Mémoires les “jours ensoleillés du Front Populaire”, la notice biographique du Maitron note qu’ “il se consacra au problème des intellectuels et de la culture” : Le 1° juin 1938, il prononça à la Maison de la Chimie à Paris une conférence sur “les droits de l’intelligence”, dont la rédaction doit sans doute beaucoup à Louis Aragon. Il publia dans l’Humanité du 1° août un article titré “communisme et liberté de création”. Et, en mars 1939 fut inauguré à Montreuil un Musée de l’Histoire auquel il tenait beaucoup ! Il maintint dans la clandestinité ses liens avec les intellectuels résistants. Il était naturellement avec Maurice Thorez pour recevoir l’adhésion de Picasso au PCF. Quand je travaillais à ses côtés, j’ai vu beaucoup d’intellectuels de différentes disciplines , pas tous communistes, lui rendre visite et s’entretenir souvent longuement avec lui. J’ai évoqué ses liens avec Aragon à propos de la conférence de 1938 et des intellectuels résistants, il faut ajouter que Jacques prit la défense d’Aragon quand il fut critiqué pour la publication dans Les Lettres Françaises d’un portrait de Staline par Picasso qui s’éloignait quelque peu des représentations officielles du “camarade staline” … C’est par une anecdote que je vais clore ce rappel des rapports entre Jacques Duclos, les intellectuels et les créateurs : le 26 avril 1975, lendemain de la mort de Jacques Duclos, j’arrive très tôt au siège du parti, et quelques minutes après mon arrivée j’entends ces mots sur le seuil de la pièce où je me trouvais : “ Bonjour. Je suis Louis Aragon. Je viens voir si je peux faire quelque chose après le décès de Jacques “.
Tu me demandes “que retenir du dirigeant Jacques Duclos”. Beaucoup de choses, et on ne retiendra pas tous et toutes les mêmes choses. Mais il y a un aspect sur lequel je souhaite appeler à réfléchir. On l’a vu : dans un monde qui ne cesse de connaître des soubresauts plus ou moins importants mais souvent considérables, et dans une société en constante évolution (une évolution qui n’est pas linéaire mais avance parfois par à-coups, avec par moments des transformations profondes) les dirigeants doivent constamment s’interroger et réorienter l’action du parti communiste pour qu’il puisse jouer correctement son rôle. Et ces nécessaires réorientations doivent s’accompagner de modifications dans le fonctionnement du parti, quelquefois même dans ses structures. Rien n’est jamais facile. Il y a toujours des pesanteurs, des peurs : peur du changement, peur des nécessaires remises en cause, et naturellement des oppositions plus ou moins fortes. Les dirigeants ont alors pour devoir de prendre leurs responsabilités et s’engager, se battre pour ce qu’ils croient être juste et nécessaire. Au cours des périodes évoquées dans cet entretien, c’est ce qu’ont fait, dans des circonstances différentes, et à la tête d’un PCF qu’il fallait transformer pour qu’il soit à la hauteur d’enjeux différents Maurice Thorez, Waldeck Rochet, puis Georges Marchais - et Jacques Duclos les a secondés et soutenus. Le parti a connu des succès mais aussi des échecs - il lui est même arrivé d’être très affaibli, voire menacé de disparition. Ces dirigeants n’ont pas fait le dos rond en attendant des jours meilleurs. Ils n’ont pas reculé devant le risque de ne pas être suivis. Rien n’oblige à reprendre telle ou telle méthode contestable, voire inadmissible, malheureusement utilisée à certaines époques. Les attaques personnelles, tout comme les injonctions à l’alignement inconditionnel derrière les dirigeants en place sont selon moi à exclure.
Une dernière remarque. Jacques Duclos n’a pas connu l’effondrement de l’Union Soviétique, mais il était inquiet. Il voyait bien que certaines certitudes sur lesquelles il avait fondé l’engagement de toute sa vie pouvaient être mises à mal. Les jeunes militants d’aujourd’hui peuvent, s’ils le décident, aller plus loin dans la réflexion. On voit bien, en 2025, qu’au XX° siècle, il n’y a pas eu seulement l’échec du soviétisme, qui voulait abolir le capitalisme, mais aussi l’échec de la social-démocratie qui, là où elle a été au pouvoir, n’a pas atteint son objectif : réguler le capitalisme ; puis l’échec du capitalisme de la mondialisation financière mis en place après l’effondrement soviétique, qui promettait une mondialisation heureuse mais qui a provoqué le chaos du monde d’aujourd’hui. On voit les conséquences politiques de ces trois échecs : déjà contestés pour leur incapacité à répondre aux attentes populaires - pour leur inefficacité - dans tous les pays les partis politiques n’ont plus de perspective crédible à proposer. Ils sont discrédités, et les populismes - notamment les populistes d’extrême droite progressent dangereusement. C’est d’autant plus préoccupant que ces partis - tous les partis politiques, qui dans leur forme actuelle sont une “invention” du XX° siècle - ont été fondés sur un même schéma : accéder au pouvoir (de préférence par des voies électorales), et utiliser ce pouvoir pour réaliser l’objectif annoncé pour solliciter les suffrages des électeurs. Ce schéma n’est-il pas remis en cause après les échecs historiques que je viens d’évoquer ? Quelles conclusions en tirer ? Certainement pas qu’il faudrait envisager d’autres voies que celle des élections, du suffrage universel ! Ne faut-il pas plutôt choisir de reconquérir l’électorat populaire en étant les meilleurs pour travailler à trouver des solutions aux problèmes que le capitalisme en crise n’arrive pas à résoudre ? Ces problèmes, il les aggrave au contraire en organisant le drainage systématique des richesses produites grâce au travail humain vers les marchés financiers, au détriment des investissements nécessaires pour augmenter les salaires, produire pour répondre aux besoins des populations, des territoires, de la transition écologique, du nécessaire développement des services publics, etc… Peut-on penser que proclamer : ”on a un bon projet de société pour l’après-capitalisme, un bon programme de gouvernement, élisez-nous, on fera le reste”, pourrait suffire pour reconquérir la crédibilité perdue et les électeurs déçus, démotivés et pour beaucoup en colère contre “la politique” et les politiques ?
Voilà beaucoup de questions, qui appellent un débat exigeant ! Pour ce qui me concerne - et c’est la dernière chose que j’aurai à dire aux jeunes militants communistes à qui tu m’as demandé d’adresser un message - ces questionnements et les éléments de réponse que j’entrevois m’amènent à être plus que jamais convaincu que j’ai fait le bon choix en devenant communiste il y a soixante dix ans ! C’est bien le dépassement de ce capitalisme qui s’enfonce dans sa crise qui est à l’ordre du jour. On n’est pas communiste aujourd’hui comme on l’était alors - et c’est bien ! Les temps sont difficiles pour les communistes d’aujourd’hui, mais s’ils le veulent, ils trouveront la solution. Elle ne ressemblera certainement pas à ce que j’ai vécu - on voit bien que la question est posée d’une nouvelle conception du rôle et de la forme même des formations politiques. Bon courage, camarades !
Propos recueillis par Valère Staraselski
A lire également sur le site :
- un article de Bernard Frederck paru dans l’Humanité Magazine :
https://lafauteadiderot.net/Jacques-Duclos-une-vie-faite-par-et-pour-l-engagement
- le texte de Jacques Duclos sur Eugene Fried :
https://lafauteadiderot.net/A-la-memoire-de-mon-ami-Clement
- sur le Pacte germano-sovietique, un article de Bernard Frederick :
https://lafauteadiderot.net/Le-23-aout-1939-le-pacte-germano
- un texte de Francois Eychart sur la mission du général Doumenc a Moscoi en aout 1939
https://lafauteadiderot.net/Aout-39-la-mission-a-Moscou-du
[1] Si je cite si souvent cette notice, c’est qu’elle est le résultat d’un travail d’historien, et en la lisant j’ai plusieurs fois pensé qu’elle exprimait très précisément des considérations sur la personnalité et l’action de Jacques Duclos correspondant à ce que j’avais ressenti plus ou moins confusément en travaillant à ses côtés, puis plus tard en réfléchissant à la place qu’il avait tenu dans l’histoire du PCF.
[2] Autobiographie d’Hitler publiée dans la fin des années 1920, dans laquelle il expose son idéologie raciste et antisémite, ses projets d’Etat dictatorial et sa stratégie d’expansionisme territorial
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil