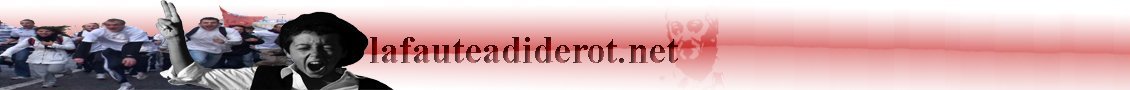
Intervention lors des Rencontres d’Espace Marx Aquitaine. 3 décembre 2024
Résumé. Andreas Malm, qui est à l’origine du concept de « capitalocène », est un des références théoriques pour celles et ceux qui veulent mettre en cause la responsabilité du système capitaliste dans le bouleversement climatique. J’examine la pertinence des principales notions sur lesquelles il fonde ses analyses (composition fossile du capital, rôle de la machine à vapeur dans le changement climatique, consommation comme appareil idéologique…) et du modèle d’action politique qu’il en déduit. Kohei Saito est une autre référence pour la recherche d’alternative. Il se réfère à la découverte d’un « dernier Marx ». J’aborde de manière succincte quelques-unes des analyses présentées dans son dernier livre et les solutions qu’il y préconise sous l’appellation « communisme de la décroissance ». Enfin, il s’agit surtout de regarder si ce que chacun de ces deux penseurs préconise est à même de faire face à l’enjeu climatique.
Dans une première partie, j’examinerai les analyses d’Andreas Malm et la conception de l’action politique qu’il en déduit.
Andreas Malm est une des références théoriques avancées par celles et ceux qui veulent associer prise de conscience des enjeux climatiques et remise en question du capitalisme [1]. Il s’est fait notamment connaitre par la remise en cause de la notion « d’anthropocène » au profit de celle de « capitalocène ».
Commençons tout d’abord par présenter quelques-unes de ses thèses essentielles, en les résumant autant que possible.
1. La notion de capital fossile comme clé d’interprétation de l’histoire
Selon la présentation d’un de ses textes, Andreas Malm propose « une théorie du capital fossile, introduisant le facteur fossile dans l’équation de la production de plus-value, en prenant l’exemple contemporain de la Chine (…). Il montre que c’est bien le capitalisme, et non pas l’humanité, qui est à l’origine du réchauffement climatique, contre le récit de l’anthropocène. ». Il avance la notion de « composition fossile du capital » [2]. « La lutte pour minimiser la part de travail humain (…) cause une augmentation de la composition fossile qui, opérant à travers l’histoire du capitalisme, se traduit en une loi de l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère ». « Considérant que la machinerie capitaliste a été fondée sur le stock depuis le début du 19ème siècle (…) il semble qu’il y ait une loi de l’augmentation de la composition fossile du capital ».
2. Le changement climatique a pour origine le choix de la machine à vapeur fait par les capitalistes anglais au 19ème siècle.
« …La machine à vapeur est largement, et correctement considérée comme la locomotive originelle de la croissance économique, associant pour la première fois la combustion du charbon à la spirale en constante expansion de la production capitaliste marchande. Bien qu’il soit certes banal de le dire, les machines à vapeur n’ont pas été adoptées par quelque représentant naturel de l’espèce humaine. Le choix d’une force motrice dans la production de marchandises ne pouvait être l’apanage de l’espèce, car il présuppose, pour commencer, l’institution du travail salarié. Ce sont les propriétaires des moyens de production qui ont mis en place cette nouvelle force motrice. Une petite minorité, en Grande-Bretagne même – tous mâles, tous blancs –, une classe d’hommes comprenant une fraction infime de l’humanité au début du XIXe siècle. » [3]
3. La logique du capital c’est de produire plus.
Andreas Malm présente le capitalisme comme développant la consommation : « La tendance historique du capital fossile est de vomir le plus de produits avec F (le capital fossile) pour le plus de personnes ». « Le capital (…) est un processus aveugle d’auto-expansion, certes personnifié par le capitaliste, et dont les actions et réactions sont – et doivent être – animées par la compulsion à valoriser la valeur » [4].
4. La consommation est un « appareil idéologique d’Etat » qui assure le maintien du système.
Andreas Malm considère que « l’indifférence au réchauffement climatique doit mener à repenser la catégorie d’idéologie, à l’aide de Gramsci et d’Althusser » [5].
« Nous pouvons concevoir la consommation comme un appareil idéologique d’Etat », écrit-il. C’est dans ce cadre qu’il inscrit le culte du charbon dans le foyer dans l’Angleterre du 19ème siècle. « L’idéologie est immanente au simple fait de regarder un feu », écrit-il encore.
5. Par conséquent, l’issue ne peut venir que de forces aux marges du système.
« Pourquoi le sujet fossile se soulèverai-t-il pour étouffer le feu ? Il pourrait se perdre dans ce combat. Le feu le regarde si plaisamment dans la cheminée. Nous avons ici une potentielle explication au fait que la résignation face au changement climatique s’accroit à mesure que ce dernier accélère ».
A la question « quelles sont les forces qui peuvent mettre en cause ce système ? », la réponse d’Andréas Malm est donc la suivante :
C’est seulement « aux marges de l’énergie fossile », « là où les obligations au feu sont moins strictes » qu’il y a « moins de subjectivité investie dans le stock » (il cite en exemple les pauvres).
La seule issue : « si le peuple sort de sa stupeur (…) un changement significatif pourra intervenir ».
Corollaire implicite de cette idée, les travailleurs sont trop prisonniers de ce système pour qu’on puisse les voir comme les forces motrices d’une réponse aux enjeux climatiques, de même que les peuples qui aspirent au développement, et ne serait-ce qu’à la sortie de la pauvreté.
S’il s’agit de faire sortir le peuple « de sa stupeur », on comprend qu’un type d’action spectaculaire s’impose. D’où l’éloge du sabotage comme grain de sable qui peut enrayer le système : « Nous pourrions détruire les machines qui détruisent la planète » [6]. D’où le titre de son ouvrage : « Comment saboter un pipe-line ? ».
J’en viens à la critique des thèses d’Andreas Malm.
Premièrement. La composition fossile du capital est une notion confuse.
La notion de composition fossile du capital est une transposition inspirée de la notion complexe de composition organique du capital utilisée par Marx dans ses travaux [7]. Précisons que pour Malm il ne s’agit pas seulement du capital investi dans les énergies fossiles, mais de la composition fossile propre à l’ensemble du capital, qui est censée s’élever au cours du temps selon « une loi d’airain ».
Or, le recours à plus ou moins d’énergie fossile dans la production est un phénomène qui n’a rien à voir avec le capital comme pouvoir économique sur les rapports sociaux dans la production dans le but d’en tirer la plus-value (l’exploitation). Sur cette question, je renvoie aux travaux de Jacques Bidet, qui insiste sur la nécessaire distinction entre l’espace de la plus-value (production capitaliste), l’espace de la valeur (production marchande), l’espace de la production de valeurs d’usage concrètes (avec donc leur dimension physique). La notion de composition fossile du capital est un concept bancal de ce point de vue. Tout ce qui se rapporte à l’espace de la valeur mais n’est pas mesurable en quantité de fossiles, puisque cette quantité est une notion physique qui ne relève pas de l’espace de la valeur ou de la plus-value.
Deuxièmement. Les données contredisent l’idée que le changement climatique a son origine dans le choix de la machine à vapeur.
Cette thèse ne correspond pas aux données scientifiques. Je renvoie à ce sujet à la partie Climat et luttes des classes du livre Communisme, un chemin pour l’avenir [8], et aux différents graphiques qui y sont présentés. Je m’appuie notamment sur Sylvestre Huet, journaliste reconnu par la communauté des climatologues pour la rigueur de son travail de vulgarisation : c’est depuis les années 1950, environ et non depuis le XIXe siècle que les émissions de GES montent vers un niveau tel qu’il peut entraîner une modification du climat. Ce n’est qu’après la Seconde guerre mondiale que les quantités d’énergies fossiles utilisées prennent progressivement l’ampleur qui leur permet de bousculer le climat planétaire.
Troisièmement. La logique du capital n’est pas de développer la consommation de masse.
Le capital n’a pas ce souci de la reproduction de la force de travail ou de la consommation des travailleurs que lui prêtent parfois certaines interprétations se réclamant de Marx. Jacques Bidet a montré dans ses travaux que ces interprétations ne correspondent pas à l’exposé de Marx : « … Et tout aussi bien le salaire peut-il descendre au-dessous du minimum de survie : on jette alors le salarié et on le remplace par un autre. Les corps jetés font partie du paysage néolibéral. En eux se vérifie « la logique du capital » lorsqu’elle n’est pas freinée par une force sociale adverse ». Il ajoute encore, toujours en se référant au Capital, que la logique du capitaliste « n’est pas celle de la reproduction d’une population, mais de son capital propre, à quoi il est contraint par la concurrence […] La fin ultime du capitaliste n’est pas de produire des “valeurs d’usage”, ni même des marchandises. Elle est de faire du profit, d’accumuler de la plus-value, c’est-à-dire du pouvoir économique » » [9].
Ce que Marx formulait ainsi : « Après moi le déluge ! Telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. Le capital ne s’inquiète donc point de la santé et de la durée de vie du travailleur, s’il n’y est pas contraint par la société » [10].
On cite parfois le « fordisme » comme illustration d’une volonté capitaliste d’augmenter les salaires. Rappelons ce qu’il en a été réellement : les « cinq dollars par jour » institués dans l’usine de production des Ford T par Henry Ford constituaient le salaire versé dans une usine construite avec une organisation du travail nouvelle (la chaine de production), beaucoup plus productive et comptant beaucoup moins de salariés pour une même production. Ce qui intéressait Ford, c’était évidemment la masse salariale globale, dans le contexte d’une énorme difficulté à trouver des ouvriers acceptant les contraintes de cette nouvelle organisation dans un secteur en plein essor. De plus, pour décrire l’économie capitaliste des Etats-Unis durant cette période, il faudrait prendre en compte l’ensemble des secteurs, y compris la situation misérable des ouvriers agricoles décrite par John Steinbeck dans Les raisins de la colère. Or, le rythme de progression du salaire moyen aux Etats-Unis durant les années 1920 semble faible. On ne peut donc comprendre le « fordisme » comme une volonté d’amélioration générale de la situation ouvrière de la part des capitalistes aux Etats-Unis. Quand on prête au système capitaliste la volonté de s’assurer d’un bon niveau général de consommation par l’élévation des salaires, on oublie que ce qui est gagné en profit par la pression sur la masse des salaires permet aussi la consommation d’une classe. Au final, la nature de la consommation dépend des rapports de force entre les classes, et le capital investi dans la production doit évidemment s’adapter au résultat de ces rapports de force [11]
Quatrièmement. Malm fait l’impasse sur l’histoire réelle des 30 dernières années en matière de climat.
On ne peut comprendre la gravité, l’urgence, de la situation actuelle sans avoir en tête ce qui s’est passé depuis 30 ans dans les négociations internationales sur le climat. Le fait que la Convention Climat signée à Rio en 1992 soit restée lettre morte et que le Protocole de Kyoto ait été abandonné est le résultat non de l’inertie d’un système mais de rapports de domination au plan international. Le rôle des Etats-Unis ne doit pas être éludé [12].
Les États-Unis ne se sont pas contentés d’empêcher que les négociations internationales débouchent sur des dispositions efficaces, avec la bénédiction de l’Union européenne par choix politique. En 2013, ils sont devenus les 1ers producteurs mondiaux de pétrole et carburants liquides grâce à la production de gaz de schiste.
Quand le PDG de Total Energie, Patrick Pouyané déclare « la transition énergétique ira au rythme que décideront les Etats-Unis » [13], il y a une part de constat de la réalité des trente dernières années.
A aucun moment Andreas Malm ne fait état de cela. Il contribue ainsi à l’écran de fumée déployé pour masquer les responsabilités dans la situation actuelle.
J’ajoute qu’en défendant, comme bien d’autres, l’idée d’un moratoire général sur les énergies fossiles, il prône l’abandon des principes de la Convention Climat, qui liait la contribution à la décarbonation au degré de développement selon les Etats. Il place sur le même plan le Mozambique, par exemple, et les Etats-Unis.
Quelle action politique sur les enjeux climatiques ?
L’action politique proposée par Andreas Malm ne tient pas compte des véritables obstacles qui ont empêché une réponse à la hauteur de l’humanité. De plus, le type d’action qu’il défend, le sabotage, est illusoire à grande échelle en dehors d’une situation de guerre ouverte.
Au final, la question des rapports de force internationaux est incontournable. C’est pourquoi la question du pouvoir politique en France est cruciale si l’on veut peser pour une évolution de la situation. Une politique nouvelle dans notre pays, aux plans national et international, pourrait contribuer à répondre à l’enjeu climatique de plusieurs façons :
-en montrant dans les faits qu’une qu’un développement décarboné répondant aux besoins humains est possible,
-en s’appuyant sur le potentiel technologique de notre pays pour des coopérations internationales dans ce domaine,
-en soutenant les réformes indispensables de l’architecture économique, monétaire et financière du monde.
Cela pose donc la question des rapports avec les peuples du Sud. Toute réponse qui ne tient pas compte de la volonté des peuples de vivre mieux condamne à l’impuissance et au final à la désespérance.
***
Je vais maintenant examiner quelques-unes des analyses de Kohei Saito et, brièvement, les solutions qu’il préconise, telles qu’elles sont exposées dans son dernier livre, intitulé Moins ! La décroissance est une philosophie.
Tout d’abord, je présenterai quelques aspects des positions théoriques de Kohei Saito, de manière très sucsinte.
1 - Le rapport à Marx : la découverte, selon ses propres termes, de la pensée du dernier Marx « déterré » après « 150 ans de sommeil ».
La thèse est la suivante : Marx a été « incompris », « ce qui a conduit aux déformations majeures de sa pensée et à la création du monstre qu’est le stalinisme et à la terrible crise environnementale à laquelle fait face l’humanité. Il est temps de remettre les pendules à l’heure ». Il s’agit donc de reprendre le fil de cette histoire, après une interminable parenthèse de 150 ans.
Une nouvelle théorie de Marx est ainsi reconstituée à partir de certaines de ses notes de lecture rédigées dans les années 1870 et surtout de son interprétation nouvelle de la lettre adressée par Marx à Vera Zassoulitch en 1881 [14], en faisant abstraction de tous les autres écrits de la même époque (je citerai parmi bien d’autres choses, son interview au Chicago Tribune en 1879 [15], document passionnant, ses notes sur Wagner, en 1881, sa lettre à Jules Guesde en 1879 [16], ou encore sa participation active à l’ouvrage « L’anti-Dühring » signé par Engels, etc…).
Je ne vais pas vraiment aborder cette interprétation de Marx. On reviendra peut-être dans la discussion sur la nouveauté ou non des documents « déterrés ». Je relève seulement que dans les passages où Kohei Saito résume la pensée de Marx, la question du pouvoir politique est évacuée, alors qu’elle n’a pourtant cesser d’être au cœur de ses préoccupations.
Sur ce sujet, je signale l’article de Jean Quétier « Le dernier Marx, un anti-moderne ? » dans La pensée (n° 419). Il n’évoque pas directement Kohei Saito, mais divers penseurs qui défendent de manière convergente l’idée d’un « dernier Marx » opposé à celui de la première période, ce qu’il récuse, sans nier des infléchissements dans ces travaux. Selon Jean Quétier, dans ces derniers travaux, « l’enjeu pour Marx est au fond de surmonter tout ce qui, dans sa propre théorie, pourrait encore relever d’une généralisation abusive ».
2 - Sur la notion de valeur
Kohei Saito se réclame de la notion de valeur de Marx.
Première remarque. Selon une note du traducteur : « Dans ce livre, l’auteur utilise systématiquement le terme « valeur » en remplacement du terme « valeur d’échange », qu’il oppose au terme de « valeur d’usage », tous deux employés dans les études marxistes. La valeur d’échange est grossièrement le prix payé pour un objet ou un service. Selon le contexte, le terme d’origine a été traduit en « prix », en « valeur » ou en « profit ».
Prix, valeur, profit, ce n’est pas vraiment la même chose ! Soit il y a confusion dans le texte de Kohei Saito, soit il y confusion dans la traduction. On peut d’autant moins conclure que Kohei Saito ne revient pas vraiment dans cet ouvrage, sur le sens de la notion de valeur chez Marx, concept que celui-ci définit à partir du travail et de son « double caractère représenté dans la marchandise ».
Deuxième remarque. Pour Kohei Saito la prise en compte de la notion de valeur dans le fonctionnement des sociétés est la source de tous les maux. Ce n’est pas une position qui est celle du « dernier » Marx pour reprendre son expression. Ainsi dans la note sur Wagner (1881), Marx explique que « la valeur n’est qu’une façon historique particulière de résoudre un problème que l’on trouve dans toute société dès lors que la dépense de force de travail prend un caractère social » (je renvoie sur ce sujet au petit livre de Jacques Bidet : La loi travail, le corps bio-politique du Capital).
3 - Sur le capitalisme
Le plus important me semble que Kohei Saito identifie capitalisme et production marchande : « le capitalisme est une société où les gens achètent et vendent des choses sur un marché ». Ce n’est pas la position de Marx, même le « dernier ». Marx distingue la production marchande et la production capitaliste qui instrumentalise le marché. La notion de plus-value semble absente des travaux de Kohei Saito, en tout cas dans le livre Moins.
On peut faire la même remarque que pour Andréas Malm : ce qui intéresse le capital, ce n’est pas l’augmentation de la valeur, c’est le profit.
La croissance en tant que telle n’est pas le but du capital.
J’en viens maintenant aux solutions portées par Kohei Saito.
Avant d’y venir, Kohei Saito pose ainsi le problème, je cite : « La difficulté réside dans le fait que la répartition équitable des ressources n’est pas un problème propre à chaque pays. Comment réaliser aussi bien l’équité et la durabilité au niveau global ? Voilà le problème auquel nous sommes confrontés ».
La réponse qu’il préconise, c’est le « développement spontané de pratiques démocratiques d’entraide », les « communautés autonomes », les coopératives, le « municipalisme ». Le seul exemple de réponse à une échelle plus importante, c’est de préconiser une réforme institutionnelle permettant de faire émerger des institutions du type de la Convention Climat dans notre pays. C’est le local, la petite échelle qui est la réponse quasi-systématique. Il n’y a là rien d’original, il s’agit d’idées déjà bien présentes dans le débat politique.
Je vois quelques points à souligner, sans être exhaustif :
1-Kohei Saito s’inscrit dans le courant qui invite à éviter l’Etat
« Prendre ses distances à l’égard de l’Etat », écrit-il dans Moins.
Le « commun » est systématiquement opposé au « public ».
Kohei Saito utilise une seule fois le terme public positivement dans un exemple où il est cantonné à une dimension locale : il faut « passer », écrit-il, à une « énergie renouvelable publique produite localement pour une usage local [17]. C’est pourquoi il récuse explicitement l’idée de nationalisation.
Dans les pages intitulées « Ces associations qui ont créé la sécurité sociale », l’institutionnalisation des services de sécurité sociale est présentée négativement (elle est, je cite « en conflit avec l’horizontalité des communs »), plutôt que comme une étape supérieure des mutuelles créées par le mouvement ouvrier. De plus il considère que ce « chemin » n’est « plus viable » car conditionné par « une forte croissance économique ».
La construction d’un « commun » à l’échelle de l’humanité est aussi un angle mort.
2-Comme Andréas Malm, Kohei Saito fait abstraction des rapports internationaux, qu’il s’agisse des dominations qui pèsent sur le devenir de l’humanité ou, plus concrètement, de l’histoire des négociations sur le climat.
Kohei Saito les évoque à un seul moment dans Moins, à propos de la création du GIEC en 1988 : « quelques mois plus tard, écrit-il le mur de Berlin s’effondrait permettant ainsi au néo-libéralisme américain de s’emparer de la planète », « le timing ne pouvait être pire ».
Et il n’y revient plus.
3 La mise en cause de la recherche de solutions technologiques est une autre caractéristique de sa pensée.
A ce titre les scenarios du GIEC montrant qu’une trajectoire vers la décarbonation est possible sont présentés comme exemple de « techno-optimisme », car ils tablent sur la possibilité de répondre à une demande croissante en énergie. Il parle de « technologie-verrou » pour le nucléaire. Il dénonce la technologie comme idéologie.
4 Dernière remarque, à propos de la mise en cause des Objectifs de Développement Durable de l’ONU.
La première phrase du livre est celle-ci : « Les ODD sont l’opium du peuple ».
Il écrit pourtant plus loin : « la croissance économique est nécessaire pour les milliards de personnes qui n’ont pas accès à l’électricité, ou à une eau saine, qui n’ont pas de quoi manger tous les jours ». Or c’est précisément ces besoins et d’autres essentiels qui sont abordés dans les Objectif de développement durable de l’ONU. J’ajoute qu’il ne récuse pas la notion de développement, qu’il juge qualitative, par opposition à la notion quantitative de croissance.
Cela ne l’empêche pas d’enfoncer le clou un peu plus loin dans le livre : « il faut être critique sur les ODD », ce sont une « solution bancale ».
Je pense que cette voie amène à se couper des exigences élémentaires des peuples du Sud.
Au final, je trouve qu’il y a dans les solutions préconisées l’idée d’un individu qui peut avoir prise directe sur les réponses universelles, au travers de communautés auxquelles il participe directement, sans médiations (telles que l’Etat, les institutions internationales, ou les corporations, etc).
Mais la question essentielle est celle-ci : ces solutions permettent-elles de surmonter la difficulté que j’évoquais dans les termes qu’il utilise, que je cite à nouveau :
« La difficulté réside dans le fait que la répartition équitable des ressources n’est pas un problème propre à chaque pays. Comment réaliser aussi bien l’équité et la durabilité au niveau global ? »
Prenons le changement climatique. Kohei Saito reconnait évidemment qu’il faut poser des limites aux émissions de GES. Or des limites à la seule échelle locale, ne s’inscrivant pas dans une limitation d’ensemble ne serviraient à rien.
Pourtant, cela ne l’empêche pas d’énoncer : « il n’existe pas d’impossibilité à s’attaquer à la crise climatique par le développement spontané de pratiques démocratiques d’entraide ».
Eh bien mon opinion est que le « développement spontané de pratiques démocratiques d’entraide » à la seule échelle locale, si utile et nécessaire soit-il n’apportera pas de réponse à la crise climatique, surtout lorsqu’il s’insère dans un discours théorisant le rejet des politiques d’Etat et de la nécessité de changement profond dans l’architecture des rapports internationaux. Que vaudrait une limite sans des instances pour la fixer ? Quels moyens pour la faire respecter ? Or, en l’absence d’une limitation globale, les émissions de CO2 continuent à augmenter.
On ne peut imposer des limites aux émissions à l’échelle nationale et à l’échelle mondiale, sans politiques d’Etats et sans institutions internationales. En l’absence de politique d’Etat, comment met-on pourrait-on mettre en cohérence les activités vers une baisse et une élimination à terme des gaz à effet de serre ? Sans le « public », le « commun » restera un vœu pieu.
J’ajoute : même en admettant que l’on parvienne à atténuer le changement climatique par « le développement spontané de pratiques démocratiques d’entraide », comment répond-t-on au besoin de protection contre les catastrophes climatiques, exigence majeure même si l’élévation de la température était limitée à 1,5 degré ?
On l’aura compris, au travers de ces critiques je défends l’idée d’une action communiste qui n’ait pas le grand en horreur, qui cherche un apport à des réponses humaines universelles par un pouvoir politique nouveau en France qui apporte sa contribution à une transformation profonde des rapports internationaux.
La vidéo de cette intervention est en ligne sur le site Youtube d’Espace Marx Aquitaine :
https://www.youtube.com/watch?v=bkdhfiokj40
[1] En France, l’Institut La Boétie, qui se présente comme l’organisme de formation des militants de France Insoumise, lui a confié une « chaire ».
[2] Extrait de la présentation du texte « Capital fossile, vers une autre histoire du changement climatique ».
[3] Le mythe de l’anthropocène, sur le site de la revue Période : http://revueperiode.net/le-mythe-de-lanthropocene/ Bien qu’Andreas Malm présente son travail comme dans la lignée de Marx, on est loin des positions de celui-ci quand il déclarait : « La vapeur, l’électricité et le métier à filer étaient des révolutionnaires infiniment plus dangereux que des citoyens de la stature d’un Barbès, d’un Raspail et d’un Blanqui » (discours à la fête de The People’s Paper)
[4] Capital fossile, vers une autre histoire du changement climatique ». Sur le site de la revue Période : http://revueperiode.net/capital-fossile-vers-une-autre-histoire-du-changement-climatique/ Les autres citations viennent également de ce texte.
[5] Extrait de la présentation du texte « Capital fossile, vers une autre histoire du changement climatique ».
[6] Tribune dans The Guardian. 18 novembre 2021.
[7] Cette notion est évoquée dans le Capital, livre 1, chapitre 25 ainsi que le livre 3. Sur la complexité de cette notion, on peut lire un article de Pierre Duharcourt paru dans la revue Issue en 1979, republié dans le livre Pierre Duharcourt, une pensée en mouvement, éditions Epure.
[8] Communisme, un chemin pour l’avenir. Editions Manifeste.
[9] Jacques Bidet, Marx et la loi travail, le corps bio-politique du Capital. Editions sociales.
[10] Le Capital, livre 1, tome 1.
[11] Voir l’article Communisme, capitalisme et progrès selon l’Institut La Boétie, sur le site La faute à Diderot.
[12] Lire à ce sujet la 3ème partie du livre Communisme, un chemin pour l’avenir.
[13] Les Echos du 11 octobre 2024.
[14] Cette lettre a été publiée en 1924 en Union Soviétique, par l’Institut Marx-Engels. Pour Kohei Saito, elle constitue « l’apogée idéologique », « le testament » de Marx. Dans son interprétation, Kohei Saito évoque aussi les trois « brouillons » de la lettre, qui sont des textes beaucoup plus fournis que la lettre elle-même. Texte disponibles sur le site Persée : https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1967_num_5_1_3085
[16] Jean-Numa Ducange, Une lettre inédite de Karl Marx à Jules Guesde sur la France, l’« Orient » et l’« Occident » (1879). Actuel Marx n°73
[17] De manière surprenante, les sources d’énergie renouvelables sont présentées par Kohei Saito comme inintéressantes pour les capitalistes.
 Version imprimable
Version imprimable S'inscrire à ce fil
S'inscrire à ce fil